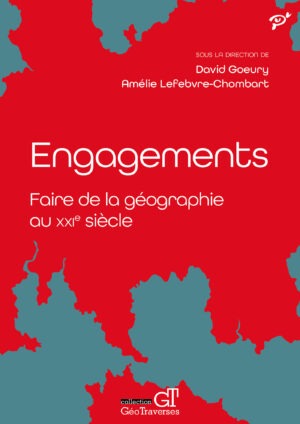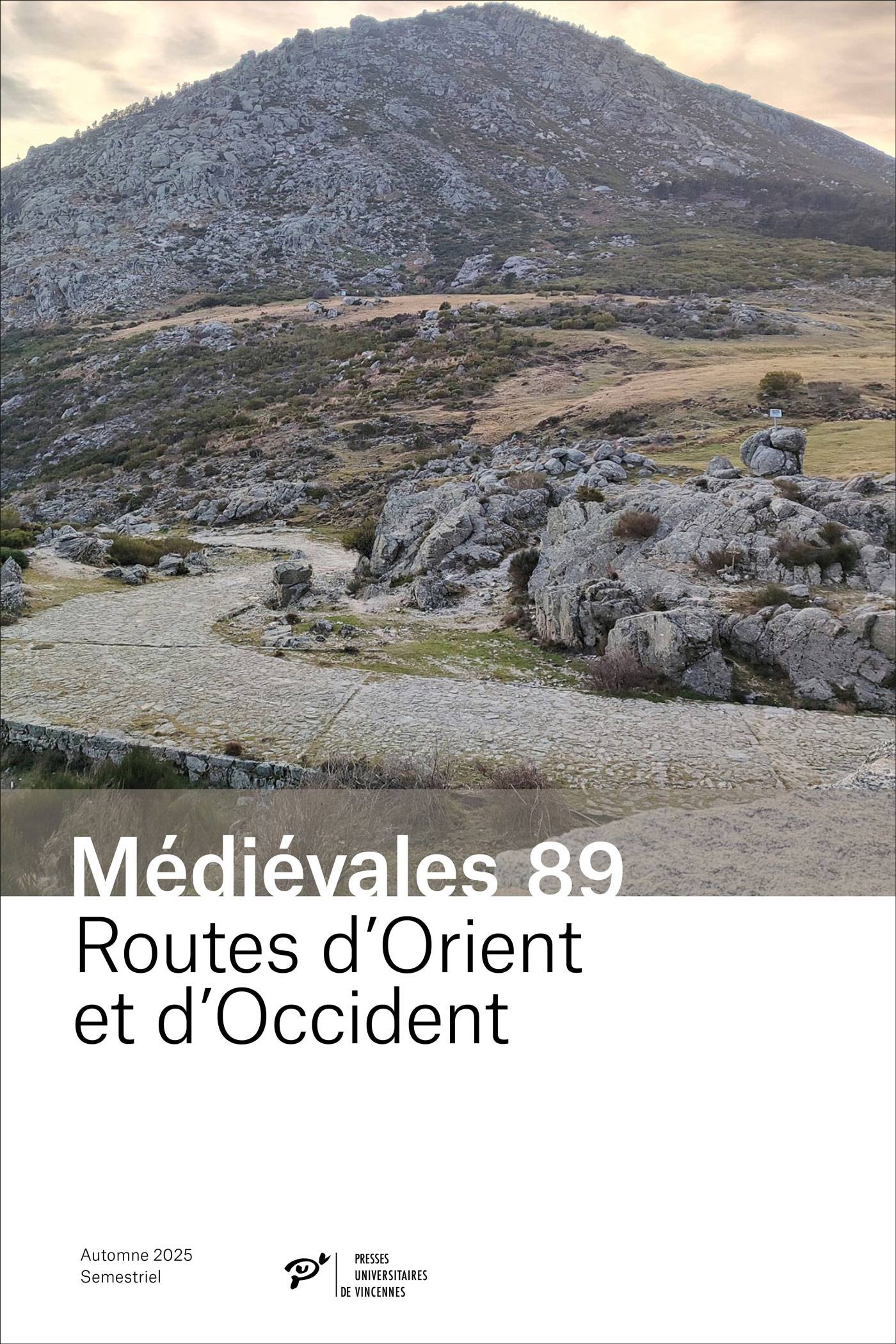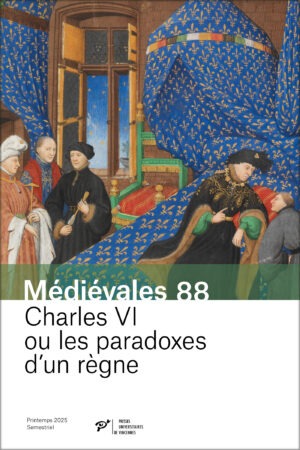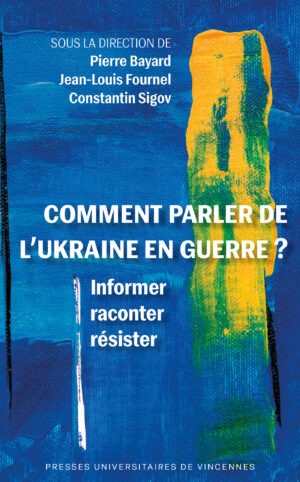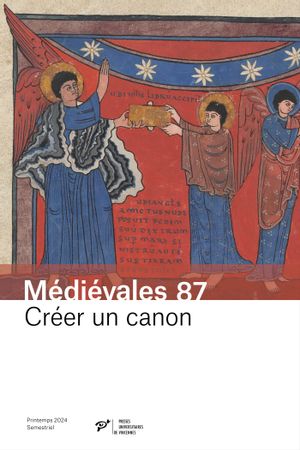Introduction
Les structures matérielles de la route médiévale : remarques préliminaires
Yassir Benhima, Sophie Gilotte et Marie-Odile Rousset
Ce dossier est issu d’une table ronde qui s’est tenue à Lyon – sous le titre que nous reprenons ici, en guise d’introduction à notre dossier : « Les structures matérielles de la route médiévale » – les 30 et 31 mars 2021, à l’initiative des laboratoires CIHAM et Archéorient, dont plusieurs chercheurs abordent différents aspects de la route médiévale 1. La thématique des routes n’est pas nouvelle : elle a déjà fait l’objet de multiples rencontres et publications, tant pour le monde antique que médiéval, plusieurs d’entre elles fournissant des états de la recherche forts utiles 2. En dresser l’inventaire ou en proposer un bilan dépasserait les limites imparties au présent exercice ; nous nous contenterons de présenter quelques aspects et problématiques, en mettant l’accent sur les routes en terres d’Islam, tout en ouvrant le champ à des comparaisons avec la Méditerranée occidentale.
La route avait jusqu’ici surtout été envisagée dans une perspective de géographie historique centrée sur la restitution des itinéraires et leur évolution, la localisation des agglomérations, l’identification des toponymes, l’établissement de la trame qui structure l’occupation des territoires ou, mieux encore, l’organisation de vastes ensembles politiques ou impériaux 3. Pour le monde islamique médiéval, cette approche a été favorisée par la centralité de la description des itinéraires dans la littérature géographique relevant du genre des masālik wa mamālik (itinéraires et royaumes) 4. Par ailleurs, le rôle social structurant que jouent les grands pèlerinages dans la mise en place et l’animation des routes a été particulièrement étudié, notamment pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ou pour les routes du ḥajj.
Au-delà de ces questions, la matérialité de la route médiévale était restée insuffisamment abordée 5. En croisant les approches et les différents types de sources écrites ou archéologiques, ce dossier vise à mettre en commun des travaux en cours qui mettent l’accent sur les différentes manifestations de la matérialité de la route : son tracé, son entretien, son rapport au paysage naturel et anthropique, son contrôle et son appropriation politique, les acteurs qui en usent au quotidien, ainsi que les modalités pratiques qui encadrent et régulent sa fréquentation. À dessein, nous avons délaissé tout questionnement de géographie historique pour scruter une route « au ras du sol », envisagée comme un élément de culture matérielle et d’histoire sociale du Moyen Âge.
Interroger la matérialité de la route médiévale ne peut faire l’économie d’une mise en perspective intégrant l’héritage de la romanité. Les différents ensembles politiques et culturels de la Méditerranée médiévale ont hérité de territoires où la route romaine a longtemps constitué un organe structurant et un marqueur déterminant dans le paysage. Des travaux historiques fondateurs – comme ceux de René Dussaud et Antoine Poidebard, en Syrie – ont très tôt noté la continuité des itinéraires de l’époque hellénistique jusqu’à l’époque islamique 6. Suivant l’œuvre pionnière de Pierre Salama, l’infrastructure routière de l’Afrique romaine a longtemps focalisé l’attention des spécialistes de la transition 7. Au-delà de ces exemples emblématiques, on peine à reconstituer le devenir médiéval de la route antique, au gré de la complexité des modalités d’utilisation et d’entretien des réseaux viaires, aussi bien en terre d’Islam que dans le monde latin.
La présomption d’un délabrement généralisé des routes dans les anciens territoires romains, particulièrement ceux faisant désormais partie des terres d’Islam, est un corollaire de la thèse d’Henri Pirenne sur le déclin des échanges méditerranéens au lendemain de la conquête arabe. La remise en cause profonde de ce modèle est aujourd’hui acquise, mais elle a surtout mobilisé des travaux sur les échanges maritimes 8. La place de la route et du transport routier dans la restitution des dynamiques économiques demeure modeste. C’est d’ailleurs le cas de la contribution récente de Chris Wickham sur l’histoire de l’économie méditerranéenne 9. Le titre programmatique de son ouvrage associe le bateau et l’âne, ce qui revient à reconsidérer la part des économies régionales et des échanges internes (passant par la route et par le cabotage de proximité) dans le décollage économique du Moyen Âge central. En remettant en cause le schème de la « révolution commerciale » mue par le dynamisme des cités italiennes, il insiste sur les dynamiques propres aux différentes régions méditerranéennes. Malgré le titre et le grand apport critique de l’ouvrage, l’âne demeure discrètement tapi à l’ombre du bateau et le sujet des routes n’est pas abordé de front.
Au-delà de l’histoire économique, reconsidérer la matérialité de la route implique une meilleure connaissance de sa prise en compte par les pouvoirs politiques. En Orient musulman, l’investissement du califat omeyyade dans l’aménagement des routes en Syrie-Palestine est l’une des manifestations connues de son emprise territoriale, célébrée par un programme épigraphique dont plusieurs bornes milliaires perpétuent encore le souvenir 10. En Iraq et dans le nord de l’Arabie saoudite, l’aménagement de la route du pèlerinage par le califat abbasside a fait l’objet de nombreux travaux depuis les années 1970 11. D’autres recherches ont scruté l’organisation des routes yéménite, syrienne et égyptienne du pèlerinage, notamment les dispositifs d’accueil et le contrôle de l’itinéraire par des réseaux de fortification 12. Concernant l’analyse des itinéraires à l’époque des Croisades, on mentionnera l’étude du tracé et des fortifications de la route de Saladin, au Sinaï, et la publication détaillée de la forteresse de Ṣadr 13.
Dans l’extrémité occidentale des mondes de l’Islam, où les routes du pèlerinage sont moins structurantes dans le paysage, l’évolution du système viaire est principalement abordée dans sa relation avec la géographie de l’urbanisation et l’organisation des territoires politiques. En effet, le contraste est saisissant entre une Africa (devenue Ifrīqiya après la conquête islamique) densément urbanisée et bénéficiant d’un maillage routier important, essentiellement hérité de l’Antiquité, et un Maghreb occidental où l’empreinte de Rome s’estompe, pour se limiter, au nord du Maroc actuel, au triangle reliant Tanger, Sala et Volubilis. Dans un Maghreb morcelé politiquement dès la fin du califat omeyyade d’Orient (en 750 de notre ère), la route est articulée à un réseau urbain polycentrique ; la multiplication des pouvoirs politiques entraîne le développement de nombreuses sphères de polarités géographiques, politiques et économiques. Résolument orientées sur des axes intérieurs, ces routes consacrent la vocation continentale des pouvoirs, même si la navigation, aussi bien commerciale que militaire, n’a jamais cessé sur les rives méditerranéennes du Maghreb. Mais la nouveauté incontestable de cette situation issue de la conquête arabe est l’apparition très rapide, probablement dès la fin du viiie siècle, de nouveaux axes de circulation transsahariens reliant les franges méridionales du Maghreb (où se développent plusieurs pouvoirs locaux, à Siğilmāsa ou Tāhart par exemple) et le sud du Sahara. Ce commerce, inconnu à cette échelle à l’époque romaine – seule la région du Fezzan, dominée par les Garamantes, semble assurer la liaison de l’Afrique romaine et du monde saharien –, implique une transformation dans la configuration des routes. L’aridité du milieu et l’immensité du désert entraînent à la fois une grande flexibilité des itinéraires, et des passages obligés par des stations vitales pour l’approvisionnement en eau ou par les lieux de rassemblement occasionnels des populations nomades. L’apparition des grands empires berbères – almoravide, puis almohade – entraîne une restructuration profonde des réseaux routiers, avec un investissement conséquent dans la mise en place de structures routières (ponts, citernes, réserves alimentaires, sites fortifiés), encadrant particulièrement la circulation des troupes et des différents acteurs étatiques 14.
En al-Andalus, les itinéraires de la conquête du viiie siècle et ceux des grandes campagnes militaires qui ponctuent l’histoire de la péninsule occupent une grande partie des travaux, fondés sur des sources souvent postérieures aux faits décrits, ainsi que sur le registre matériel dans lequel sceaux et monnaies occupent une place importante 15. Des contributions originales comme celles de José Avelino Gutiérrez González permettent d’envisager les moyens mis en place pour freiner l’avancée des conquérants dans le Nord péninsulaire : l’approche archéologique a permis de documenter des obstacles ou des défenses linéaires installées en milieux montagneux, à proximité du passage de cols 16. Si l’entretien et la remise en état du réseau viaire n’ont pas été une priorité des différents gouvernants – une impression sans doute biaisée par le mutisme des sources –, il n’en est pas de même pour ses éléments de franchissement, à savoir les ponts. On dispose pour ceux-ci d’un corpus relativement étoffé, mais sur lequel aucune synthèse n’a été tentée depuis les travaux précurseurs de Leopoldo Torres Balbás dans les années 1940 17. En partie hérités de l’Antiquité, souvent décrits comme des ouvrages inégalables, en partie élevés ex novo pour répondre à des besoins de communication spécifiques (par exemple dans la zone de la ville palatine de Madinat al-Zahra’), ces ponts témoignent des importants investissements engagés par l’État 18. Il semble bien que le régime hydrographique des fleuves principaux (Guadalquivir, Guadiana, Tage, Èbre) ait imposé des travaux de réparation récurrents, parfois attestés par des inscriptions commémoratives 19. Les passages à gué restent pour leur part quasiment méconnus, en dépit de quelques attestations textuelles qui restent sous-exploitées 20.
Les modalités pratiques de l’investissement de la route par les pouvoirs politiques sont un autre angle important de la recherche. En dépit des spécificités régionales et de la différence des acteurs, les pouvoirs médiévaux ont déployé des stratégies comparables, tant en Orient qu’en Occident. Le contrôle de la route commande d’abord une implication active pour assurer la sécurité des voyageurs et des marchandises. Par exemple, les miroirs du prince islamiques font de la sécurisation des routes un devoir du souverain 21. Pour pallier les limites de l’emprise étatique, l’insécurité endémique sur les routes devient l’objet de procédés de régulation sociale où les coupeurs de chemins peuvent devenir, moyennant redevance, les protecteurs des flux de voyageurs et de marchandises. Au carrefour de la prédation et de la co-domination, ces dispositifs relèvent d’institutions diverses, ḥimāya ou ḫifāra en Orient, zṭāṭa au Maghreb 22.
Le contrôle cinétique des territoires est une modalité structurelle de la gouvernementalité médiévale. L’itinérance du pouvoir a longtemps été envisagée à travers l’Itinerarforschung allemande ou l’itinerario ibérique, principalement destinés à la restitution des circulations princières et leur inscription dans les annales d’une trame événementielle 23. Dans cette approche plutôt positiviste, la matérialité de la route intéressait peu. Le renouvellement historiographique récent sur le sujet donne une attention accrue à l’organisation logistique de la mobilité royale, notamment la mobilisation des moyens de transport, l’entretien des routes et l’hébergement temporaire en chemin 24.
L’emprise du pouvoir sur la route implique aussi la continuité de l’acheminement de l’information. Dans ce cadre, la mise en place des réseaux de la poste à chevaux (barīd) constitue une dimension centrale, beaucoup plus connue en Orient (avec les travaux de Jean Sauvaget, Adam Silverstein ou Didier Gazagnadou) qu’en Occident 25.
Sur des segments importants de la route médiévale, particulièrement sur la rive méridionale de la Méditerranée, les mutations de la matérialité de la route sont corrélées aux évolutions des moyens de transport. Dans plusieurs régions qui ont connu l’utilisation du char depuis les temps protohistoriques (du Croissant fertile au Sahara) – usage renforcé par les pratiques grecques et romaines –, la disparition de la roue comme principal moyen de transport ôte toute sa raison d’être à la route carrossable à la romaine. Cette transformation majeure – objet d’une œuvre devenue classique sur le chameau et la roue 26 – n’exclut pas un recours sporadique aux voitures tout au long du Moyen Âge, pour des usages multiples. C’est sur des chariots (‘ağal) que sont transportés les cadavres d’insurgés matés par le pouvoir aghlabide en Ifrīqiya à la fin du ixe siècle 27, de même pour les décombres de maisons détruites à Safi en 1508 28, alors qu’en 1347, la grande expédition du sultan mérinide contre l’Ifrīqiya mobilise cinq cents voitures, désignées sous le vocable de qarrīṭa, pour transporter juristes et commensaux du sultan 29.
Déjà largement utilisé depuis l’Antiquité, de l’Afrique du Nord à l’Asie centrale, le chameau devient l’animal emblématique de la mobilité en terre d’Islam. Grâce à une extension importante de l’élevage, au gré des vagues de migrations nomades (arabes, berbères, turques et plus tard mongoles), et en raison de ses qualités intrinsèques, le chameau supplante ou domine d’autres animaux de bât, particulièrement dans le cadre des circulations à longue distance. Endurant, capable de porter de lourdes charges, le chameau n’a nul besoin de routes pavées ; sa taille et ses qualités de nageur permettent de se contenter de gués pour traverser les cours d’eau. Cette histoire du chameau a fait récemment l’objet d’une publication remarquable 30. Les perspectives stimulantes de ces enquêtes ne manqueront pas d’enrichir la réflexion des médiévistes sur ce sujet.
Si les camélidés sont les représentants emblématiques des grandes circulations médiévales, de l’Asie centrale jusqu’au Sahara et au Sahel, les enquêtes historiques demeurent assez discrètes sur le rôle encore plus grand des équidés. Qu’il s’agisse de la chevalerie ou de la furūsiyya, le caractère élitaire de la culture équestre a le plus souvent associé le cheval à la guerre 31. L’historiographie récente demeure imprégnée par cette tendance et la place du cheval dans le transport quotidien est peu évoquée 32. Il va sans dire que les travaux sur les ânes sont encore moins fréquents 33.
Juchés sur des chameaux ou d’autres montures, les voyageurs forment une société mobile dont la caravane est la forme la plus connue. Certes, très minces sont les chances de retrouver les traces archéologiques d’épaves du désert, comparables à la découverte fortuite de Théodore Monod en Mauritanie, à Maaden Ijafen en 1964, avec ses vestiges de métaux et de cauris de l’Océan indien datables du xie au xiiie siècle 34. Malgré de précieuses contributions, l’histoire de la caravane reste à faire 35. Elle se doit de convoquer une archéologie des textes, notamment littéraires (poésie, relations de voyages), pour donner corps à cette société éphémère, modelée par des sociabilités intrinsèques, société particulièrement précaire aussi, car la mobilité exacerbe les aléas, tant sur le plan des contraintes naturelles (météo, relief, franchissement de cours d’eau) qu’au niveau du risque pesant sur la sécurité des biens et des âmes.
Enfin, bien que nous ne puissions en détailler les apports, les nouvelles méthodologies d’étude occupent une place croissante au cœur des analyses spatiales : appréhender la matérialité de la route est un horizon qui ne peut être atteint aujourd’hui sans une utilisation intensive des méthodes de l’archéogéographie. Le développement des systèmes d’information géographique (SIG) permet, entre autres, de calculer les chemins optimaux (least cost path) qui demandent toutefois à être vérifiés pour appréhender d’autres contraintes géomorphologiques ou historiques non prises en compte dans les modèles prédictifs 36. L’archéogéographie est une autre approche diachronique, tandis que les outils comme la télédétection, les photographies aériennes et les images satellitaires vont bien au-delà de l’identification de sites parfois difficilement accessibles 37.
Ces quelques remarques introductives sont loin d’épuiser les entrées possibles dans la thématique des « structures matérielles de la route médiévale » et elles ne manqueront pas de soulever de nombreuses autres questions, notamment celles que nos compétences aréales ou disciplinaires ne nous permettent pas d’entrevoir. Nous espérons que les sept contributions réunies ici, malgré le tropisme de l’ensemble vers le monde islamique, serviront à mettre en lumière la diversité des situations qui peuvent se poser dans des termes tantôt proches, tantôt éloignés, dans les contextes chrétiens et musulmans. À travers ces études de cas ancrées dans des terrains variés, de l’Auvergne à Siǧilmāsa, au Maroc, ce dossier entend contribuer à l’histoire des formes, usages et mutations des routes médiévales et des acteurs qui les ont façonnées et parcourues.
Yassir Benhima – Université Lyon 2, CIHAM (UMR 5648)
Sophie Gilotte – CNRS, CIHAM (UMR 5648)
Marie-Odile Rousset – CNRS, Archéorient (UMR 5133)
historiographie, route
historiography, road
- 1. Simon Dorso et les communications entre États latins d’Orient (« Délimiter le territoire : réflexions le long de la frontière du royaume de Jérusalem (Galilée, xiie-xiiie siècle) », dans Frontières spatiales, frontières sociales au Moyen Âge, LIe Congrès de la SHMESP, Paris, 2021, p. 211-228) ; Simone Balossino et la trajectoire historique du pont d’Avignon et sa restitution virtuelle (Le Pont d’Avignon. Une société de bâtisseurs (xiie-xve siècle), Avignon, 2021, [voir « Le Pont 3D d’Avignon », en ligne : https://www.patrimoine-environnement.fr/le-pont-3d-davignon/]) ; Robin Seignobos et le franchissement des cataractes du Nil (« La frontière entre le bilād al-islām et le bilād al-Nūba : enjeux et ambiguïtés d’une frontière immobile (viie-xiie siècle) », Afriques, 2 (2010), en ligne : https://doi.org/10.4000/afriques.800) ; Guido Castelnuovo et Éric Thirault sur les liaisons transalpines (G. Castelnuovo, « Tempi, distanze e percorsi in montagna nel basso medioevo », dans Tempi, misure e percorsi nell’Europa del Bassomedioevo, Todi, 1996, p. 211-236 ; É. Thirault, « Archéologie des cols englacés des Savoie », dans ADLFI. Archéologie de la France – Informations, Auvergne-Rhône-Alpes, en ligne : https://journals.openedition.org/adlfi/181179 ; Id., « Itinéraires d’altitude et passage des cols depuis les origines préhistoriques en Savoie », 2023, conférence en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=qbeqqU-4v7E).
- 2. R.-H. Bautier, « La route française et son évolution au Moyen Âge », Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 73 (1987), p. 70-104 ; B. Bodinier éd., Sur la route de Louviers. Voies de communication et moyens de transport de l’Antiquité à nos jours, Louviers, 2008 ; M.-H. Corbiau, B. Van den Abeele, J.-M. Yante, A.-M. Bultot-Verleysen éd., La Route au Moyen Âge. Réalités et représentations, Louvain-la-Neuve, 2020 ; é. de La Vaissière, Asie centrale 300-850. Des routes et des royaumes, Paris, 2024 ; C. Higounet éd., Flaran 2. L’homme et la route, en Europe occidentale au Moyen Âge et aux Temps modernes, Auch, 1982 ; A. Mrabet éd., Le Réseau routier dans le Maghreb antique et médiéval, Sousse, 2016 ; C. Pérol éd., Faire la route (iiie-xxe siècle), Siècles, 25 (2007) ; S. Robert, N. Verdier éd., Du sentier à la route. Une archéologie des réseaux viaires, Les Nouvelles de l’archéologie, 115 (2009) ; C. Raynaud éd., Voies, réseaux, paysages en Gaule, Supplément de la Revue archéologique de Narbonnaise, 2021 ; Routes, chemins et sentiers, L’Émoi de l’histoire, 32 (2010) ; A. G. Walmsley, « Roads, Travel, and Time “Across Jordan” in Byzantine and Early Islamic Times », Studies in the History and Archaeology of Jordan, 10 (2009), p. 459-466 ; M. Watteaux, « L’analyse archéogéographique des réseaux routiers dans la longue durée. Nouvelles approches méthodologique et théorique », dans L. Beauguitte éd., Les Réseaux dans le temps et dans l’espace. Actes de la deuxième journée d’étude du groupe fmr, Paris, 2013, p. 74-100 ; M. Gravel, « À la recherche des routes de l’Empire carolingien », Inflexions, 49 (2021), p. 13-21 ; V. Zaleski, Les Routes de la soie : entre vestiges et imaginaire, Toulon/Gand, 2024 ; S. Zanni, La Route antique et médiévale : nouvelles approches, nouveaux outils, Pessac, 2017.
3
- . Par exemple : G. Le Strange, Palestine under the Moslems. A Description of Syria and the Holy Land from A.D. 650 to 1500, Cambridge, 1890 ; Id., The Lands of the Eastern Caliphate, Mesopotamia, Persia and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur, Londres, 1905 ; A. Musil, Arabia Petraea. A Topographical Itinerary, Arabia Deserta, the Middle Euphrates, Palmyrena, the Northern Nejd, the Northern Hedjâz, Northern Arabia, New York, 1907-1928.
4
- . A. Miquel, La Géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du xie siècle, Paris/La Haye, 1967-1988 ; E. Tixier du Mesnil, Géographes d’al-Andalus. De l’inventaire d’un territoire à la construction d’une mémoire, Paris, 2014.
5
- . Sur l’approche de la route par sa matérialité, voir S. Robert, N. Verdier, « Pour une recherche sur les routes, voies et réseaux », dans S. Robert, N. Verdier éd., Du sentier à la route…, p. 5-8.
6
- . R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique et médiévale, Paris, 1927 ; A. Poidebard, « Les routes anciennes en Haute-Djezireh », Syria, 8/1 (1927), p. 55-65. De 1925 à 1932, Antoine Poidebard utilise l’avion pour ses prospections : La Trace de Rome dans le désert de Syrie. Le limes de Trajan à la conquête arabe, Paris, 1934.
- 7
- . Par exemple J. Desanges et al., Carte des routes et des cités de l’Est de l’Africa à la fin de l’Antiquité, d’après le tracé de Pierre Salama, Turnhout, 2010.
8
- . Par exemple R. Hodges, D. Whitehouse, Mohamed, Charlemagne and the Origins of Europe, Oxford, 1983 ; C. Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, Oxford, 2005 ; C. Picard, La Mer des califes. Une histoire de la Méditerranée musulmane, Paris, 2015.
9
- . C. Wickham, The Donkey and the Boat. Reinterpreting the Mediterranean Economy 950-1180, Oxford, 2023.
10
- . Brève synthèse dans T. Bittar, Pierres et stucs épigraphiés, Paris, 2003, p. 36-39; A. Elad, « The Southern Golan in the Early Muslim Period. The Significance of Two Newly Discovered Milestones », Der Islam, 76 (2009), p. 33-88.
- 11
- . S. al-Rashid, Darb Zubaydah. The Pilgrim Road from Kufa to Mecca, Riyad, 1980 ; B. Finster, « Die Reiseroute Kufa-Sa’ūdī-Arabien in frühislamischer Zeit », Baghdader Mitteilungen, 9 (1978), p. 53-91; D. Whitcomb, « The Darb Zubayda as a Settlement System in Arabia », ARAM Periodical, 8 (1996), p. 25-32 ; B. O’Kane, « Residential Architecture of the Darb Zubayda », dans J. Gonnella, R. Abdellatif, S. Struth éd., Beiträge zur Islamischen Kunst und Archäologie 4, Wiesbaden, 2014, p. 202-219.
- 1
2
- . M. al-Thenayian, An Archaeological Study of the Yemeni Highland Pilgrim Route between San‘ā and Makkah, Riyad, 2000 ; J. Sauvaget, « Les caravansérails syriens du Hadjdj de Constantinople », Ars Islamica, 4 (1937), p. 98-121 ; Id., « Les caravansérails syriens du Moyen Âge I. Caravansérails ayyûbides », Ars Islamica, 6 (1939), p. 48-55 ; Id., « Les caravansérails syriens du Moyen Âge II. Caravansérails mamelouks », Ars Islamica, 7 (1940), p. 1-19 ; K. Cytryn-Silverman, The Road Inns (Khāns) in Bilād
- al-Shām, Oxford, 2010 ; C. Tavernari, « Les routes du Bilad al-Sham au Bas Moyen Âge », L’Émoi de l’histoire, 32 (2010), p. 85-114 ; A. Petersen, The Medieval and Ottoman Hajj Route in Jordan. An Archaeological and Historical Study, Exeter, 2012 ; A. al-Ghabbân, Les Deux Routes syrienne et égyptienne de pèlerinage au nord-ouest de l’Arabie Saoudite, Le Caire, 2011 ; S. Redford, « Caravanserais, Roads, and Routes in Seljuk Anatolia », dans L. Vandeput, S. Mitchell éd., Routes and Roads in Anatolia from Prehistory to the Seljuk Period, Cambridge, 2025.
13
- . J.-M. Mouton éd., Ṣadr, une forteresse de Saladin au Sinaï. Histoire et archéologie, Paris, 2010.
- 14
- . Les routes du Maroc médiéval ont fait l’objet d’un dossier récent : P. Cressier éd., Voies, routes et chemins du Maroc médiéval et d’al-Andalus. Approches comparées, Hespéris-Tamuda, 58/2 (2023). Sur les différentes structures routières reliant la capitale almohade Marrakech, le Nord du Maroc et al-Andalus : D. Sedra, « Sur les traces de l’itinéraire Marrakech-Le Détroit aux vie-viie/xiie-xiiie siècles. Note sur quelques villages et localités d’après les sources arabes », Al-Andalus-Magreb, 16 (2009), p. 249-281 ; C. Allain, « La route impériale de Maroc à Sala au xie et au xiie siècle », Hespéris-Tamuda, 57/1 (2022), p. 205-244 ; P. Cressier, S. Gilotte, « Note préliminaire à l’édition posthume d’un texte de Charles Allain (1920-2001) sur la route impériale de Marrakech à Sala », Hésperis-Tamuda, 57/1 (2022), p. 197-204.
- 1
5
- . Pour une brève synthèse : M. Fierro, A. Molina, « Caminos de al-Andalus », 2020, en ligne :
- ht
- tps:
- //ww
- w.al
- anda
- lusylahistoria.com/?p=1743
.
1
6
- . J. A. Gutiérrez González, « Sobre la conquista islámica del noroeste peninsular : recientes aportaciones », dans Al-Kitāb. Juan Zozaya Stabel-Hansen, Madrid, 2019, p. 261-267 ; F. Hernández Jiménez, « Los caminos de Córdoba hacia Noroeste en época musulmana », Al-Andalus, 32/1 (1967), p. 37-124.
- 1
7
- . L. Torres Balbás, « Crónica arqueológica de la España musulmana VII »,
- Al-Andalus, 5/2 (1940), p. 449-458.
- 1
8
- . A. Vallejo Triano, La ciudad califal de Madīnat al-Zahrā’. Arqueología de su arquitectura, Cordoue, 2010, p. 84-89 ; A. León Muñoz, A. Zamorano Arenas, « El Puente de los Nogales, Córdoba. Contribución al estudio de la infraestructura viaria de Madinat al-Zahra’ », Cuadernos de Madīnat al-Zahrā’, 6 (2008), p. 205-233 ; R. Pinilla Melguizo et al. éd., Caminos y puentes en el entorno de Córdoba, Al-Mulk, 22 (2024).
- 1
9
- . C’est le cas du pont dit d’Alcántara de Tolède, objet de réformes non spécifiées sous la régence d’al-Manṣūr : J. Ma. Rodríguez, J. A. Souto, « De Almanzor a Felipe II : la inscripción del puente de Alcántara de Toledo (387/997-998) y su curiosa historia », Al-Qanṭara, 21 (2000), p. 185-209. Sur le pont de Cordoue et ses avatars : C. Mazzoli-Guintard, « El puente de Córdoba : un puente sin igual », Al-Mulk, 22 (2024), p. 178-181.
- 2
0
- . A. Dumont, Les Passages à gué de la Grande Saône. Approche archéologique et historique d’un espace fluvial (de Verdun-sur-le-Doubs à Lyon), Dijon, 2002 ; Ead., « Quand la route croisait la rivière : histoire et archéologie des passages à gué et des ponts », L’Émoi de l’histoire, 32 (2010), p. 221-247.
- 2
- 1
- . Par exemple al-Māwardī, Tashīl al-naẓar wa ta’ğīl al-ẓafar fī aḫlāq al-malik wa siyasat al-mulk, Beyrouth, 1987, p. 279 ; Ibn Riḍwān al-Mālaqī, Al-Šuhub al-lāmi’a fī
- al-siyāsa al-nāfi’a, Casablanca, 1984, p. 311-316.
- 2
- 2
- . Sur la ḥimāya : C. Cahen, « Notes sur l’histoire de la ḥimāya », dans Mélanges Louis Massignon, Damas, 1956, t. 1, p. 287-303 ; J. Paul, « Ḥimāya Revisited », Annales islamologiques, 54 (2020), p. 83-106. Sur la zṭāṭa et son rôle dans la sécurité des voyageurs au Maroc médiéval et moderne : ‘A. al-Sabtī, Bayna al-zaṭṭāṭ wa qāṭi’ al-ṭarīq. Amn al-ṭuruq fī Maġrib mā qabla al-isti’mār, Casablanca, 2009.
- 2
- 3
- . Y. Benhima, La Fabrique d’un État territorial : le Maroc mérinide (1269-1465), mémoire d’habilitation (sous presse) ; F. Lainé, « L’itinérance des cours (fin xie siècle-milieu xve siècle) : un modèle ibérique ? », E-Spania, 8 (2009), en ligne :
- h
- t
- tps://journals.openedition.org/e-spania/18558
- .
- 24
- . Une production historique considérable existe sur le sujet. Parmi les contributions récentes les plus marquantes : S. Destephen, J. Barbier, F. Chausson éd., Le Gouvernement en déplacement. Pouvoir et mobilité de l’Antiquité à nos jours, Rennes, 2019 ; D. Durand-Guédy éd., Turco-Mongol Rulers, Cities and City Life, Leyde, 2013 ; F. de Paula Cañas Gálvez, Itinerario de Alfonso XI de Castilla. Espacio, poder y corte (1325-1350), Madrid, 2014.
- 25. J. Sauvaget, La Poste aux chevaux dans l’empire des Mamelouks, Paris, 1941 ; A. Silverstein, Postal Systems in Pre-Modern Islamic World, Cambridge, 2007 ; D. Gazagnadou, La Poste à relais en Eurasie. La diffusion d’une technique d’information et de pouvoir. Chine-Iran-Syrie-Italie, Paris, 2013. Sur l’Occident latin : La Circulation des nouvelles au Moyen Âge. Actes du xxive congrès de la SHMESP, Paris, 1995 ; M. Gravel, « Essai sur le temps long des transports avant la motorisation », Revue historique, 707 (2023), p. 511-533.
- 26. R. Bulliet, The Camel and the Wheel, Cambridge (Mass.), 1975.
- 27. M. Talbi, L’Émirat aghlabide 184-296/800-909. Histoire politique, Paris, 1966, p. 287 et 295.
- 28. P. de Cénival éd., Les Sources inédites de l’histoire du Maroc. Série Portugal, Paris, 1934, t. 1, p. 183.
- 29. Opuscule d’Ibn Rušd al-Ḥafīd, publié dans M. Ibn Šarīfa, Tārīḫ al-amṯāl wa
- al-azjāl fī a-Andalus wa al-Maġrib, Rabat, 2006, t. 4, p. 245-256.
- 30. D. Lagut-Labordère, B. Redon éd., Les Vaisseaux du désert et des steppes. Les camélidés dans l’Antiquité (Camelus dromedarius et Camelus bactrianus), Lyon, 2020.
- 31. B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani éd., Le Cheval dans la culture médiévale, Florence, 2015 ; J. Schiettecatte, A. Zouache éd., Le Cheval dans la péninsule Arabique, Arabian Humanities, 8 (2017).
- 32. .Pour un exemple d’approche équilibrée : A. Ropa, T. Dawson éd., The Horse in Premodern European Culture, Berlin/Boston, 2019.
- 33. Pour l’unique synthèse d’envergure sur l’âne : P. Mitchell, The Donkey in Human History. An Archaeological Perspective, Oxford, 2018.
- 34. T. Monod, « Le Ma’aden Ijafen : une épave caravanière ancienne dans la Majâbat
- al-Koubrâ », dans Actes du premier colloque international d’archéologie africaine, Fort-Lamy, 1969, p. 286-320 ; F.-X. Fauvelle-Aymar, Le Rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Âge africain, Paris, 2013, p. 235-243.
- 35. T. Freudenhammer, « Rafica : frühmittelalterlicher Karawanenhandel zwischen dem Westfrankenreich und Al-Andalus », Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 105/3 (2018), p. 391-406.
- 36. Le calcul et la restitution des itinéraires ont été l’un des volets de l’ERC, The Desert Networks Project : L. Manière, M. Crépy, B. Redon, « Building a Model to Reconstruct the Hellenistic and Roman Road Networks of The Eastern Desert of Egypt, a Semi-Empirical Approach Based on Modern Travelers’ Itineraries », Journal of Computer Applications in Archaeology, 4/1 (2021), p. 20-46. Voir les travaux menés par Émilie Comes-Trinidad sur l’apport des SIG dans la restitution des réseaux routiers historiques. Sur les limites des modèles de prédiction automatisés : C. Capel, G. Chung-To, « Essai d’analyse archéologique des réseaux de circulation marocains d’après le “Petit Idrīsī” (xiie siècle) », Hespéris-Tamuda, 58/2 (2023), p. 186-187.
- 37. M. Watteaux, « L’analyse archéogéographique… » ; S. Robert, N. Verdier éd., Dynamique et résilience des réseaux routiers : archéogéographes et archéologues en Île-de-France, Tours, 2014.