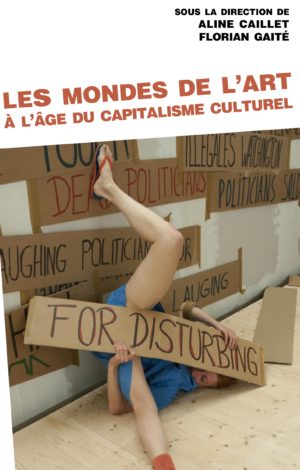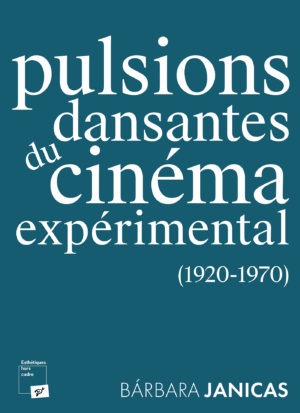Introduction
Le couple problématique de l’instrumentalisation et de l’autonomie de l’art a été au cœur des enjeux de la modernité artistique, des controverses entre partisans romantiques de l’art pour l’art et promoteurs utilitaristes d’un art social au début du 19e siècle, jusqu’à l’opposition esthétique et politique des années 1930-1950 entre abstraction et réalisme socialiste. De ce point de vue, la période 1960-1980 représente un basculement. D’une part, dans le sillage du débat postmoderniste, nombre d’artistes et de théoriciens ont promu une conception de l’art comme activité nécessairement investie dans la réalité vécue, sociale, politique, de sorte que la défense d’une pure autonomie de l’art (telle que la concevait le formalisme le plus strict) semble aujourd’hui impossible. D’autre part, avec la fin de la guerre froide et la globalisation économique, les stratégies traditionnelles d’instrumentalisation politique de l’art (comme moyen direct de propagande ou objet de censure systématique) paraissent, à tort ou à raison, s’être largement raréfiées.
Sous bien des aspects, la question de l’instrumentalisation de l’art s’est déplacée au cours des dernières décennies du terrain politique au terrain économique. L’art contemporain s’est ainsi trouvé de plus en plus impliqué, suite au développement du marché de l’art, dans des opérations financières de grande ampleur, de la part de particuliers, mais aussi d’entreprises, de fonds de placement, etc. Par ailleurs, il fait aussi l’objet de nouvelles formes de sponsoring et de partenariats économiques privés qui visent à produire, outre la traditionnelle légitimation sociale apportée par le mécénat culturel, des bénéfices économiques directs ou indirects. Si l’art contemporain est de plus en plus intégré à des logiques de marketing, les pouvoirs publics sont loin d’avoir délaissé l’idée d’un usage politique de l’art, même si cela prend des formes en apparence plus neutres idéologiquement qu’auparavant. L’investissement dans l’art contemporain et ses institutions (musées, centres d’art, biennales, etc.) s’intègre ainsi à des stratégies globales visant à améliorer l’aménagement, l’attractivité et la compétitivité économique d’un territoire. Ce peut être à l’échelle d’une ville, à l’instar de « l’effet Bilbao » dans les années 1990, ou d’un pays entier, dans une logique de valorisation des creative industries, comme a pu l’illustrer la Cool Britannia des années Blair. L’art peut également être mobilisé par les pouvoirs publics comme vecteur de lien social, et les artistes encouragés à travailler dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, les « quartiers sensibles », etc. Si ces initiatives répondent parfois à un désir d’engagement des artistes, elles posent aussi la question de leur instrumentalisation par certains programmes culturels qui visent moins à résoudre sur le fond les tensions sociales qu’à s’en dédouaner à peu de frais.
Les quatre premiers textes de ce numéro permettent de jeter un regard neuf sur des exemples historiques de confrontation entre démarches artistiques et agendas politiques. Avec « Un rendez-vous manqué : communistes et surréalistes dans les années 1930 », Gwenn Riou revient sur la tentative de mise en relation des objectifs politiques du mouvement surréaliste avec ceux du Parti communiste français, ce qui lui permet de remarquer que dans un contexte politique tendu, les premiers ont été progressivement pris au piège d’une organisation avec laquelle ils ne luttaient pas à armes égales.
Le lien du PCF avec les recommandations en provenance directe d’Union soviétique est connu. En revanche, comme le montre Juliette Milbach, le regard qui est porté sur le réalisme socialiste ou sur les directives adressées aux artistes en Union soviétique a été soumis à plusieurs révisions ces dernières années, notamment à la suite de l’ouverture des archives de l’époque stalinienne. Même si le fait d’évacuer entièrement les questions idéologiques n’est pas simple, ces révisions permettent d’apporter des nuances à la vision traditionnelle qui ne voyait dans l’art en URSS que le simple reflet de la politique d’un parti unique.
Le texte de Lucas Le Texier concerne une période un peu plus récente et un domaine en apparence plus éloigné des questions d’instrumentalisation politique : le free jazz. De fait, si ce genre musical est difficilement assimilable à un quelconque positionnement, en tant que tel, il n’en va pas de même des commentaires qui lui ont été consacrés en particulier dans les revues parisiennes spécialisées au cours des années 1950-60.
Une situation similaire est décrite par Nicolas Ballet, à propos du lien entre musiques industrielles des années 1970-80 et totalitarismes fasciste ou nazi. Ici, contrairement aux années 1930 ou 1950-60, les musiciens concernés n’ont pas été sommés de se positionner politiquement et ils ont librement choisi d’associer leur démarche à une imagerie politiquement connotée. Ainsi que le montre l’auteur, une telle démarche n’est pas sans ambivalence et s’ils ont pu avoir l’ambition de participer à une dénonciation de l’imagerie totalitaire, cela ne s’est pas fait sans une certaine fascination pour les images en question.
Les trois textes suivants traitent de la situation la plus contemporaine. Dans « Désir vert : négocier avec la bonne conscience environnementale », Bénédicte Ramade commence par revenir sur la manière dont, depuis le 19e siècle, la photographie environnementale a été instrumentalisée à des fins politiciennes aux États-Unis, avant de montrer comment ce phénomène est loin d’être terminé, procédant d’une volonté récurrente dans ce pays de diffuser aussi largement que possible une bonne conscience environnementale.
Pour sa part Emmanuel Ferrand constate la fascination de certains artistes contemporains pour les biotechnologies, remarquant que la question de l’instrumentalisation y est ambiguë. En effet, si l’on n’observe pas en général de manipulation grossière du travail des artistes à des fins de promotion des solutions promises par la techno-science, la question se pose toutefois d’une instrumentalisation douce, qui s’accommoderait bien du contenu pourtant revendiqué comme critique des productions artistiques.
Le dernier article, dû à Alexia Volpin, analyse enfin de l’intérieur les phénomènes d’instrumentalisation, à partir de l’étude menée par l’auteur sur les processus décisionnaires ayant accompagné le montage des productions chorégraphiques de deux compagnies actives dans la région Rhône-Alpes.
Le dossier de ce numéro est enfin complété d’un entretien entre Douglas Crimp et François Aubart, où il est question de certaines des questions abordées dans les articles qui précèdent.
Nous publions par ailleurs, un portfolio d’œuvres de Paul Heintz — lequel est, pour la première fois dans l’histoire de Marges, en couleur —, ainsi que quelques comptes rendus d’ouvrages et d’expositions.
Jérôme Glicenstein