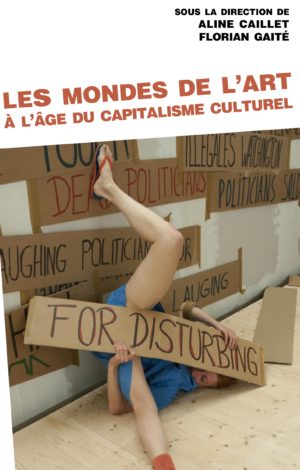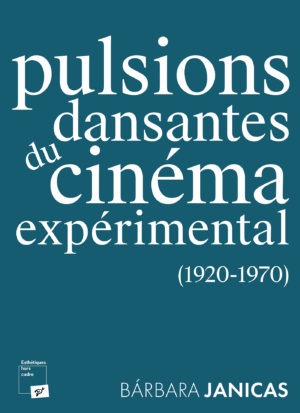À l’origine était le sexe – celui de Johanna Heffernan posant en 1866, jambes écartées, pour le peintre Gustave Courbet. Avant d’être acquise par l’État en 1995, cette représentation du sexe entrouvert de la « belle Irlandaise » appartenait au psychanalyste Jacques Lacan. « Picasso – écrit Pierre Daix – était extrêmement sensible aux figures de femmes de Courbet, particulièrement à ses nus 1. » Il appréciait l’une des plus célèbres toiles érotiques du peintre français, Les Deux Amies (Paresse et luxure), et avait vu L’Origine du monde vers 1954-1955, au moment de son achat par Lacan. Faut-il pour autant établir un lien entre L’Origine du monde et les dernières œuvres érotiques de Picasso ? Certes, si l’on observe par exemple Homme et nu couché, un dessin du 4 septembre 1969, on constate que l’anatomie féminine est dévoilée presque de la même manière que dans le tableau de Courbet.
Pourtant, le réalisme photographique de la vulve peinte en 1866 n’a rien à voir avec le paroxysme iconique et pictural des dernières œuvres de Picasso ; en revanche, il est formellement très proche des photographies obscènes réalisées une dizaine d’années plus tôt par Auguste Belloc, où le sexe s’exhibait déjà dans le cadrage étroit des cuisses écartées 2. Car chez Courbet comme chez Belloc, la blessure faite à la chair provient du cadre lui-même, qui sectionne les cuisses et le tronc pour nous livrer le détail propice à l’exacerbation du désir. En effet, L’Origine du monde montre frontalement ce que la peinture s’était jusqu’alors évertuée à ne pas dévoiler, préférant laisser dans l’ombre, sous une fine étoffe, dans un repli, le « détail » que Courbet décontextualise en l’isolant violemment et en le plaçant en pleine lumière. Le peintre d’Ornans impose donc à la chair féminine la douloureuse coupure du cadre pictural ; quelques décennies plus tard, avec Picasso, le corps est bien entier, mais ce sont les torsions, les déplacements, les hypertrophies qui le rendent douloureux, lorsque les convulsions de la peinture et celles de la chair mêlées nous entraînent bien au-delà des limites du bon goût et du bien peint.
Mais oublions un temps L’Origine du monde, et commençons par le début, le récit de cette expérience picturale que le petit Espagnol a eue, à certaines périodes de sa vie, avec le corps des géantes. Picasso et les femmes, Picasso et la Femme : évitons les clichés. Ces femmes fatales (ou bien ces grandes prêtresses, ces déesses-mères, tantôt Vénus, tantôt Gorgones…) nous intéressent d’abord parce que ce sont des objets – des objets picturaux, des réalités plastiques, des toiles de deux mètres de haut, d’où ces femmes monstrueuses, agressives ou goguenardes, dominent physiquement le spectateur qui leur fait face. Elles nous intéressent aussi parce qu’elles sont situées précisément au centre du conflit, de la tension qui naît de « la présence de la pulsion de mort au cœur même du désir sexuel 3 ». Conflit que Picasso résout à chacun de ses combats contre la toile par cette « somme de destructions » (ce sont ses termes) qui seule lui permet – au terme d’une série de deuils – de retrouver la vie.
Dans l’œuvre, on compte par milliers les toiles, dessins, gravures, sculptures où Picasso représente la femme. Mais de quelles femmes s’agit-il ? Épouses, modèles, compagnes, amies ? Faut-il les singulariser, les identifier ? Là n’est pas notre propos ; en revanche, il est intéressant de constater que deux toiles seulement s’intitulent simplement Femme. Pour les autres, Picasso a pris soin de les adjectiver : Femme accoudée, Femme accroupie avec enfant, Femme à la cigarette, Femme à la guitare, etc. Avec quelques titres qui nous concerneront davantage dans cette étude : Femme dans un fauteuil, Femme nue allongée, Femme nue assise, Femme à l’oreiller… De cette relation qui a duré plus de trois quarts de siècle, Picasso a voulu « exprimer la totalité mentale aussi bien que physique », cherchant – selon Pierre Daix – à « percer le mystère de telle attitude […], de tel charme, d’un instant entrevu d’exaltante beauté 4. »
Face à un tel corpus, ce n’est pas l’« exaltante beauté » qui a retenu notre attention, mais plutôt sa représentation sous les traits de femmes disloquées, monstrueuses – celles où Picasso exaspère la forme, où sa relation au corps féminin se charge de fortes ambiguïtés. Dans Vivre avec Picasso, Françoise Gilot rapporte un propos cynique et provocateur qu’aurait tenu Picasso à propos des femmes : « Il n’y a rien qui ressemble à un caniche autant qu’un autre caniche. Pour moi, il n’y a que deux sortes de femmes : déesse ou tapis-brosse 5. » Vrais ou déformés par le souvenir, les mots rapportés par Françoise Gilot nous semblent pertinents pour traduire la tension qui s’instaure dans l’œuvre de Picasso entre deux pôles de la représentation du corps féminin, entre attraction et rejet, beauté et laideur, réalisme « photographique » et acharnement pictural… Les termes choisis pour le titre principal de cette étude, malgré le caractère réducteur que peut avoir ce genre de formules, renvoient donc à ces ambiguïtés.
Nous avons déterminé plusieurs moments dans ce parcours diachronique, liés à des œuvres (ou des séries) que nous commenterons plus particulièrement. Cette quête d’une femme entre déesse et paillasson 6, nous la ferons commencer en 1907 avec Les Demoiselles d’Avignon ; elle croisera ensuite le chemin de la monstrueuse Olga du Grand nu au fauteuil rouge de 1929, continuera avec les grands nus de la période de guerre – L’Aubade et Nu couché –, avant de se terminer avec les œuvres érotiques des dernières années : la Pisseuse de 1965, la Femme à l’oreiller de 1969, ou bien cette Étreinte de 1972, peinte 65 ans après les Demoiselles. Outre la violence infligée à la forme, ces tableaux ont en commun leurs dimensions : 243,9 x 233,7 cm pour le Bordel d’Avignon de 1907, comme l’appelaient au début Picasso et ses amis 7 ; et pour les autres œuvres, une hauteur ou une largeur de 195 cm.
Les nus isolés – ou les groupes sans présence masculine – sont relativement rares dans les grands formats, ce qui renforce leur signification, à certains moments de tension ou de rupture dans la vie et l’œuvre. Pour ces raisons, le Grand nu au fauteuil rouge du 5 mai 1929 a pris une place toute particulière dans ce travail, car il se situe au terme d’un cycle de déconstructions de la figure féminine, commencé quatre ans plus tôt avec Le Baiser et La Danse. Cette violente dislocation de l’anatomie féminine – cette métamorphose, cette souillure… – transforme Vénus en Gorgone, et la hideuse beauté des nus de cette période nous a amené à nous interroger sur les modes de représentation de Vénus, entre la Renaissance et le xixe siècle. En effet, n’y a-t-il pas, dans la relation des peintres à la figure de Vénus, cette tentation de l’éventration, du viol pictural, que l’on retrouve chez Picasso entre la fin des années vingt et le début des années trente ?
La torture des formes n’était pas sans risques pour l’artiste-bourreau. Il fallait maintenir le monstre à distance. C’est ce que Picasso a fait, en instaurant une dialectique entre peinture et photographie, puis entre peinture et sculpture, que nous essayerons d’analyser. Cette façon d’aborder l’œuvre nous permettra de rester au plus près de la matière picturale, où demeurent les traces d’un conflit jamais résolu. En effet, dans une perspective diachronique, chaque nouveau tableau vient s’inscrire en écho, en contrepoint, en rupture, par rapport aux œuvres qui l’ont précédé : celles que Picasso a peintes sur près d’un siècle, et qui sont ainsi liées à sa propre mémoire ; celles d’autres artistes (Rembrandt, Goya, Ingres, Courbet, Manet, Degas, Matisse… la liste serait longue), qui viennent s’inscrire dans un palimpseste parfois difficile à expliciter.
Mais le conflit s’établit aussi par rapport à l’image du corps : un corps sans visage – Méduses déconstruites, décomposées dans les années vingt par une série de permutations sexe-œil-bouche – ; un corps qui se fait l’écho de la mort qui règne sur l’Europe dans les nus-vanités de 1942 ; un corps absent, que Picasso imagine allongé devant lui, à la fin du mois de décembre 1953, tandis que l’ombre portée de l’observateur solitaire pénètre dans la représentation ; enfin, un corps qui retrouve l’humanité du visage (en l’occurrence, celui de Jacqueline, à partir de 1955), dans des variations érotiques autour de la figure de Baubô. La violence de ces dernières peintures ne provient plus alors du combat contre l’« image corps monstrueuse 8 », mais bien d’un corps à corps avec la peinture, que Guy Scarpetta décrit comme un « engouffrement au cœur du désordre rythmique et charnel dont la peinture est à la fois l’effet et l’analogie 9. »
Ce désir que dévoilent les œuvres ultimes, nous l’abordons à partir d’une grande toile de 80 x 190 cm, intitulée Femme nue allongée, peinte par Picasso durant l’été 1955 pour Le Mystère Picasso, le documentaire de Henri-Georges Clouzot. La présentation du film et l’analyse des 86 plans qui concernent le tableau en question nous ont conduit à une réflexion sur les processus créatifs, picturaux et cinématographiques. Au centre de cette réflexion se trouve le travail de montage, signé Henri Colpi. Car la création de l’œuvre prend place ici dans les ellipses, les intervalles entre les plans qui nous permettent de construire l’image-temps deleuzienne, et de retrouver dans le miroir le peintre amoureux posant ses banderilles sur le corps nu de Vénus.
La liste de ces « monstresses 10 » de deux mètres est, certes, plus longue, surtout pour la dernière période, lorsqu’elles sont associées à l’homme dans de violentes séries érotiques baptisées par euphémisme Le Baiser ou Le Couple, dont les figures se mêlent de telle manière que l’on arrive difficilement à les dissocier. Dans ces toiles, le corps féminin, obscène et convulsé, s’exhibe et se laisse pénétrer, par l’œil, le pinceau, le sexe… Mais c’est aussi dans les dernières gravures (Raphaël et la Fornarina, 1968 ; Degas au bordel, 1971) que les organes sexuels seront le plus ouvertement montrés, lors d’une ultime profanation des corps où le désordre sexuel devient le dernier rempart contre la mort.
Beaucoup de textes ont été écrits sur ces métamorphoses du corps féminin dans l’œuvre de Picasso. Nous ne pouvions cependant pas nous limiter à un état de la question : face à l’abondance bibliographique, une telle synthèse risquait d’être par trop lacunaire. C’est donc sur quelques pistes, moins étudiées, que nous avons fait porter notre réflexion. Nous avons repéré une série de polarités qui s’inversent, dans certaines toiles, à certains moments de l’œuvre. Elles sont la marque d’une complexité d’où émergent tantôt la beauté de Vénus, tantôt la monstrueuse laideur des Gorgones ; tantôt l’harmonie lisse, tantôt la forme contorsionnée ; tantôt la manifestation de ce qui semble être le désir, tantôt la peur… Déesse ou paillasson ? C’est cette tension entre deux pôles contraires et pourtant coexistants, que nous avons testée à différents niveaux : celui d’une confrontation avec quelques mythes structurants, celui d’une rencontre avec l’histoire de l’art, celui d’un corps à corps avec l’image peinte. Au risque de nous y perdre, nous avons essayé de rester au plus près de la toile, d’en explorer les détails, d’en flairer les moindres craquelures pour voir comment le corps féminin, devenu peinture, se met enfin à sentir 11.
1. Pierre Daix, Dictionnaire Picasso, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1995, p. 216-217 (article « Courbet »).
2.Ces photographies sont reproduites dans Sylvie Aubenas et Philippe Comar, Obscénités. Photographies interdites d’Auguste Belloc, Paris, Albin Michel/Bibliothèque nationale de France, 2001.
3.Cette phrase écrite par Guy Scarpetta à propos de L’Enlèvement des Sabines (1962-1963) garde toute sa pertinence pour les œuvres qui nous concernent ici. Guy Scarpetta, L’Artifice, Paris, Grasset, 1988, p. 79.
4.Pierre Daix, Dictionnaire Picasso, op. cit., p. 330-331.
5.Françoise Gilot et Carlton Lake, Vivre avec Picasso, Paris, Calmann-Lévy, 1965 (édition consultée : 1991, p. 77).
6. Nous préférons la forme simple – paillasson – plutôt que celle, composée, de son synonyme tapis-brosse.
7.C’est derrière cette grande toile, presque carrée, que, selon un commentaire de Derain à Kahnweiler, on pensait retrouver un jour Picasso pendu, tant l’incompréhension de ses amis fut grande lorsqu’ils découvrirent le tableau : « C’est la hideur des faces – avait écrit André Salmon – qui glaça d’épouvante les demi-convertis. » André Salmon, « Histoire anecdotique du cubisme », La Jeune Peinture, Paris, 1912.
8.« […] l’artiste développe dans ce cas la grammaire d’une forme autre, en insistant sur sa nature décalée et irréductible à toute norme. Ainsi naît, d’un refus et d’un pari, l’image corps monstrueuse. Le refus, c’est celui d’insérer la figure de l’humain dans les catégories renvoyant à l’imagerie du corps normé. Le pari, c’est l’affirmation que l’image corps la plus proche de la vérité de l’être est non celle que prodigue le corps réalisé mais bien, contre l’évidence, l’image du corps anormal. » Paul Ardenne, L’Image corps. Figures de l’humain dans l’art du xxe siècle, Paris, Éditions du Regard, 2001, p. 380.
9.Guy Scarpetta, L’Artifice, op. cit., p. 75.
10. Jean-Louis Ferrier emploie ce néologisme à propos des toiles peintes en 1927, dans lesquelles Picasso « semble trouver un malin et très pervers plaisir à démanteler l’anatomie féminine » (Jean-Louis Ferrier, L’Aventure de l’art au xxe siècle, Paris, Chêne-Hachette, 1988, p. 266).
11. Certains des chapitres qui suivent ont déjà fait l’objet d’une publication, sous la forme d’actes universitaires, entre 2000 et 2009. Ils ont ensuite été retravaillés pour pouvoir être insérés dans cet ouvrage. Il s’agit des quatre articles suivants : « Le Grand nu dans un fauteuil rouge (1929) : une monstrueuse Vénus dans l’œuvre de Picasso », Les cahiers du GRIHM n° 2, « Images et divinités », GRIMH/GRIMIA, Université Lumière-Lyon 2, 2000, p. 255-263 ; « Picasso au bordel : l’obscénité de l’œuvre ultime », dans Jean-Claude Seguin (dir.), L’Obscène, Lyon, Le Grimh-LCE-Grimia, 2006, p. 161-176 ; « Le corps comme vanité. Les grands nus de Picasso entre 1942 et 1945 », dans Image et Corps, Actes du 5e Congrès International du GRIMH, Lyon, Le Grimh-LCE, Université Lumière-Lyon 2, 2007, p. 353-360 et « Picasso. L’ombre du récit portée sur le tableau (L’Ombre sur la femme et L’Ombre, 1953) », Cahiers de Narratologie, n° 16, mis en ligne le 25 mai 2009, URL : http://revel.unice.fr/cnarra/document.html?id=992.