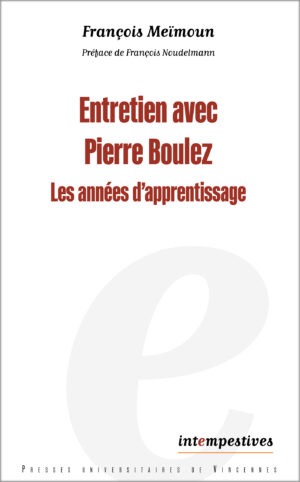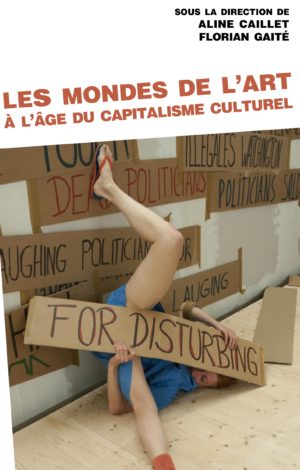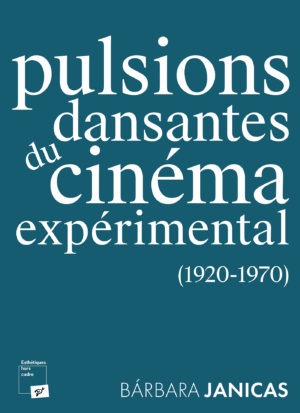Éditorial
Une partielle intégration des pratiques participatives dans les arts visuels contemporains
Introduction
L’art participatif en France date des années 1950[1] et son institutionnalisation des années 1980[2], à travers des partenariats interministériels[3] enjoignant les artistes à travailler avec des non-artistes pour des temps de création. La culture devient ainsi une « dimension de l’action publique » et les politiques de démocratisation culturelle se déploient de façon transversale[4]. Moufida Oughabi[5], Frédérique Patureau et Jérémy Sinigaglia[6] montrent qu’au moins un quart des artistes mènent des « interventions ». Certain·e·s d’entre elle·eux[7] considèrent qu’elles appartiennent à leur travail artistique, donnant lieu à des « œuvres » faisant partie de leur production. Cependant, le « stigmate » du socio-culturel continue de planer sur les artistes travaillant en participatif, soumis à une « double contrainte », les pouvoirs publics demandant aux artistes de « faire du travail social alors qu’ils sont jugés par leurs pairs et les experts dépendants de ces mêmes financeurs sur leurs capacités artistiques[8] ». Ces artistes se trouvent ainsi face à une injonction paradoxale : il faut travailler avec des non-artistes, faire des résidences « de territoire » et des ateliers, tout en conservant une pratique individuelle et surtout ne jamais faire de « l’animation[9] ». Les artistes, comme les institutions culturelles, sont pris·e·s entre d’un côté l’action publique conditionnant leurs financements à « l’inclusion » des « publics » et, de l’autre, leur propre rapport à ces « publics » profanes, en tension entre démocratisation et droits culturels. La participation constituant un tournant général de l’action publique[10], elle amène les acteur·rice·s des mondes de l’art[11] à s’y confronter. Ainsi, à défaut d’être toujours accueilli·e·s dans les salles d’exposition, les artistes peuvent être sollicité·e·s pour « faire participer[12] » des « publics » à leur processus de création[13]. Comment cette injonction paradoxale, consistant à demander aux artistes de susciter de la participation tout en menaçant de les stigmatiser parce qu’iels en font, se matérialise-t-elle ? Comment est-elle gérée et vécue par les artistes ? Face à ce tournant participatif, comment ces artistes (re)composent leurs représentations, pratiques et discours ?
La première partie de cet article traite de l’accueil de ces pratiques au sein ou au seuil d’institutions culturelles, maintenant une distinction entre création solitaire et pratiques participatives, notamment dans leurs modalités d’exposition. L’injonction à la participation crée un contexte dans lequel les artistes doivent négocier, penser et qualifier leurs pratiques. Ce qui nous amène à interroger les frontières et hiérarchisations entre « ateliers » et « art participatif » : les ateliers sont décrits comme une pratique proche de l’« animation », la « médiation », devenues un « passage obligé » pour obtenir des rémunérations ; tandis que l’art participatif relèverait du seul geste artistique. Certain·e·s acteur·rice·s entretiennent l’idée que ces pratiques seraient radicalement différentes, cependant nous voyons dans une seconde partie que l’analyse de leur matérialité et des trajectoires professionnelles permet d’en saisir la porosité. En particulier pour des artistes au tournant des 40 ans, la requalification des « ateliers » en « participation » constitue une façon de négocier du temps de création rémunéré qui, s’il était qualifié d’« atelier », serait jugé comme travail alimentaire. L’institutionnalisation des pratiques participatives semble ainsi n’être que partielle et conditionnée au rejet d’une partie d’entre elles aux frontières de l’art, du côté des « ateliers », opposés au « vrai projet artistique ». Une troisième partie interroge le geste artistique, l’œuvre, l’exposition comme conditions d’accession des pratiques participatives au rang d’art. Plus largement, cet article s’inscrit dans un travail qui ne vise pas à produire un jugement normatif sur l’instrumentalisation des artistes par les pouvoirs publics mais tente plutôt de saisir comment les artistes reçoivent, investissent, pensent, s’approprient ou rejettent l’injonction participative, contribuant ainsi à la production des politiques culturelles et aux mutations des mondes des arts visuels par les transformations de leurs pratiques (se rapprochant en cela d’« opérateurs » du tournant participatif plutôt que « produits[14] »).
Thèse et terrain d’enquête
Cet article s’inscrit dans une recherche plus large menée dans le cadre d’une thèse en sociologie entamée en 2020 à l’université Lumière Lyon 2, portant sur les pratiques participatives dans les arts visuels et contemporains. Je m’appuie sur des données issues d’entretiens avec 51 artistes plasticien·ne·s[15], 17 entretiens avec des représentant·e·s d’institutions culturelles et intermédiaires de l’art, et des temps d’observation participante auprès de 7 artistes. Ces artistes ont entre 23 et 62 ans, sont deux tiers de femmes[16], vivent majoritairement dans des métropoles françaises, ont suivi des études supérieures plutôt en écoles d’art, plus rarement à l’université. Iels sont à des degrés variables de reconnaissance de leur travail ; peu d’entre elle·eux sont représenté·e·s en galeries et une majorité obtient des revenus grâce aux pratiques participatives via des appels à projet et/ou par réseaux professionnels. Enfin, très peu sont passé·e·s par des centres de formation de plasticien·e·s intervenant·e·s ou des cursus universitaires sur la participation.
Précisions sur l’usage du terme « participatif »
« Art participatif » est une appellation employée par des artistes, chercheur·euse·s, commissaires d’exposition, historien·ne·s des arts visuels et contemporains menant ce type de projets (Claire Bishop, Marie Preston, Stéphanie Airaud, Céline Poulin, Paul Ardenne, Estelle Zhong Mengual), avec des débats sur le sens du terme et ce qu’il intègre. D’autres préfèrent les qualificatifs « community based art[17] », « art socialement engagé[18] », « co-création[19] », « esthétique relationnelle[20] », ces différentes terminologies impliquant des distinctions en termes de conceptions, économies et temporalités des pratiques, d’implication des participant·e·s et des artistes et de politisation[21]. Les pratiques de co-création sont définies par Preston, Poulin et Airaud, comme « terrain d’expérimentation et d’expression artistique » politique dans l’ambition de redistribution des rôles sociaux et de mise en œuvre d’un « partage du sensible[22] ». Les participant·e·s co-créateur·rice·s sont les auteur·rice·s de l’œuvre en tant qu’iels « ont investi [leur] subjectivité dans la forme produite » ; les contributeur·rice·s partagent avec l’artiste la responsabilité de la structure et du contenu de l’œuvre[23]. La co-création fonctionne jusque dans la gestion et l’organisation des pratiques, dans une ambition autogestionnaire. Preston indique que cette pratique n’est pas nécessairement dirigée ou menée par un·e artiste et ne se décrète pas en amont, mais qu’il est possible de mettre en place les conditions de son émergence. Elle explique que le groupe peut préexister à l’action mais que « la dynamique mise en place dans la perspective d’une création collective reconfigurera le collectif. Du moins, il faut l’espérer[24] ». La notion d’esthétique relationnelle est rarement convoquée et, comme l’explique Zhong Mengual, implique une conception des relations humaines comme « horizon théorique », puisqu’il s’agit pour l’art relationnel de « représenter » ces relations et non pas de les mettre en place comme « ciment même du projet[25] ». Au-delà du domaine artistique, ces pratiques s’inscrivent dans un tournant participatif global largement impulsé par les pouvoirs publics[26], qui ne concerne pas seulement les mondes de l’art, mais aussi ceux de la recherche, de la santé, du social, des politiques urbaines. Si certaines pratiques artistiques participatives sont antérieures à ces modifications de l’action publique, elles s’insèrent, en France, à notre époque, dans un contexte particulier d’injonction à la participation et une tradition de démocratisation de l’art par l’action culturelle dans lesquels baignent les artistes.
Des soutiens en demi-teinte des institutions culturelles : « exposer les œuvres » d’artistes, « valoriser » les créations participatives
Différents types d’acteur·rice·s sont impliqué·e·s dans les pratiques artistiques participatives : les pouvoirs publics finançant ces projets et leur donnant des orientations[27], des structures culturelles implantées sur un « territoire[28] », des structures sociales partenaires[29] et des participant·e·s souvent proches de ces dernières. Ces types d’acteur·rice·s peuvent varier et les modalités de prises de contact entre elle·eux également (les artistes peuvent prendre en charge les recherches de financements, solliciter elle·eux-mêmes les institutions culturelles partenaires ou être sollicité·e·s). Les partenaires peuvent être choisis en fonction des demandes des artistes, être proposé·e·s ou imposé·e·s par les institutions culturelles ; ou la structure sociale peut faire une demande à un·e artiste ou une institution culturelle[30].
Si les politiques culturelles semblent indiquer une impulsion volontariste vers la participation, leur concrétisation, dans les discours et pratiques des acteur·rice·s du secteur, est plus nuancée. Lors des entretiens, plusieurs artistes formulent une critique des pratiques artistiques participatives sur le plan de leur qualité formelle[31]. Julien, un artiste plasticien de 38 ans, a commencé à mener des pratiques participatives de façon bénévole, en montant un premier projet au sein d’un établissement scolaire. Par la suite, il a nettement développé ce volet au sein de sa pratique, dans le cadre de commandes, résidences et appels à projets. Il explique : « il y a vraiment tout un pan de la création collaborative qui est totalement… à la fois exclu de l’art contemporain mais qui s’auto exclut […] il y a aussi… quand même une faiblesse de certaines de leurs propositions plastiques ». D’autres artistes expliquent que « souvent [c]es artistes ne mettent pas en avant une belle forme », que certaines « formes collaboratives » sont « intéressantes socialement » mais « ne fonctionnent pas plastiquement ».
Si l’objet de ce travail n’est pas de formuler un quelconque jugement sur la qualité esthétique des œuvres réalisées dans des cadres participatifs, il est cependant intéressant de considérer leur insertion au sein d’un contexte, le lieu d’exposition et la scénographie jouant un rôle majeur dans la reconnaissance de ces objets comme œuvres dotées d’une qualité formelle et dans l’identification des pratiques participatives comme de l’art.
Un entretien avec les représentant·e·s d’un centre d’art illustre le paradoxe entre la volonté de soutien de pratiques participatives, et les façons dont elles sont qualifiées et matériellement exposées. Ce centre d’art pilote différentes résidences, instruments du tournant participatif des politiques culturelles visant à susciter la participation des « publics », en particulier pour celles dites « de transmission » ou « de territoire[32] ». Lors de cet entretien, la directrice revendique une importance égale entre les pratiques de « médiation » et la création, et se réfère à la co-création selon la définition proposée par Preston et al. (cf. supra). Elle explique[33] : « je parle du point de vue de l’activité liée au service des publics, ou en tout cas des activités à visée des publics parce que c’est… voilà, c’est comme ça que je situe… Enfin, malgré tout, il faut classer les choses, donc c’est comme ça qu’on situe ce genre de projet, même si c’est plus poreux ». La directrice doit partir, je continue avec le chargé de médiation et lui demande s’il est systématique que les artistes clôturent leurs résidences en exposant dans le centre d’art. Il répond : « les résidences de transmission, effectivement, c’est pas forcément systématique qu’il y ait une exposition », parle d’un artiste en résidence et évoque une vitrine appartenant au centre d’art, située dans l’espace public : « la restitution de cet artiste, pareil, c’est pas vraiment une exposition, parce que c’est dans cette espèce de vitrine, qui est un espace d’expo, mais pas vraiment une salle d’expo type white cube. Donc il y a une espèce de… c’est… espace vitrine, c’est plutôt pour valoriser, faire de la valorisation, plutôt que de l’exposition, même si c’est un peu la même chose (rire). C’est un peu trouble à cet endroit-là aussi. Parce que c’est quand même une exposition en soi, en fait. Il y a un rendu qui est fait, il y a un public qui va passer […] c’est peut-être là-dessus que c’est différent, par rapport au statut de l’œuvre, c’est que c’est une œuvre effectivement collective, et pas vraiment un projet singulier de l’artiste dans le cadre d’un solo show ».
Le discours est ainsi différent selon les acteur·rice·s et leur rôle au sein de l’institution. La directrice revendique une conception politique de la participation proche de la co-création, tout en associant ces pratiques au service spécifique des « publics ». Dans le discours du responsable du service des publics, on retrouve ce même trouble, en tension entre reconnaissance de ces pratiques comme art, puisqu’il s’agit de les exposer, et leur rejet au seuil de l’institution. Il s’agit ainsi d’« exposer » les œuvres réalisées par des artistes professionnel·le·s et de « valoriser » les créations réalisées dans le cadre de pratiques participatives. Ainsi, au-delà du discours accueillant la participation comme une pratique légitime, l’institution et ses représentant·e·s maintiennent une frontière entre pratiques participatives et pratiques individuelles, tout en ayant des difficultés à expliciter ce maintien.
Ce parti pris recoupe d’autres types de pratiques relevées dans différentes institutions culturelles françaises : des œuvres réalisées en participatif exposées dans un espace externe au centre d’art, dans l’entrée d’un musée, sous une scène de théâtre ; avec des temps d’exposition souvent plus courts, en lisières des programmations. Ces choix marquent une tension dans les discours de leurs représentant·e·s et des artistes : les pratiques artistiques participatives seraient socialement souhaitables, esthétiquement enthousiasmantes ou simplement tolérées, selon les lieux et les acteur·rice·s, mais il est encore difficile de considérer qu’elles puissent produire de l’art. Les artistes en résidences de création ont des solo show et les artistes travaillant en participatif obtiennent des expositions au seuil des institutions, dans des espaces qui ne bénéficient pas de la même reconnaissance symbolique. Il est par ailleurs intéressant que cette reconnaissance en demi-teinte ne soit pas limitée à des institutions culturelles ancrées dans des approches classiques de l’art, mais aussi paradoxalement au sein de structures se référant à la co-création, à l’éducation populaire et aux droits culturels.
Les entretiens révèlent par ailleurs, tant dans les discours des artistes que des intermédiaires de l’art, des césures discursives entre les types de pratiques. Tandis que Preston travaille à faire reconnaître les liens entre éducation populaire et co-création[34], la distinction avec l’animation socio-culturelle demeure une constante pour une majorité des artistes de cette enquête, et d’autres acteur·rice·s des mondes de l’art. Cette distinction peut se situer, dans les discours des artistes, sur deux plans : le rejet de l’animation socio-culturelle pour éviter les effets de stigmate des pratiques non-artistiques ; ou plus rarement, la distinction entre l’éducation populaire comme projet politique d’émancipation individuelle et collective, et l’animation socio-culturelle perçue comme dégradation de l’éducation populaire en outil ayant perdu son ambition politique initiale. La socialisation professionnelle des artistes semble être fondatrice de cette distinction avec l’animation, le déploiement d’une singularité et d’une auctorialité dans le geste artistique, étant au cœur des formations supérieures en art[35]. Lors d’un entretien, la coordinatrice d’une formation supérieure artistique explique ainsi que, pour des interventions en écoles, l’artiste doit « proposer à l’enseignant un axe de travail en relation avec sa recherche personnelle. Et l’artiste est invité d’abord parce qu’il est artiste, non pas parce qu’il est intervenant ». On comprend que la centralité du statut d’artiste est essentielle pour contrer le « stigmate[36] », les artistes travaillant en participatif voyant régulièrement leurs travaux renvoyés du côté de l’animation, ce que raconte Julien : « il doit y avoir 3 ou 4 commissaires d’exposition qui viennent à l’atelier […] je prends le temps de leur présenter les créations […] leurs premières remarques à la fin de la présentation, c’est vraiment me dire ‘mais ça c’est de l’animation socio-cul, ça nous intéresse pas’, et… j’avoue que les bras m’en sont vraiment tombés. […] en gros, t’es artiste, mais parfois pour gagner ta vie t’es obligé de faire de l’éducation artistique et culturelle, et donc en fait pour eux, ça correspondait à ça ».
Julien distingue ses pratiques de « création collaborative » des ateliers qu’il mène. Les premières sont, selon lui, souvent synonymes de temps long, dans lequel les participant·e·s et lui sont « tous chercheurs », les pratiques donnant lieu à la production d’une œuvre finale. Les « ateliers », au contraire, mettent Julien dans une position d’enseignant, ces ateliers étant « plus circonscrits », avec des « objectifs évidents et clairement définis », sans œuvre finale. Ainsi la réduction, par des commissaires d’exposition, d’une « création collaborative » à une pratique d’atelier associée à l’éducation artistique et culturelle, gomme une distinction qui, dans le discours de Julien, est essentielle.
La multiplication des espaces de participation implique que de nombreux artistes « font des ateliers » dans le cadre de résidences ou plus ponctuellement, ce qui accroît la concurrence entre artistes. En plus de la proximité, dans les imaginaires, des « ateliers » avec l’animation socio-culturelle, la question économique est centrale dans les discours, les ateliers étant d’abord décrits comme sources de rémunérations. Cette recherche de rémunération hors de la pratique artistique centrale peut être associée aux débuts de carrières, comme l’explique Christine, responsable pédagogique en école d’art : « tout artiste qui n’a pas encore la notoriété nécessaire pour pouvoir avoir une galerie et vendre son travail, donc survivre, est bien obligé de faire un boulot à côté, donc tout jeune artiste passe par un travail dans des écoles, dans des lieux comme ça, où il va organiser des ateliers, des choses comme ça, ça n’en fait pas un artiste dont le travail est participatif, c’est deux choses complètement différentes. Et les artistes dont le travail est participatif ne font pas des choses pour gagner de l’argent mais c’est leur attitude artistique ».
Dans cet entretien, Christine opère, comme l’explique Julien, une partition entre les « ateliers », qui serviraient à obtenir des rémunérations le temps que la notoriété prenne le relai et qui relèveraient de la contrainte (les artistes sont « bien obligés de faire un boulot à côté ») ; et de l’autre, les artistes dont « l’attitude artistique » est participative et qui « ne font pas ces choses pour gagner de l’argent ». En outre, cette distinction crée une hiérarchie, « l’attitude artistique » prévalant sur la survie économique. On trouverait ainsi d’un côté les artistes-intervenant·e·s contraint·e·s de faire des ateliers pour « survivre » et, de l’autre, des artistes dont la motivation serait « l’attitude artistique » participative, qui exerceraient leur travail loin de ces considérations économiques. Cependant, si la pluriactivité est plus courante chez les moins de 40 ans, elle demeure pratiquée par près de la moitié des artistes[37]. La distinction entre « attitude artistique » et économie s’inscrit ainsi dans une conception romantique situant les artistes hors d’enjeux financiers qui, pourtant, conditionnent largement leurs pratiques.
Au-delà de l’« attitude artistique » : des réalités matérielles complexes
Afin de saisir la complexité des pratiques participatives et des trajectoires des artistes qui les mènent, il est essentiel de réancrer « l’attitude artistique » dans une matérialité des pratiques. D’une part, certain·e·s artistes ne souhaitent pas ou ne peuvent pas être représenté·e·s par des galeries[38]. D’autre part, Séverine Marguin montre que l’échéance des 40 ans constitue une étape majeure dans les carrières artistiques, ce tournant incarnant un « âge limite de prétention à la réussite[39] ». Ainsi si cette « émergence » n’a pas lieu suffisamment tôt, il est nécessaire de trouver des moyens de subsistance pour rester artiste[40]. Les jeunes artistes font donc bien des « ateliers », mais les plus de 40 ans aussi, puisque ces ateliers constituent un moyen de maintien dans la carrière[41].
Par ailleurs, les discours d’artistes et intermédiaires de l’art faisant la distinction entre artistes qui font des « ateliers » pour l’argent d’un côté et artistes travaillant en « collaboration dans l’espace social » parce que c’est leur « démarche » de l’autre, tendent à une polarisation rejetant dos à dos des artistes qui, pourtant, sont pris·e·s dans les mêmes problématiques, des négociations permanentes entre leurs pratiques et leurs discours, avec les institutions culturelles et leurs financeurs. Émilie, une artiste de 43 ans dont le travail est reconnu comme participatif et qui bénéficie d’une reconnaissance de la part de différentes institutions culturelles[42], explique en entretien que les « ateliers » sont des « laboratoires » pour des projets avec plus d’ampleur, ce qui permet d’éviter qu’ils ne soient « que de l’alimentaire ». Pour Émilie, les ateliers constituent ainsi des phases de démarrage et de recherche pour les projets d’art participatif, eux-mêmes pris dans des considérations économiques, ce qu’elle mentionne pendant l’entretien en relatant par exemple « quand j’écrivais les dossiers pour payer les taxes du [projet précédent] ». Lors de la résidence d’une autre artiste, Bérénice, au sein d’un centre d’art, je lui demande si elle avait déjà des pratiques collectives quand elle était en école d’art, elle me répond qu’elle a commencé à en avoir « quand [elle a] perdu [son] atelier ». L’art participatif n’est ainsi pas qu’une affaire de geste artistique, mais bien une pratique articulée à des négociations entre des nécessités économiques et professionnelles.
L’analyse des entretiens pointe par ailleurs l’incidence de l’avancée dans la carrière sur la qualification des pratiques. Julien, artiste évoqué plus haut, mène des projets en participatif depuis longtemps, mais il opérait une distinction entre son travail et les pratiques qu’il qualifie maintenant de « collaboratives » : « il y a eu aussi un temps de… d’acceptation dans le sens où, comme le milieu artistique m’a renvoyé plusieurs fois que les travaux collaboratifs c’était de l’animation socio-culturelle et que c’était pas de l’art, je pense que j’ai mis du temps en fait avant de… m’autoriser à… communiquer dessus pleinement et entièrement comme un travail artistique. ». Par ailleurs, Julien est arrivé à la fin d’un contrat d’enseignement qui lui permettait de mener sa pratique artistique en parallèle. L’arrêt de l’enseignement lui a permis de « redevenir artiste à temps plein » et visibiliser ses pratiques collaboratives, occupant maintenant une place centrale dans son travail. Inès, une artiste de 37 ans, évoque la porosité entre pratique individuelle et pratique collective, et la façon dont les « ateliers » peuvent aisément devenir « ce qu’on crée » : « c’est pas à la base de mon travail artistique, et… ça le devient de plus en plus parce que… par exemple quand on passe beaucoup de temps à… faire ces projets de co-création, au final ça devient ce qu’on crée, parce qu’on a moins de temps pour faire des créations personnelles et du coup on a aussi l’impression que c’est ce qu’on crée, ça peut être assez troublant… ».
Lara, artiste de 34 ans, explique que les ateliers deviennent son travail artistique « à condition que ce soit cohérent avec [sa] pratique », cohérence négociée avec l’expérience et une relative notoriété. Elle précise : « maintenant, je donne des conditions et je mets les pieds dans le plat. Avant, j’étais beaucoup trop timorée et polie, et j’avais tellement peur de ne pas avoir de travail tout simplement que j’étais juste… (rire) je ne disais rien. »
Enfin, si un mouvement de fusion entre pratiques solitaires et pratiques participatives peut s’opérer au tournant des 40 ans, le contraire peut avoir lieu, dans une stratégie de légitimation de son travail, tout en conscience de la porosité entre ces pratiques : Sophie est une artiste de 46 ans qui, dès le début de sa carrière, y compris pendant ses études en école supérieure d’art, a développé un travail qu’elle qualifie de « collaboration ». Elle raconte avoir été particulièrement confrontée au mépris des pratiques participatives dans les mondes de l’art, ayant commencé au début des années 2000. Elle se sent « rarement légitime » dans ses « tentatives pour être reconnue » au sein des mondes de l’art contemporain institutionnel, et explique avoir commencé à distinguer ce qu’elle qualifie de projets d’Éducation Artistique et Culturelle de son propre travail, face au mépris des pratiques participatives : « ça glisse hyper vite, en fait, je trouve… d’une catégorie à l’autre […] c’est des catégories aussi que je me suis fabriquée pour… pour garder mon orgueil, quoi, face à des gens qui me disaient parfois, “ah oui, mais c’est quoi ton vrai travail ?”, tu vois, et de pouvoir dire, “ah bah là, ça c’était EAC, et puis là, c’était un projet à moi”, alors qu’en vrai, j’étais dans le flot du boulot avec un grand plaisir, quoi, aux deux endroits ».
Dans les entretiens avec ces artistes, des considérations à la fois économiques, professionnelles, temporelles, de reconnaissance s’entremêlent à des interrogations sur leurs pratiques de création, leur sens plastique et social. Ainsi, malgré des discours clivant les pratiques, les artistes manifestent des formes d’adaptation à des problématiques matérielles, qui rencontrent des enjeux esthétiques et politiques, orientent et façonnent leur façon de faire de l’art. Ces artistes ne se contentent ainsi pas de « faire le job[43] » ou de donner des cours en les présentant comme des « situations de création collective[44] », mais repensent leurs pratiques dans une logique participative. Les pratiques participatives résultent ainsi de négociations entre des aspirations initiales et la réalité des mondes de l’art, pouvant donner lieu à une requalification de pratiques jugées alimentaires plus tôt dans la carrière et réinvesties, au tournant des quarante ans, de « nouveaux sens sociaux[45] ».
Le geste artistique et l’œuvre, éléments centraux de distinction avec les « ateliers »
Les pratiques participatives peuvent donner lieu, dans certains cas, à un objet matériel réalisé collectivement (une sculpture, un film, un dessin, une fresque) et/ou des objets matériels dont l’accumulation fait œuvre tout en racontant le processus (les traces d’un atelier d’écriture auxquelles s’ajoutent des impressions grand format et une vidéo, une édition, par exemple) et/ou des objets immatériels (une performance, tout le processus de rencontre, les discussions). Selon les artistes, l’œuvre peut être la production finale du projet ou, dans une logique d’œuvre dialogique, processus ou protocole, elle peut être ce qui émerge dès la première rencontre et dont la trace peut être une édition. Pourtant, en dépit de la diversité des productions qui ressortent des pratiques participatives et de l’hypothèse formulée par Zhong Mengual de l’art participatif comme « révolution du point de vue des matériaux, des médiums et des formes que cela fait entrer dans le champ de la création artistique et de l’histoire de l’art […] au même titre que les ready-made ou la performance[46] », toutes les institutions culturelles n’ouvrent pas leurs portes pour exposer ce type de créations, ce qui contribue à amener les artistes à cliver leurs pratiques. Dans ce contexte, l’œuvre peut jouer un rôle essentiel. En effet, quand Julien évoque certains projets menés avant son « tournant » collaboratif, il parle lui aussi d’« ateliers », qu’il distingue des pratiques collaboratives, à partir de plusieurs critères : d’un côté, les pratiques collaboratives permettent des modalités de participations multiples, par des participant·e·s qui sont au même niveau que l’artiste dans le processus créatif, artiste qui, cependant, conserve des compétences propres. La création collaborative permet un enrichissement mutuel issu de la recherche collective. En revanche, les ateliers mettent Julien dans une position d’enseignement, il explique « c’est comme si j’étais prof » puisque le projet est plus circonscrit, les objectifs plus évidents et clairement définis. Par ailleurs, les ateliers ne donnent pas lieu à une œuvre, tandis que les projets collaboratifs permettent, directement ou par la suite, la création d’un objet artistique.
Lara, évoquée plus tôt, raconte un projet mené au sein d’une école primaire en partenariat avec un centre d’art, dans le cadre d’un CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique). Elle explique que le projet avait été lancé avec un enseignant qui avait été muté, et qu’elle s’était donc trouvée avec des enseignant·e·s qui n’avaient pas choisi de travailler avec elle et qui ne s’étaient pas du tout mobilisés : « un jour, [les profs] me plantent. Je devais installer la restitution, parce que pour moi, c’est très important de mettre ça en espace, et ils m’avaient plantée. […] en gros, ils aimaient bien que je vienne dans leur classe et on faisait un peu atelier dessin, et en fait ils n’étaient pas sur un truc de projet, donc il y a une forme de mépris sur le fait qu’ils ne comprennent pas que c’est censé prendre plus d’ampleur, que c’est censé avoir une cohérence, qu’il y a une restitution à la fin […] pour moi, le projet il va jusque-là […] Sinon, j’appelle ça vraiment faire le zouave en fait, c’est vraiment, ils me prennent pour un guignol. J’occupe un espace-temps loisir, pour eux ».
Dans les entretiens, le triptyque « animation », « atelier » et « pratique collaborative – participative – co-création » ressort constamment, avec des lignes de distinction qui se croisent et des frontières à la fois mouvantes et poreuses. Les « ateliers » ancrent les artistes dans un imaginaire à la fois artisanal, technique, d’amusement et de loisir, qui tire du côté de l’animation socio-culturelle et des questions d’économie du travail. En revanche, la « collaboration », la « co-création » et « l’art participatif » situent les artistes du côté de la recherche, de l’intellect, de la cohérence d’une démarche, renforcée par la production d’une œuvre, sorte de gageure qu’il y a bien eu démarche artistique. Autrement dit, avec les mots d’Émilie : « ce n’est pas un atelier ludique, on fait une œuvre ! ».
Conclusion
Les politiques publiques incitant les institutions culturelles et les artistes à la mise en place de pratiques participatives contribuent à façonner les pratiques contemporaines dans les arts visuels. La prolifération des financements pour la participation accroit la concurrence entre artistes et renforce la constitution de l’animation comme « menace identitaire[47] ». Une hiérarchie entre les pratiques se dessine, et la centralité de la « démarche », de « l’attitude » et du geste artistique constituent des conditions essentielles pour être rattaché à l’art, jugé supérieur aux « ateliers », trop proches de l’animation pour constituer une démarche créative légitime. Les artistes se trouvent ainsi en tension entre les mythologies autour de l’artiste créateur solitaire[48] ; des réalités matérielles de carrières et de financements ; et des enjeux croisant des questions esthétiques et politiques concernant le rôle des artistes dans la société et le sens de leurs pratiques. Les artistes apprennent à négocier avec les catégories, produire des discours segmentant leurs pratiques de façon à en légitimer certaines et à en taire d’autres, en adéquation avec leurs interlocuteur·rice·s. Comme le relève Quercia pour le domaine du théâtre, « loin d’accepter et se conformer passivement au “rôle social” qui leur est assigné par les pouvoirs publics, les metteurs en scène “endossent” leur rôle d’intervenants artistiques en l’ajustant à un ensemble d’aspirations, compétences et dispositions dont ils sont porteurs[49] ». Les artistes redéployent leurs pratiques dans un maillage entre travail solitaire et participatif, cette mutation s’accompagnant de productions de discours sur le sujet, leur permettant de « renforcer leur identité professionnelle[50] ». L’« art socialement engagé », la « co-création », l’« art participatif » deviennent des horizons esthétiques pour les artistes, une démarche de création qui se construit dans le temps et, comme le dit une artiste de l’enquête, une « stratégie » permettant de s’inscrire dans le sillage d’artistes acceptés au sein d’institutions culturelles. Si certain·e·s semblent distinguer ces catégories d’art et d’ateliers, d’autres en relèvent la porosité et le caractère instrumental. Les pratiques et discours se construisent tout au long de la carrière, la requalification des pratiques participatives en art arrivant, pour une partie des artistes de l’enquête, au tournant des 40 ans. Il est possible que les jeunes artistes sortant d’études supérieures aujourd’hui mènent davantage ce type de pratique, avec un entremêlement plus précoce entre travail individuel et collectif, dans un contexte de professionnalisation, de multiplication et de légitimation partielle de ces pratiques[51].
Tecla Raynaud
[1] Stéphanie Airaud (sld), Participa(c)tion, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL, 2014 ; Paul Ardenne, Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation, d’intervention, de participation, Paris, Flammarion, 2009.
[2] Estelle Zhong Mengual, La Communauté de singularités. Réinventer le commun dans l’art participatif britannique (1997-2015), thèse de doctorat en histoire de l’art, Institut d’Études Politiques de Paris, 2015.
[3] Le premier protocole d’accord, entre Affaires culturelles et Éducation nationale, date de 1983.
[4] Françoise Liot, « Collectifs d’artistes et action publique », dans Marie-Christine Bureau, Marc Perrenoud, Roberta Shapiro (sld), L’Artiste pluriel. Démultiplier son activité pour vivre de son art, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, p. 51-64, p. 55.
[5] Moufida Oughabi, « Ne vivre que de son activité de plasticien : une condition exclusive pour affirmer sa passion au travail ? » dans Nathalie Leroux, Marc Loriol (sld), Le travail passionné. L’engagement artistique, sportif ou politique, Paris, Érès, 2015, p. 57-88.
[6] Frédérique Patureau et Jérémy Sinigaglia, Artistes plasticiens : de l’école au marché, Paris, ministère de la Culture-DEPS / Les Presses de Sciences Po, 2020.
[7] Cet article est rédigé en écriture inclusive avec point médian, certains pronoms sont écrits comme suit : celle·eux, elle·eux, iels.
[8] Serge Proust, « La pluriactivité dans une économie administrée : le théâtre public », dans Marie-Christine Bureau, Marc Perrenoud, Roberta Shapiro (sld), L’Artiste pluriel, op. cit., p. 95-108, p. 104-105.
[9] Voir aussi Francesca Quercia, Les Mondes de l’action théâtrale. Une comparaison dans les quartiers populaires en France et en Italie, thèse de doctorat en science politique, Université Lumière Lyon 2, 2018.
[10] Alice Mazeaud, Magali Nonjon, Le marché de la démocratie participative, Vulaine-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2018.
[11] Howard S. Becker, Les Mondes de l’art (1988), Paris, Flammarion, 2010.
[12] Marion Carrel, Faire participer les habitants ? Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires, Paris, ENS Éditions, 2013.
[13] Pour certain·e·s artistes, l’œuvre commence dès la première rencontre, pour d’autres c’est un objet produit lors de cette rencontre ou a posteriori.
[14] Alice Mazeaud, Magali Nonjon, 2018, op. cit, p. 16.
[15] Les acteur·rice·s et lieux cités sont anonymisé·e·s.
[16] Patureau et Sinigaglia font état d’une lente féminisation des artistes et, en 2016, d’une population quasi paritaire. Voir Frédérique Patureau et Jérémy Sinigaglia, Artistes plasticiens, op. cit. Sur les limites de cette féminisation, voir Mathilde Provansal, Artistes mais femmes. Une enquête sociologique dans l’art contemporain, Lyon, ENS Lyon-INRP, 2023.
[17] Grant Kester, Conversation Pieces. Community and Communication in Modern Art, Berkeley, University of California Press, 2004. Pour une analyse d’un débat sur cette appellation, voir Marie Preston, Inventer l’école, penser la co-création, CAC Brétigny, Tombolo Presses, 2021.
[18] Pablo Helguera, Education for Socially Engaged Art : A Materials and Techniques Handbook, New York, Jorge Pinto Books Inc., 2011 ; Licia Demuro, « École, prison, entreprises… : les artistes interviennent dans l’espace social », Le Quotidien de l’art, n° 2835, 23 mai 2024.
[19] Marie Preston, op. cit. ; Marie Preston, Céline Poulin, Stéphanie Airaud (sld), Co-création, Brétigny-sur-Orge, CAC Brétigny & Éditions Empire, 2019.
[20] Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon, Les Presses du réel, 1998.
[21] Voir l’échelle d’Ève Lamoureux, Nathalie Casemajor, Danièle Racine, « Art participatif et médiation culturelle. Typologie et enjeux des pratiques », dans Cécile Camart, François Mairesse, Cécile Prévost-Thomas, Pauline Vessely (sld), Les Mondes de la médiation culturelle, volume 1, Approches de la médiation, 2016, p. 171-184.
[22] Marie Preston et al. (sld), op. cit., p. 24 ; Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.
[23] ibid.
[24] Marie Preston, op. cit. p. 232.
[25] Estelle Zhong Mengual, op. cit., p. 70.
[26] Guillaume Gourgues, « Participation : trajectoire d’une dépolitisation », Projet, C.E.R.A.S, n°363, 2018/2, p. 21-28 ; Alice Mazeaud, Magali Nonjon, op. cit.
[27] Type de sujets, lieux d’intervention, participant·e·s, modalités de travail.
[28] Ces partenariats s’inscrivent dans une conditionnalité participative entérinée dans les politiques culturelles à partir de la loi LCAP du 7 juillet 2016.
[29] Établissements d’enseignement ou de formation, hôpitaux, ehpad, centres d’hébergement, instituts médico-éducatifs ou sociaux, prisons, centre sociaux, MJC, associations d’éducation populaire, associations d’animation.
[30] Voir par exemple le protocole des Nouveaux Commanditaires créé par François Hers en 1990 pour inverser la logique de commande publique artistique.
[31] Voir Claire Bishop, Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Londres, Verso, 2012.
[32] Sur l’évolution des résidences depuis la circulaire de 2006 : Direction générale de la création artistique/Service de l’inspection de la création artistique, rapport SIE 016, « La résidence d’artiste, un outil inventif au service des politiques publiques », 2019.
[33] Ma question est la suivante : « Vous parlez de co-création et de projet donc “100% co-création”, “intervention” et “expérimentation plastique”, est-ce que vous voudriez bien me parler un peu de ça ? C’est-à-dire comment vous vous positionnez en tant que centre d’art sur ce type de pratique ? Qu’est-ce que vous entendez par là ? ».
[34] Marie Preston, op. cit.
[35] Françoise Liot, Le Métier d’artiste, Paris, L’Harmattan,2004, p. 27-28.
[36] Serge Proust, op. cit.
[37] Frédérique Patureau et Jérémy Sinigaglia, op. cit.
[38] ibid. ; Françoise Liot, op. cit.
[39] Séverine Marguin, « Les temporalités de la réussite : le moment charnière des quarante ans chez les artistes d’art contemporain », SociologieS [en ligne], 2013.
[40] Zoé Haller, « Rester plasticien quand la notoriété ne fait plus partie du champ des possibles », Recherches sociologiques et anthropologiques, n° 50-2, 2019, p. 147-165.
[41] Serge Proust, op. cit., p. 95-108 ; Francesca Quercia, op.cit.
[42] Aide Individuelle à la Création, 1% artistique, soutiens de la DRAC. Elle ne souhaite pas être représentée par une galerie.
[43] Marc Perrenoud, Géraldine Bois, « Artistes ordinaires : du paradoxe au paradigme ? », Biens Symboliques, 2017, n° 1.
[44] Frédérique Patureau et Jérémy Sinigaglia, op. cit, p. 174.
[45] Marie Buscatto, Cécile Ferro, « Vivre du théâtre d’entreprise. Du compromis stratégique à l’exercice d’un art recomposé », Recherches sociologiques et anthropologiques, 2019, n° 50-2, p. 123-146.
[46] Estelle Zhong Mengual, op. cit., p. 443-444.
[47] Moufida Oughabi, op. cit., p. 88.
[48] Françoise Liot, op. cit.
[49] Francesca Quercia, op. cit., p. 15.
[50] Françoise Liot, op. cit., p. 56.
[51] Je remercie Noam Alon et l’équipe de Marges pour leur accompagnement et Camille Hamidi pour ses remarques.