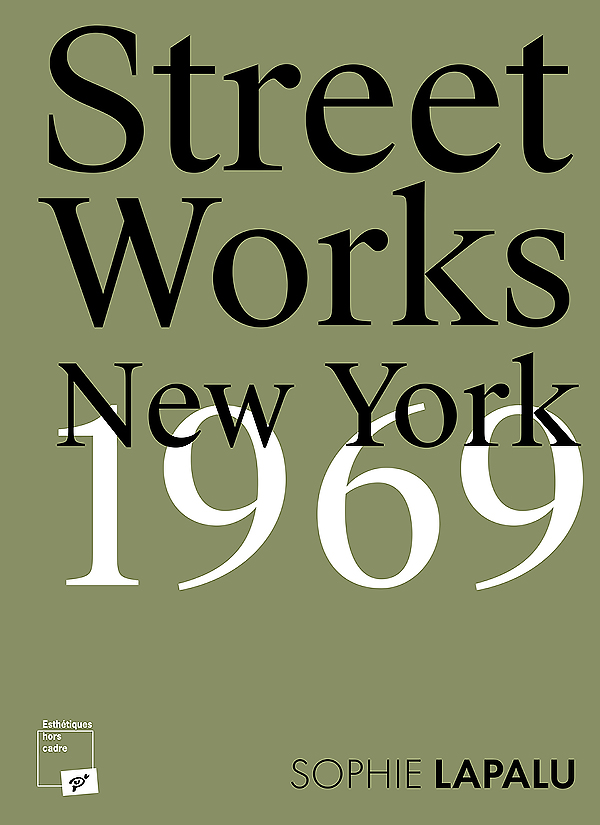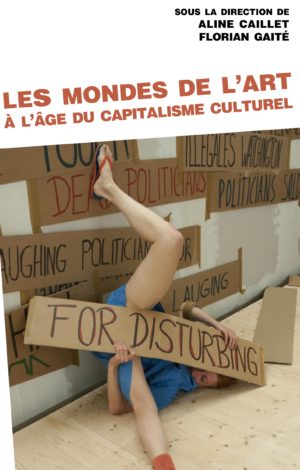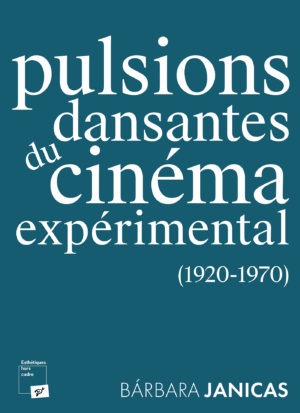Introduction
Sophie Lapalu
« Chaque jour, je choisis au hasard une personne marchant dans la rue. Chaque jour, je suis une personne différente ; je la suis jusqu’à ce qu’elle entre dans un lieu privé (maison, bureau, etc.) où je ne peux pas entrer moi-même1. » Du 2 au 25 octobre 1969, le jeune poète Vito Hannibal Acconci – dénommé par la suite Vito Acconci – décide de suivre chaque jour, vingt-trois jours durant, une personne différente dans les rues de New York jusqu’à ce qu’elle entre dans un lieu privé (Following Piece). Le poète n’est plus un être coupé du monde accoudé à sa table ; il épouse la foule, embrasse la multitude propre aux grandes villes, allie l’unique au multiple et s’inscrit dans une histoire littéraire propre à la modernité ; certains poètes avant lui n’ont-ils pas fait de la métropolisation de la société et de ses conséquences le terrain même de leur création ? Edgar Allan Poe comme Charles Baudelaire ont fondé leur œuvre sur la relation du poète avec les hommes qui l’environnent et la foule qui le dissimule. Se ressentent dans chaque ligne de leurs travaux l’émergence de la révolution industrielle, la perte de sens dans les rapports humains et l’objectivation des interactions sociales. Le phénomène d’urbanisation à l’œuvre dans le monde occidental à partir du milieu du xixe siècle bouleverse considérablement les conditions de vie ; la position de l’individu change – celle de l’artiste également. La foule urbaine habitée d’inconnus qui s’ignorent et se coudoient à la fois est fascinante ; elle est le paradigme de ces temps nouveaux.
Cette filature que réalise Acconci a lieu lors de la quatrième occurrence des « Street Works », soit six événements artistiques new-yorkais, organisés par le poète, artiste et critique d’art John Perreault2 en collaboration avec la poétesse Hannah Weiner et la peintre Marjorie Strider3. Sous cette dénomination, les programmateurs invitent des artistes à agir dans la rue à leur guise, dans le cadre d’une temporalité donnée et d’un espace désigné. Il s’agit de réaliser des travaux éphémères, idéalement imperceptibles en tant qu’œuvres, en vue d’accroître la perception de l’environnement et de ses usages chez le « public » rencontré par hasard. Cent ans après Poe ou Baudelaire, les « Street Works4 » apparaissent comme autant de tentatives d’imaginer de nouvelles façons de vivre, d’interagir avec la foule, d’utiliser les avenues de la mégalopole et de réévaluer ainsi la place de l’individu.
Le vrai problème est comment vivre en ville. […] Les Street Works attirent l’attention sur les conditions urbaines, visuelles, spatiales et interpersonnelles. […] En général, plutôt que d’ajouter quelque chose à l’environnement de la rue, un Street Works fait prendre conscience de l’environnement urbain, juste comme il est, pour le meilleur et pour le pire. Ceci inclut non seulement l’aspect de la rue, mais son usage, pour et par qui. Cette transformation de la conscience est une valeur en soi et est bien plus importante que de se demander si un Street Works est ou n’est pas une œuvre d’art5.
Comment vivre en ville ? Aujourd’hui où la moitié de la population mondiale est urbaine, cette question résonne autant sinon plus que lorsqu’elle a été posée par Perreault, dans son article intitulé « Sortir dans la rue », publié dans le journal new-yorkais The Village Voice le 16 octobre 1969. Il insiste alors sur l’idée que la « transformation de la conscience » est bien plus importante que la question : « Est-ce de l’art ? ». Il invite les artistes à créer une prise de conscience de la vie urbaine grâce à des travaux qui ne se signalent pas comme œuvres lorsqu’ils ont lieu. Les « Street Works » soulèvent dès lors des questions fondamentales : l’art peut-il participer à informer notre vision du monde, voire à la transformer ? Quant aux œuvres, peuvent-elles se passer de toute reconnaissance artistique ?
Cet ouvrage s’attelle à saisir l’élan qui a mené les artistes des « Street Works » à quitter les lieux traditionnellement consacrés à l’art pour embrasser la foule des grandes villes. Lorsque John Perreault, dans sa rubrique de The Village Voice, déclare à propos d’un geste artistique de Scott Burton qu’il est « le plus invisible et le plus sensationnel des travaux6 », c’est peut-être une des premières fois dans l’histoire de l’art qu’il est revendiqué haut et fort que la plus grande valeur d’une œuvre soit de passer inaperçue. L’œuvre d’Acconci est devenue emblématique ; elle est une référence pour les artistes contemporains. Lorsque trente ans plus tard, dans la capitale mexicaine, Francis Alÿs choisit une personne qui lui ressemble et se met à la suivre, jusqu’à ajuster ses pas à ceux de l’individu filé (The Doppelgänger, 1999), comment ne pas voir une filiation avec Following Piece ? Le contexte de la pièce de 1969 est cependant rarement étudié et le processus de révélation de cette filature, par nature secrète, n’a pas été interrogé. Pourtant, les questions de dissimulation et de révélation d’une action artistique n’ont eu de cesse d’habiter certains artistes contemporains. Au cours du xxe siècle jusqu’à aujourd’hui, un certain nombre d’entre eux – héritiers d’une vision duchampienne de l’art – ont revendiqué comme œuvres des gestes banals, effectués dans l’espace public sans inviter de spectateur à y assister. Jiří Kovanda, à Prague, se gratte la nuque sur la place Václaské (Divadlo, 1976) ou bouscule légèrement de l’épaule les gens qu’il croise (Kontakt, 1977). Durant l’année 2001, à Montréal, Diane Borsato touche environ mille personnes en les effleurant de la main (Touching 1000 Persons). En 2001, sur une place de Mexico, Francis Alÿs regarde en l’air [Looking Up (Plaza de Santo Domingo, México D.F)] comme l’avait fait Ben Vautier avant lui, en 1963 à Nice (Regarder en l’air, 1963) ou Lucy Lippard, en 1969, à New York (Contact Piece). À Paris, dans la première décennie des années 2000, Yann Vanderme fait semblant d’attendre le bus (Faire semblant d’attendre le bus, non daté) ou fait des choses à 33 % (Faire les choses à 33 %, 2007-2009) tandis qu’Élodie Brémaud s’assied dès qu’une personne en fait autant (Sit In, 1er au 31 juillet 2014). À Montréal, Steve Giasson « demeure immobile et en silence (un certain temps) » (Performances invisibles, 2015) et, entre Bruxelles, Paris et San José, Thomas Geiger reprend nombre d’actions ici décrites pour les reproduire (Festival of Minimal Actions, Bruxelles, 2014, Paris, 2015, San José, 2018). Absolument non spectaculaires, réalisés de façon anonyme au sein de la foule sans inviter de spectateur, ces gestes ne peuvent pas être distingués de la masse de ceux réalisés quotidiennement dans les villes. Ces œuvres participent de ce que Barbara Formis a nommé l’« esthétique des gestes ordinaires » qui caractérise tout un pan de la création au XXe siècle – un pan selon lequel la vie peut être vécue comme une expérience pleinement esthétique. Formis remarque un véritable « manque de distanciation perceptuelle » dans les gestes ordinaires, qu’elle définit ainsi : « [d]épourvus d’une beauté spécifique, multipliables à l’infini, et hautement impersonnels, les gestes ordinaires demeurent inaperçus7. » Ces gestes suspendent leur visibilité artistique. Insignifiants, ils « se montrent sans se représenter, se font sans rien produire8 ». Ces propositions impliquent pour le spectateur une relation totalement inédite avec l’œuvre : la rencontre se fait par hasard, dans la rue, sans cadres prescripteurs. Les « Street Works », auxquels ont participé de nombreux artistes aujourd’hui considérés comme majeurs (Arakawa, James Lee Byars, John Giorno, Lucy Lippard, Bernadette Mayer, Adrian Piper, Marjorie Strider, Benjamin Patterson, Hannah Weiner…), ont creusé la voie à ce type de pratiques. Or, selon Perrault, les travaux réalisés au sein des « Street Works » ne doivent pas être perçus en tant qu’œuvres. Ils sont donc vus, mais non comme tels. En raison de leur indiscernabilité artistique lors de leur réalisation, nous les nommons à la suite du théoricien et critique d’art canadien Patrice Loubier, des « actions furtives9 ». Loubier utilise ces termes pour décrire la façon dont certaines pratiques pénètrent les espaces sociaux et interrogent la notion de spectateur idéal et attendu. Qui peut suspecter Acconci de réaliser une œuvre alors qu’il marche dans la rue ? Considérant que l’adjectif « furtif » qualifie ce qui cherche « à échapper au regard, à passer inaperçu », comment ces actions deviennent-elles œuvres ? Une œuvre peut-elle passer inaperçue en tant que telle ou, pour reprendre la question de Duchamp, « peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d’art 10 » ? L’artiste doit faire face à un choix : révélera-t-il ou non son geste par la suite ?
Il n’est possible d’analyser que les actions qui, d’une façon ou d’une autre, ont été révélées. Non seulement cinquante ans nous séparent de la première manifestation mais, de plus, si nous avions pu nous y rendre, nous n’aurions pu distinguer un street work de la vie courante dans le sud de Manhattan (à moins de reconnaître les artistes). Notre travail se base sur diverses sources, produites a posteriori par les artistes et les organisateurs eux-mêmes : les comptes rendus de Perreault dans ses articles publiés dans le journal The Village Voice, la publication de textes et de photographies dans un supplément au numéro 6 de la revue 0 TO 9, le catalogue de l’exposition « In plain Sight : Street Works and Performances, 1968-1971 » organisée par Perreault et Judy Collischan en 2008, les textes de la critique d’art Lucy Lippard, qui a elle-même participé aux « Street Works » et, enfin, un entretien avec Vito Acconci, ainsi qu’un autre avec John Perreault en 2014. Ainsi nos sources sont-elles produites directement par les organisateurs et les participants, mais non pas par le public ; elles posent la question de leur partialité et de leur subjectivité, mais aussi de leur statut. La publication est fondamentale et dépasse largement les seuls enjeux de la documentation inhérents aux pratiques performatives. En effet, les artistes ont agi en secret puis ont dévoilé leur acte dans un second temps en vue de permettre la rencontre avec un public. N’y a-t-il pas là un paradoxe ? Ils créent des publicités – entendues comme actions permettant de rendre public le geste, mais aussi comme les résultats de ces actions –, alors que leurs gestes initiaux avaient pour ambition de se dérober à la visibilité artistique. Que se passe-t-il lorsqu’une œuvre secrète et imperceptible acquiert une forme de visibilité a posteriori, dans l’objectif d’être perçue comme œuvre ? Quels enjeux se trouvent derrière de telles propositions ? Quelle place l’artiste s’octroie-t-il dans de telles conditions ?
Pour étudier ces pratiques qui relèvent de l’ordinaire et de l’imperceptible, il a semblé nécessaire de faire appel à des outils spécifiques en vue d’appréhender les questions de l’indice, de l’inaperçu. Ainsi que le relève Carlo Ginzburg11, dans la seconde moitié du xixe siècle apparaissent, dans différents domaines des sciences humaines, des méthodes qui, justement, se penchent sur l’anodin, le détail a priori secondaire. Que ce soit dans l’histoire de l’art (avec les travaux de Giovanni Morelli), dans la psychanalyse (ceux de Sigmund Freud) ou encore avec l’apparition du roman policier (Edgar Allan Poe), ce siècle apparaît être tourné vers l’indice. Or les outils développés dans ces trois différents champs sont très utiles à la compréhension des actions furtives. Le « paradigme indiciaire12 » tel qu’observe Ginzburg caractérise la capacité à élaborer des hypothèses sur la base de petits éléments apparemment négligeables. L’analyse de l’indice était au XIXe siècle une façon de contrer l’effacement progressif des traces des individus eux-mêmes devenus la masse anonyme des foules urbaines. Aussi les travaux du sociologue Georg Simmel, un des fondateurs de ce qui sera appelé plus tard la micro-histoire, permettent d’étudier les bouleversements des rapports humains au sein de la ville13. Quels indices laissés par Acconci permettent de saisir les enjeux de Following Piece, au sein des États-Unis de 1969 en pleine guerre froide ? Comment l’histoire de l’art, le roman policier et la psychanalyse aident-ils à comprendre la structure de cette œuvre et ce qui s’y répète ?
Si les street works s’assimilent à des gestes presque insignifiants, ils mènent paradoxalement à une réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît. Que remettent en jeu ces gestes qui se dérobent à leur visibilité artistique ? Est-il possible de faire l’hypothèse d’une « attitude de la modernité » ? Les artistes s’engagent activement dans le monde et son élaboration. Agir en secret serait une tactique pour faire de l’art un outil de changement social, ainsi que le réclame John Perreault. Procèdent-ils d’une stratégie d’ordre politique visant à pouvoir agir malgré tout, sans avoir à se conformer aux lois qui régissent l’espace public ni à l’injonction de productivité qui dirige les actions quotidiennes ? Ambitionnent-ils de dénoncer les procédés de légitimation de l’art et leurs cadres institutionnels, en vue de s’octroyer plus de liberté ?
Les « Street Works » seraient-ils une façon pour les artistes d’étendre leur champ d’action et de conquérir une forme de pouvoir ?
1. « Each day I pick out, at random, a person walking in the street. I follow a different person everyday ; I keep following until that person enters a private place (home, office, etc.) where I can’t get in. » (Vito Acconci, dans Sarina Basta, Garette Ricciardi, Vito Acconci : Diary of a Body, 1969-1973, Milan/New York, Charta, 2006, n. p. Nous traduisons.)
2.Autodidacte, John Perreault publie son premier recueil de poésie en 1966 (Camouflage) et un second (Luck) en 1969. Ses poèmes sont édités dans de nombreuses revues littéraires (“C”, Mother, Locus Solus, Art & Literature, Chelsea Review, The Paris Review, Nomad, Angel Hair, The World, et 0 TO 9, revue dont nous parlons plus loin). En 2014, Perreault se présente comme un poète devenu « critique d’art pour soutenir sa carrière d’artiste, puis commissaire d’exposition, éditeur et administrateur d’art dans le but de soutenir sa carrière de critique d’art ». (John Perreault, entretien par e-mail, octobre 2014-janvier 2015. Nous traduisons.)
3.Celle-ci était mariée à Michael Kirby, auteur d’un des premiers ouvrages dédié aux happenings : Happenings. An Illustrated Anthology, New York, Dutton, 1966.
4.Nous utilisons les guillemets pour désigner les manifestations appelées « Street Works » organisées par Perreault, Weiner et Strider et l’italique lorsque nous employons le terme anglais pour « travaux/œuvres de rue ».
5. « The real problem is how to live in the city. […] Street Works call attention to the visual and spatial and inter personal conditions of the city. […] In general, rather than adding something to the street environment, a Street Works brings the street environment, just as it is, for better or for worse, into consciousness. This includes not only how the street looks but what it is used for and by whom. This change of consciousness is a value in itself and is more important than questions or whether or not a particular Street Works is or is not a work of art. » (John Perreault, « Taking to the Street », The Village Voice, 16 octobre 1969, p. 16. Nous traduisons.)
6. Id., « Free Art », The Village Voice, 1er mai 1969, p. 14-15. Nous traduisons.
7.Barbara Formis, Esthétique des gestes ordinaires dans l’art contemporain, thèse sous la direction d’Anne Moeglin-Delcroix, Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007, p. 280.
8.Ibid., p. 368.
9.Patrice Loubier, « Un art à fleur de réel : considérations sur l’action furtive », Inter : art actuel, n° 81, 2002, p. 12-17.
10.Marcel Duchamp, entretien avec Philippe Collin à la galerie Givaudan, Paris, 1967. En ligne [https://www.youtube.com/watch ?v =zaGLM4pgN-0], page consultée le 20 juillet 2019.
11.Carlo Ginzburg, « Traces. Racines d’un paradigme de l’indice », dans Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire [1986], trad. M. Aymard, E. Bonan, C. Paolini, M. Sancini-Vignet, Paris, Verdier, 2010, p. 218-294.
12.Ibid.
13.La sociologie de Simmel a influencé durablement les penseurs de l’École de Chicago et Erving Goffman en particulier. Ce dernier publie en 1956 The Presentation of Self in Everyday Life, qui a une influence notable sur Acconci. Voir Erving Goffman, La Mise en scène de la vie quotidienne, 1. La présentation de soi [1956], trad. A. Acordo, Paris, Les Éditions de Minuit.