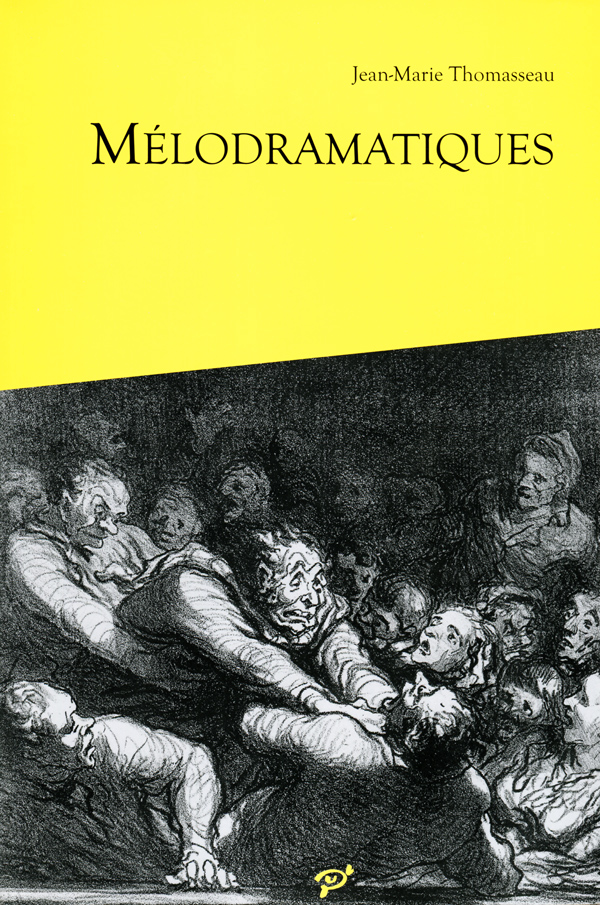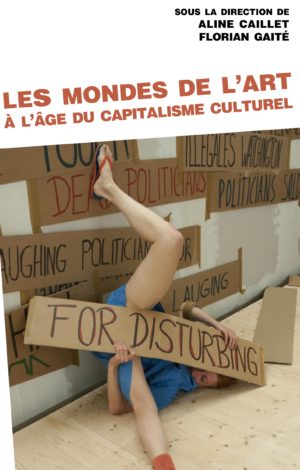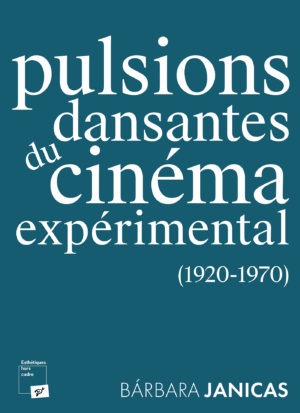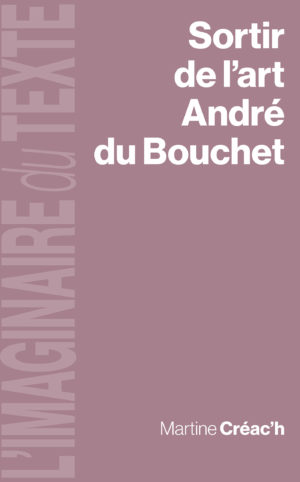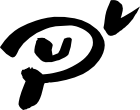PROLOGUE
La dixième muse et le bâtard de Melpomène
I.- CLIO ET LE MÉLO
L’histoire du Mélo ou Les vertus de l’excès
Le Boulevard du Crime
Le Mélo et l’histoire dans le temps des révolutions (1799-1848)
Dame Censure et ses tranche-pièces sous le Premier Empire et la Restauration
Les derniers feux du Mélo
II.- MOTIFS ET PROFILS
Le Mélo et la Bible
L’Auberge des Adrets (1823) et Robert Macaire (1834) ou l’art des mélos à doubles- fonds.
Renaissance et Romantisme ou Le bronze et l’ébauchoir
La Cigale et la Fourmi, le petit Greluche et le maître d’école.
Schamyl ou Comment dénoncer le crime et approuver la Crimée.
III.- FORMES ET FINS DERNIÈRES
Les formes du théâtre populaire au XIXe siècle
Dialogues avec tableaux à ressorts ou Dago et Hernani
L’écriture du spectaculaire ou la grammaire didascalique des Mélos de Pixerécourt
La dramaturgie « frénétique » de Joseph Bouchardy
L’œil dans le cabinet noir ou Le roman vu des coulisses
EPILOGUE
L’héritage du bâtard ou la féconde lignée du Mélo d’Antoine à Vilar