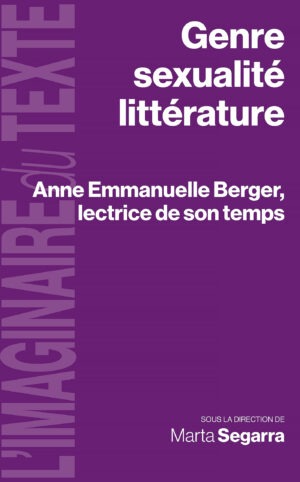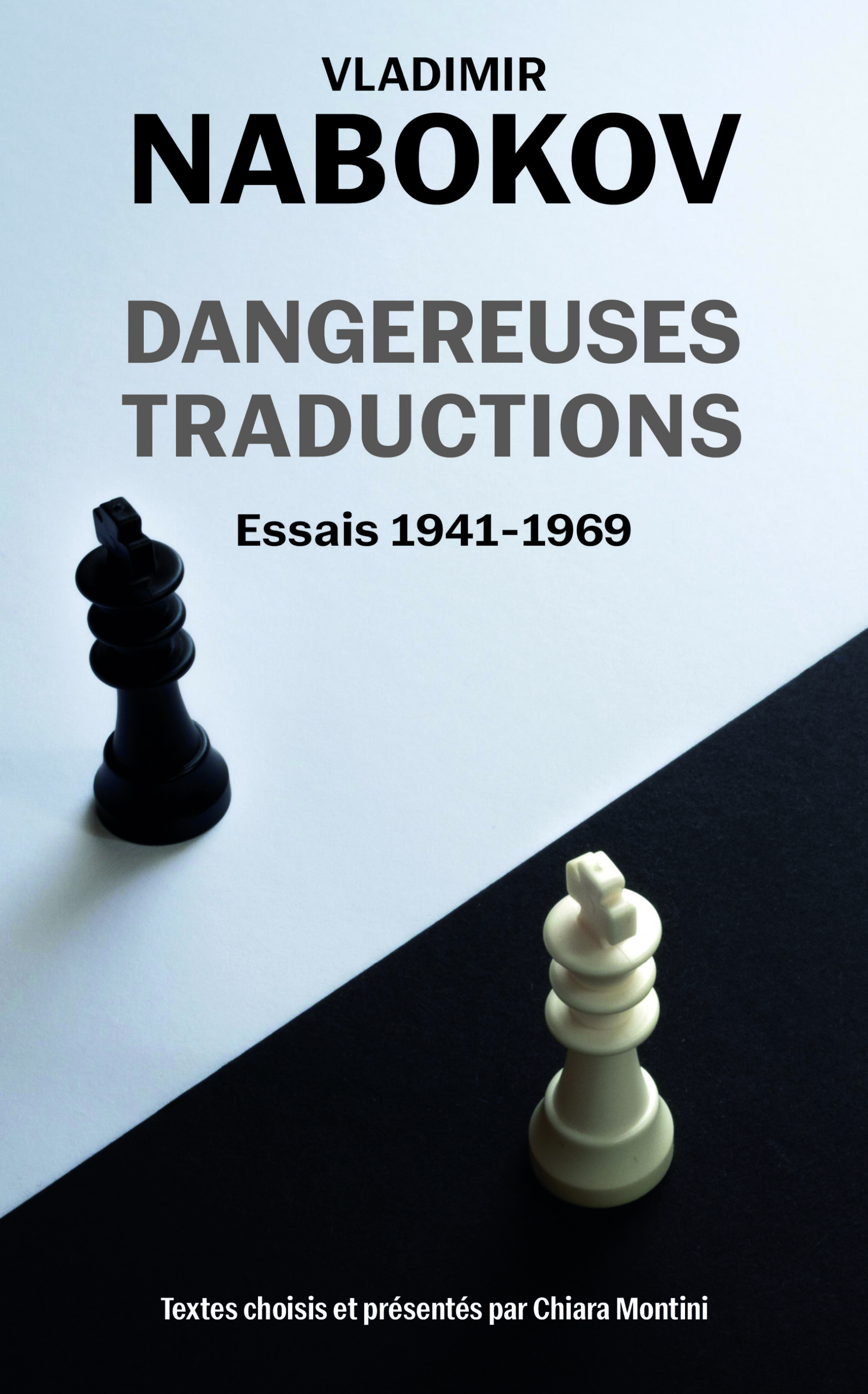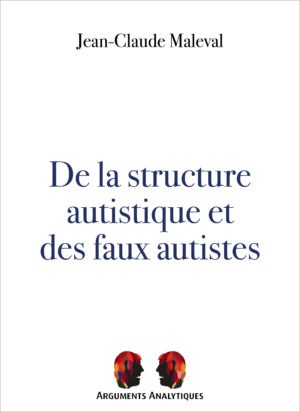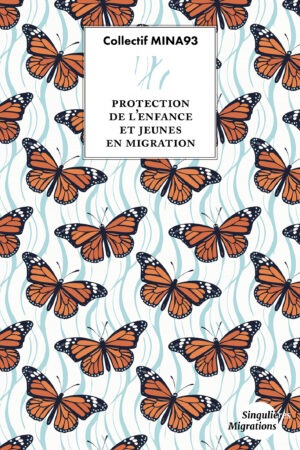Introduction.
Ce curieux monde de la « transmigration verbale »
Nabokov traducteur : un regain d’intérêt
La pire erreur des traductions classiques de la Bible est, à mon sens, de présenter au lecteur un texte sans accrocs, parfaitement lisse, parfaitement compréhensible, comme s’il avait été fabriqué la veille dans l’académie la plus proche.
André Chouraqui, « Genèse d’une traduction. Du Cantique au poème de poème1 »
Que l’auteur de Strong Opinions – traduit en français d’abord comme Intransigeances, ensuite comme Partis pris2 – puisse nous bousculer encore aujourd’hui ne devrait pas étonner. L’approche littéraliste de Vladimir Nabokov de la traduction fut reçue en son temps comme une énième provocation. Son parti pris de laisser l’auteur le plus tranquille possible tout en dérangeant le lecteur, pour reprendre la fameuse définition de Schleiermacher3, fut peu partagé depuis qu’il existe une réflexion sur la traduction. Cicéron fut un des premiers à déclarer qu’il ne faut pas traduire verbum pro verbo (« mot à mot »), suivi par Horace et saint Jérôme, pour ne citer que les principaux parmi les insignes traducteurs du monde occidental. Nabokov ne l’ignorait pas. Il reconnaissait que traduire est nécessaire mais savait que chercher une correspondance parfaite entre les différentes langues, les différentes cultures, les différentes expériences, les différents pays est une utopie. Personne, ou presque, du moins depuis Cicéron, n’essaie de traduire « mot à mot »… Sauf quelques cas uniques. Une chose « inouïe » (« an unheard of case »), pour reprendre l’adjectif que Pouchkine utilise au sujet de la traduction littérale par Chateaubriand du Paradis Perdu de Milton, dans une phrase que Nabokov reprend en guise d’épigraphe dans l’introduction à « son » Eugène Onéguine (« my EO » comme il l’appelait)4. Après des années consacrées à la traduction, Nabokov lui-même essaie de mettre en pratique cette « chose inouïe » quand il traduit Eugène Onéguine5 de Pouchkine, du russe vers l’anglais, texte qui sortira pour la première fois en 1965. Ce travail, immense, fut l’aboutissement d’une longue pratique et d’une réflexion mûrie autour de la traduction. Ce travail divisa les intellectuels de l’époque et suscita un débat houleux6. Mais, qu’entendait-il, au juste, par « littéralisme » ? Nous allons le préciser dans cette introduction, étape par étape.
Pour le moment il faut souligner que, pour Nabokov, le littéralisme est d’abord une question éthique. Il défend sa position avec son aplomb habituel et, dans son article en réponse à Edmund Wilson7 qui démonte sa traduction du chef-d’œuvre de Pouchkine, il explique la différence entre ses positions antagonistes en tant qu’écrivain, d’une part, et en tant que traducteur et homme d’étude, d’autre part :
À la différence de mes romans, EO possède une composante éthique, des éléments moraux et humains. Il reflète l’honnêteté ou la mauvaise foi, le savoir-faire ou le manque de sérieux du compilateur. Si l’on me dit que je suis un mauvais poète, je souris ; mais si l’on me traite de piètre homme d’étude, je saisis mon plus lourd dictionnaire.
Nabokov insiste : s’il écrit ses œuvres de fiction sans aucune intention moraliste, il n’en est pas ainsi pour son travail d’érudit et donc de traducteur pour lequel il se doit de respecter une éthique rigoureuse. Une éthique qui n’est pas partagée par le plus grand nombre. Une éthique mal comprise. Une éthique considérée comme immorale8. Car, à sa façon paradoxale, il me semble que, en épousant le littéralisme en traduction, Nabokov pose également la question, délicate et combien actuelle, de l’intraduisible. On ne va pas ici rentrer dans ce long débat, mais il suffit, pour le moment, de rappeler que pour Nabokov le littéralisme, dont il ne donnera sa définition qu’en 1965, comporte une traduction aussi proche du texte source que possible suivie d’une montagne de notes. Celles-ci servent à compenser l’incommensurabilité des langues, des cultures et des époques en traduction et témoignent ainsi d’un rapport « non mesurable » entre le texte original et le texte traduit. On pourrait aller juqu’à dire que, dans son cas, le nombre de mots dont il se sert pour le commentaire serait inversement proportionnel à la possibilité d’une correspondance entre les deux textes, l’original et sa traduction.
« I shall be remembered by Lolita and my work on Eugene Onegin9 », affirme Nabokov en 1966, peu après la sortie de sa traduction. Pensait-il avoir figé à jamais un chef-d’œuvre grâce à sa traduction annotée qui deviendrait le texte de référence dans la nouvelle langue, « le » Eugène Onéguine anglais ? Ou bien prétendait-il avoir changé la pratique de la traduction ? Pourquoi, sinon, croyait-il que sa traduction du grand chef-d’œuvre de la littérature russe devait avoir le même retentissement que Lolita ?
Qu’en est-il aujourd’hui de ce travail tant contesté qui lui demanda autant d’énergie et d’années de dévouement ? Qu’en est-il de ce texte de référence qui permet de comprendre et disséquer les mécanismes et le génie de l’original, sans pour autant le remplacer ?
Le présent recueil réunit tous les écrits sur la traduction de Nabokov, dont certains inédits10, pour illustrer le parcours théorique de ce grand auteur et traducteur autour de la traduction. Ce chemin nous aidera à répondre à quelques-unes des questions ci-dessus posées. Ce recueil montre également qu’écriture multilingue et traduction vont de pair et sont souvent une seule et même chose. Aux textes de Nabokov, j’ai ajouté, telle une fissure qui s’insinue dans l’édifice nabokovien, l’article d’Edmund Wilson, « L’Étrange cas de Nabokov et Pouchkine11 », qui suscitera la fameuse « Réponse à mes critiques » de la part de notre auteur-traducteur12.
Nous allons suivre le chemin des débuts de Nabokov traducteur et autotraducteur ; son renoncement au russe à la faveur de l’anglais ; son exil et son sentiment de déception par rapport aux traductions existantes ; ses théories de la traduction comme art ; ses traductions du russe vers l’anglais et finalement sa vision, qui va à l’opposé de celle qu’il avait défendue auparavant, de la traduction littérale accompagnée d’une montagne de notes comme la seule traduction possible.
Traduction, pseudotraduction, autotraduction
What is translation? On a platter
A poet’s pale and glaring head,
A parrot’s screech, a monkey’s chatter,
And profanation of the dead.
Vladimir Nabokov, « On Translating Eugene Onegin13 »
Trilingue (russe, anglais, français) depuis l’âge de sept ans, Nabokov aurait traduit The Headless Horseman (Le Chevalier sans tête) de Mayne Reid en alexandrins français, à l’âge de douze ans14. Adolescent, il se plaît également à écrire des pseudotraductions15, qui sont en réalité des textes qu’il a lui-même rédigés. L’auteur présumé a souvent un nom, qui n’est qu’une anagramme du sien, comme Vivian Calmbrood dont il soumet la traduction fictive à ses parents qui lui rétorquent de ne pas perdre son temps avec un tel écrivaillon ! Ignoraient-ils vraiment que l’auteur était leur fils16 ?
Quelques années plus tard, il débute en tant que véritable traducteur. Son premier travail important publié sera la réponse au défi de son père de traduire un livre aussi difficile que Colas Breugnon de Romain Rolland, roman truffé de jeux de mots rabelaisiens. Après une période dissipée à l’université, poussé par son père, il arrive à terminer ce travail avec succès. Nikolka Persik, où « Nikolka » remplace le diminutif de Nicolas, « Colas », alors que Persik (« pêche » en russe), remplace « Breugnon », sortira en 1922. La même année, Gamayun lui propose de traduire Alice aux pays des merveilles, de Lewis Carroll, un autre défi qu’il relève. Anja v strane chudes (1923)17 est une traduction lue et appréciée encore aujourd’hui. Dès les titres, on devine que Nabokov privilégie une approche ethnocentrique, selon la définition d’Antoine Berman, et par conséquent il adapte sa traduction à son public, par exemple en transformant les noms anglais en des noms aux sonorités russes. Comme il l’avait déjà fait en transformant Colas Breugnon en Nikolka Persik, Alice devient Anja… Ce n’est qu’un exemple qui confirme qu’il est encore bien loin du littéralisme et qu’il n’hésite pas à se servir de son inventivité pour modeler le texte dans sa langue russe. Après ces premières expériences, la traduction l’accompagnera tout au long de sa vie. Les années 1920 en particulier le voient aux prises avec des auteurs aussi prestigieux que Rupert Brooke, Seamus O’Sullivan, Verlaine, Supervielle, Tennyson, Yeats, Byron, Keats, Baudelaire, Shakespeare, Rimbaud et Musset18.
Pour Nabokov, la traduction et l’écriture existent en tandem, l’une accompagnant l’autre. Par conséquent, quelques années plus tard, il entreprend sa première autotraduction. Son roman Camera Obscura (Ка́мера обску́ра, 1932, en russe) était sorti en 1936 dans la traduction anglaise de Winifred Loy19. N’étant pas satisfait de ce travail, il propose, dans une lettre adressée à l’éditeur Hutchinson & Co, de traduire lui-même son propre texte en anglais :
Après la publication de mon ouvrage, Chambre obscure, dont la traduction ne me satisfait pas – elle est inexacte et pleine de clichés qui ont fonction d’aplanir tous les passages délicats – les responsables de chez John Long m’ont suggéré de traduire moi-même cet autre roman qu’ils devaient publier : La Méprise. Quoique je connaisse assez bien la langue anglaise, je n’ai pas souhaité en prendre l’entière responsabilité et j’ai proposé de faire une traduction que les éditeurs feraient revoir par un de leurs experts20.
Suivant le conseil de l’éditeur, l’auteur bilingue traduit d’abord La Méprise (Отчаяние, qui devient Despair) en 1936, et entreprend peu après la retraduction de Camera Obscura, qui devient Laughter in the Dark (Rires dans la nuit) en 1938. Il profite de ce changement de langue pour modifier non seulement le titre, mais également des passages du roman. Ce livre n’a pas rencontré un fort retentissement, mais on peut considérer sa traduction comme une réussite. Elle confirme, s’il le fallait, que l’auteur russe est capable de se traduire, et qu’il pourra écrire également en anglais.
Mais Nabokov n’a pas toujours le temps de s’autotraduire : il est constamment à la recherche d’un traducteur, d’« un homme qui connaît l’anglais mieux que le russe », et « d’un homme pas une femme ». Car, ajoute-t-il, « je suis franchement homosexuel en matière de traduction21 ». Mais même les traducteurs « hommes » les plus réputés ne le satisfont pas. Pas toujours. Et, de leur côté, ses traducteurs n’aiment pas toujours travailler avec lui. Non seulement il est exigeant et tatillon, non seulement ses corrections semblent parfois ébranler toute logique, mais il profite des traductions de ses textes russes pour modifier l’original et le rendre parfois plus accessible aux futurs lecteurs et lectrices. Ses traducteurs voient ainsi leur travail métamorphosé au point qu’il leur serait difficile d’en assumer la paternité. Car elle revient à Nabokov qui, même s’il n’en est pas le traducteur, tient à avoir le mot final. Quel professionnel accepterait de voir sa traduction remise en question de bout en bout ? Pour Nabokov, la « transmigration des mots22 », c’est-à-dire le passage d’une langue à l’autre, va à l’encontre du littéralisme quand il s’agit de traduire ses textes. Son étrange « définition » de ce qu’aujourd’hui on pourrait appeler l’autotraduction et que nous lisons dans son introduction à sa traduction anglaise d’Invitation au supplice semble le confirmer :
Si un jour je faisais un dictionnaire de définitions qui n’auraient pas des mots singuliers en guise d’entrée, une de mes entrées préférées serait abréger, augmenter, ou bien altérer ou provoquer l’altération, aux fins d’une amélioration retardée, de ses propres écrits en traduction23.
Ce que Nabokov demande à son traducteur, en d’autres termes, c’est une traduction littérale qu’il pourrait ensuite « dragoniser » (dragonize24), un mot qui signifie, avec une connotation menaçante, « abréger, augmenter, ou bien altérer ou provoquer l’altération » tel un dragon qui dévore sa proie. De mon côté, je prefère traduire librement ce terme par « cannibaliser25 » (en espérant ne pas susciter la colère de Nabokov). Car il me semble que c’est de ça qu’il s’agit : tel un cannibale, l’auteur s’approprie le travail du traducteur de ses propres textes.
Pour autant, le traducteur ne doit pas manquer de compétence : l’auteur sait que le travail du littéraliste qu’il exige est plus complexe que celui de l’adaptateur ou du paraphraste, pour ne citer que les catégories des « transmigrateurs verbaux » qu’il méprise le plus. Nabokov cherche au contraire quelqu’un qui puisse respecter l’« exactitude » du texte d’origine26 pour ensuite pouvoir s’approprier la traduction, tantôt pour mieux adapter son texte aux exigences des lecteurs anglophones, tantôt pour qu’elle réponde à ses propres exigences d’auteur en train de se relire en traduction27.
J’insiste sur ce que nous pourrions appeler l’« autotraduction en collaboration » parce que cette pratique et celle de la traduction ont pour Nabokov un point commun : celui ou celle qui traduit et qui n’est pas l’auteur ou l’autrice se doit de rester le plus près possible de l’original. Seul l’auteur ou l’autrice aurait le droit de modifier le texte de départ28 et, parfois, un traducteur ou une traductrice qui partage la même sensibilité et le même talent que l’auteur. C’est sans doute pour cela que, sûr de ses atouts, Nabokov, à cette époque, s’accorde encore la permission de s’adonner à un procédé qui va à l’opposé du littéralisme. Comme l’a fait brillamment remarquer Stanislav Shvabrin, Nabokov, se référant à sa traduction d’un poème de Tioutchev , « Appeasement », faite au début des années 1940, avoue son péché :
J’ai fait ici quelque chose qu’un traducteur parfait ne devrait pas faire. J’ai péché dans cette traduction, mais j’ai péché avec amour, j’ai péché avec tendresse. Pour des questions de connotation et d’association, j’ai préféré nommer les « créatures à plumes » (feathered creatures), seule référence aux oiseaux dans le texte original, parce que je voulais que les vrais oiseaux de la forêt russe que Tioutchev avait à l’esprit, se mettent à chanter, comme ils le feraient à ce moment-là dans la perception d’un lecteur russe. De plus, j’ai amélioré l’arc-en-ciel qui clôt le poème en ouvrant grand sa parenthèse irisée. Le son du mot russe pour « arc-en-ciel », radouga, scintille d’allusions à l’éclat, à l’allégresse, au paradis, ce que ne fait pas le son de l’anglais « rainbow » (arc-en-ciel). Malgré le prisme significatif de ses sept lettres différentes (pour les sept couleurs), l’anglais « rainbow » suggère un parapluie plutôt qu’un parasol29.
Grâce à sa créativité et à sa connaissance profonde des références à la Russie présentes dans le poème, Nabokov s’élève au-dessus des érudits et des tâcherons30 (deux catégories de traducteurs qu’il méprise), et peut s’accorder la liberté de transgresser l’intégrité de ses modèles : ces transgressions étant justifiées « par une appréciation supérieure de leur nature unique31 ». Bien sûr, une traductrice ou un traducteur faisant partie des communs des mortels se doit d’adopter une tout autre conduite.
Avant de revenir sur ce point, il me semble nécessaire de rappeler que le bilinguisme de Nabokov fut un choix, certes, mais un choix forcé. La renonciation que ce choix entraîna aurait eu des conséquences affectives sur sa vision même de la traduction. La langue des affects de Nabokov était sans aucun doute le russe. Mais on pourrait aussi dire que la langue des affects de Nabokov était d’abord la poésie ou, au sens large, la littérature. Et ce qu’il pourrait craindre d’une traduction, au fond, c’est qu’elle ne soit pas capable de respecter ses textes adorés, qu’elle détruise la poésie. C’est sans doute ce qu’il avait redouté quand il commença à écrire dans une langue autre.
D’une vieille Rolls Royce à une simple jeep :
du russe à l’anglais
My English, this second instrument I have always had, is however a stiffish, artificial thing, which may be right for describing a sunset or an insect, but which cannot conceal poverty of syntax and paucity of domestic diction when I needed the shortest road between warehouse and shop. An old Rolls Royce is not always preferable to a plain Jeep.
Vladimir Nabokov, Strong Opinions32
Après avoir écrit en russe pendant de longues années, après avoir peaufiné sa langue jusqu’à un niveau de maîtrise et créativité sans égal, Nabokov, exilé depuis de longues années, commence à rédiger ses textes en prose anglaise à partir de la fin des années 1930 pour se convertir définitivement à l’anglais quand il émigre aux États-Unis en 1940. Cette langue, qu’il maîtrisait déjà depuis son plus jeune âge et qu’il perfectionna lors de ses études à Cambridge, n’était pas tout à fait une langue étrangère, mais ce n’était ni la langue des affects et ni le russe qui marqua ses débuts d’écrivain. Son premier roman écrit directement en anglais, The Real Life of Sebastian Knight (1939), marque le passage « définitif » à sa nouvelle langue. À l’exception de ses poésies (et de l’autotraduction de Lolita), il rédigera dorénavant tous ses textes en anglais alors qu’il relira systématiquement toutes les traductions de ses œuvres russes en anglais et en français. Le passage à l’écriture en langue anglaise est dû sans doute au désir d’avoir un plus grand nombre de lectrices et lecteurs par rapport à celles et à ceux de la communauté russe exilée mais, aux dires de Nabokov, le renoncement à écrire en russe ne fut pas anodin :
Ma tragédie personnelle, qui ne peut ni ne doit d’ailleurs intéresser personne, a été que j’ai dû abandonner ma langue maternelle, mon idiome naturel, ma langue russe, riche, infiniment riche et docile, pour un anglais de second ordre33.
Dut-il vraiment abandonner sa langue maternelle ? Son anglais était-il véritablement de second ordre ? Si, d’une part, Nabokov a arrêté d’écrire en prose russe, il a gardé sa langue maternelle pour la poésie et sa famille. D’autre part, son anglais ne fut jamais médiocre, et il put l’enrichir et en faire son propre idiome personnel, un idiome dans lequel il n’hésite pas à se traduire et à traduire. Aurait-il traduit – traduit ses auteurs russes vénérés – en anglais, s’il avait cru que sa maîtrise de cette langue ne le lui permettrait ?
C’est également en anglais que, aux États-Unis, il enseigne la littérature russe moderne, puis la littérature générale. C’est en tant qu’enseignant qu’il est obligé de lire les traductions des ouvrages non anglophones au programme. Il se rend compte qu’aucune ne le satisfait, qu’aucune n’offre une version « fidèle » de l’original. Il commence alors à traduire vers l’anglais : il doit retraduire des passages de Gogol pour écrire son livre sur cet auteur, puis s’attaque au Festin au temps de la peste de Pouchkine. En 1944, il publie pour la première fois l’anthologie Trois poètes russes : Lermontov, Pouchkine, Tioutchev. Ces traductions, que Nabokov finira par renier, sont encore poétiques. Poétiques au sens déjà évoqué plus haut : la traduction profite d’une affinité toute particulière entre le poète et le traducteur qui peut ainsi rendre hommage au chef-d’œuvre, à l’original, sans l’endommager. Non, l’anglais n’était déjà plus une langue de second ordre pour Nabokov.
Quand, en 1941, Nabokov se retrouve dans la situation de parler à Havard pour la première fois devant un public, il pratique la traduction depuis longtemps. Cependant, il est encore à la recherche d’une définition de cette pratique, et il est peut-être déjà à la recherche d’une méthode, de sa méthode. Serait-il possible d’élaborer une théorie convaincante qui n’exclurait pas les affinités électives entre la poésie et la traduction ?
« L’art de la traduction » : un casse-tête
I think that in a work of art there is a kind of merging between the two things between the precision of poetry and the excitement of pure science.
Vladimir Nabokov, Strong Opinions34
Comme l’indiquent les titres de ses tout premiers essais sur la traduction, « L’art de la traduction I » et « L’art de la traduction II »35, pour Nabokov traduire serait de prime abord un « art ». D’après sa définition, l’art ou plus précisément l’œuvre d’art en littérature serait pour lui une combinaison entre la « précision » de la poésie et l’« exaltation » de la science36. La traductrice ou le traducteur se devrait donc d’être aussi précis que la ou le poète dans la restitution du texte dans sa langue tout en se montrant exalté comme le ou la scientifique qui cherche et découvre…
« L’art de la traduction I », publié dans The New Republic le 4 août 1941, est donc le premier condensé des réflexions de Nabokov à propos de cette forme d’art qui est la traduction. On l’a dit, ses réflexions sont le fruit d’une longue pratique de la lecture et de l’analyse des traductions anglaises des chefs-d’œuvre qu’il étudie, et des lectures et révisions des traductions de ses propres textes. Si ce premier essai sur la traduction est rédigé avec le ton sûr et ironique, polémique et provocateur, caractéristique de Nabokov, si les mauvais traducteurs et les maux qui dérivent des mauvaises traductions sont énumérés et disséqués de manière scientifique, sa conclusion laisse pour le moins perplexe. Après avoir analysé un vers pouchkinien dans ses détails rythmiques, stylistiques et esthétiques, notre malheureux traducteur avoue avoir passé une nuit terrible pour traduire ce vers apparemment très simple : « Ia pomniou tchoudnoïé mgnovénié » (littéralement : « je me souviens d’un moment merveilleux »). Nabokov ne dévoile finalement pas le résultat de cette nuit d’insomnie laborieuse prétextant que, s’il montrait sa traduction, les lecteurs pourraient être amenés à douter que la perfection puisse être atteinte simplement en suivant quelques règles parfaites.
Conclusion sibylline ou aveu d’impuissance ? La traduction manquerait-elle de la « précision », cette précision même, que, nous le rappelons, il attribue à la poésie ? Et, si ce fut le cas, pourrait-elle être toujours considérée comme un véritable art ?
Tout en continuant à traduire, Nabokov ne publiera pas d’essais sur la traduction pendant un long moment, comme si la pratique résistait à toute tentative de théorisation. Ce n’est qu’en 1951 qu’il reprend « L’art de la traduction I », en y ajoutant cinq paragraphes (environ une page et demie) à l’occasion d’une conférence sur « cette entreprise pathétique qu’est la traduction37 ». Au fond, dix ans après la première rédaction, rien ne semble avoir changé dans la réflexion de Nabokov. En effet, s’il reprend le même texte après tout ce temps, c’est parce qu’il y adhère encore et que, par conséquent, il n’a toujours pas trouvé les quelques règles parfaites qui régissent la bonne traduction. L’art de la traduction.
Les années 1950 marquent également le moment où Nabokov commence à se consacrer à sa traduction d’Eugène Onéguine. Si on s’en tient à ses propos, ce travail doit sa naissance à une remarque de sa femme38 qui, assistant au dégoût que les « paraphrases rimées » d’Eugène Onéguine par des traducteurs médiocres suscitent chez son mari, obligé d’en revoir chaque ligne pour pouvoir en tirer profit dans son enseignement, lance le défi : « Pourquoi ne le traduirais-tu pas toi-même39 ? » Défi relevé. Tout au long de cette expérience, il publiera aussi, de façon ponctuelle, de nouveaux textes sur la traduction qu’il n’appelle plus « art ». Il écrit d’abord trois courts textes sur la traduction. Le premier est une poésie, « Pitié pour le traducteur grisonnant » (1952)40, accompagnée d’une courte introduction. Nabokov se voit ici dans une situation psychologiquement difficile et, pour se qualifier de « bon traducteur », il ne peut que brosser son propre portrait en train de traduire. Une fois de plus, il ne semble pas à même de proposer une approche théorique de cette pratique. Il invoque alors la pitié des lectrices et des lecteurs envers ce pauvre traducteur qui, face à toutes les difficultés auxquelles il est confronté, finit par perdre la raison :
De telles mannes ne sont pas pertinentes. Tôt ou tard
La noble personne, le mime sublime
Le traducteur incorruptible
Est trahi par Dame rime.
Et le poème du persan
Et le sonnet né en Espagne
Périssent dans sa version
Et lui, il en perd la raison
Mais il n’y a pas que le traducteur qui perd la raison, la folie est parfois une solution que Nabokov choisit quand une situation devient insupportable : le narrateur de Brisure à Senestre, par exemple, à l’annonce de la mort atroce qu’eut à subir le fils d’Adam Krug, le protagoniste déjà endeuillé par la mort de sa femme, avoue : « C’est à ce moment que je ressentis un mouvement de pitié pour Adam et que je glissai jusqu’à lui, le long d’un rayon de lune qui le frappa aussitôt de folie, mais qui lui épargna au moins la souffrance inutile de son destin logique41. » Trop c’est trop. Comme Adam Krug, le traducteur ne peut que devenir fou.
Peu après avoir écrit ce poème autobiographique, Nabokov entame un autre essai qui reprend le titre de son tout premier texte « critique » sur la traduction : « L’art de la traduction II. Une sorte de mouvement V » (1954). Ici, il se sert d’une métaphore botanique pour définir une méthode qui naîtrait d’une affinité, d’une parenté, entre le traducteur et l’auteur et entre la traduction et le texte. C’est la même parenté que l’on retrouve dans sa poésie : « En traduisant Eugène Onéguine » où il compare son travail, « Ronce, cousine de ta rose », à des « fientes de colombes » sur la statue de Pouchkine. Hélas, malgré l’affinité entre l’original et la traduction, l’échec est inévitable. Nabokov est encore à la recherche d’une affinité entre l’auteur et le traducteur qui donnerait à la traduction sa voix juste, en suivant le bon chemin. On pourrait croire que, en 1954, il tâtonne toujours à la recherche d’une méthode capable de faire de la traduction une œuvre d’art, précise comme la poésie et exaltante comme la science. Son approche de la traduction, où il expérimente, sans jamais s’éloigner de son but, « le respect » de l’original, ne va pas sans rappeler les diverses méthodes du mathématicien fou de Samuel Beckett, autre écrivain contemporain qui, pour faire face à l’incommensurabilité des langues, change d’unité de mesure à chaque calcul42. La métaphore n’est pas anodine : Nabokov lui-même expérimente différentes méthodes à la recherche de la sienne.
Les textes « théoriques », qui précèdent l’année 1955 et qui décrivent un traducteur enchaîné dans les difficultés, semblent un aveu d’impuissance et sont révélateurs des doutes qui taraudent Nabokov. Que cela soit clair, cependant, l’humilité de Nabokov s’adresse plus à la nature de la traduction elle-même qu’à lui-même. Il a beaucoup traduit, ces dernières années il a eu affaire aux chefs-d’œuvre de la littérature russe, et ses traductions sont généralement très appréciées, même par Edmund Wilson qui avait pourtant ereinté son EO. Cependant, dans sa réflexion sur cette pratique, il fait face à une impasse. Il ne peut pas parler de traduction sans que la pratique ne le contredise. La traduction serait-elle véritablement un art ou bien relèverait-elle du domaine de la technique ? Il ne peut répondre à cette question. Le doute, l’impossibilité à tout contrôler, et par conséquent la nécessité de trouver des compromis, tout cela demande une solution. La solution. Bien sûr, dans les essais ci-dessus évoqués, Nabokov avait déjà pris parti contre certains traducteurs et traductrices incompétents, et ainsi contre certaines traductions et il avait essayé de suivre une ligne rigoureuse (que l’on pourrait appeler cibliste), sans qu’il en fût satisfait. Il lui faut chercher ailleurs.
Le littéralisme, une méthode scientifique
In point of fact, the greater one’s science, the deeper the sense of mystery. Moreover, I don’t believe that any science today has pierced any mystery. We, as newspaper readers, are inclined to call « science » the cleverness of an electrician or a psychiatrist’s mumbo jumbo [a gibe to Freud, of course]. This, at best, is applied science, and one of the characteristics of applied science is that yesterday’s neutron or today’s truth dies tomorrow. But even in a better sense of « science » – as the study of visible and palpable nature, or the poetry of pure mathematics and pure philosophy – the situation remains as hopeless as ever. We shall never know the origin of life, or the meaning of life, or the nature of space and time, or the nature of nature, or the nature of thought.
Vladimir Nabokov, Strong Opinions43
La brume doit être dissipée. Ce n’est pas un hasard si l’essai de Nabokov qui marque le passage à la méthode littéraliste a pour titre « Problèmes de traduction. Onéguine en anglais » (1955) et propose une nouvelle approche. Une approche rigoureuse, scientifique :
Depuis plus ou moins cinq années, j’ai été occupé, par intermittence, à traduire et annoter Onéguine de Pouchkine. Au cours de ce travail, j’ai appris quelques faits et je suis arrivé à certaines conclusions. Tout d’abord, les faits44.
Quelques mois à peine se sont écoulés depuis son dernier essai sur l’art de la traduction où il était à la recherche d’une affinité entre deux sensibilités exceptionnelles : celle de l’auteur et celle du traducteur qui seraient comme deux têtes d’une seule plante florale. Peu de temps s’est écoulé depuis qu’il a défini sa tâche comme étant le mélange de « la patience » du poète » et de « la passion » du scoliaste45. Maintenant il a compris : la seule traduction poétique digne de ce nom est la traduction littérale et il ne changera plus d’avis. Dans cet essai qui marque un véritable tournant, Nabokov s’engage d’abord à définir la pratique qui sert la théorie, ensuite à produire les « faits » pour enchaîner sur les conclusions. Mais il ne donne toujours pas de définition claire du littéralisme. Doute-t-il toujours ? Cherche-t-il toujours en tâtonnant ?
La proximité temporelle entre « L’art de la traduction II » et « Problèmes de traduction. Eugène Onéguine en anglais » pourrait paraître étonnante. On dirait que Nabokov a bataillé pour trouver la formule appropriée et que, après des années de pratique et de réflexion, grâce aussi à son travail sur EO, il a eu une véritable illumination : la traduction poétique n’est pas un art, comme il l’avait pensé. Il doit donc choisir une méthode, une technique, afin de trouver la solution aux problèmes qu’elle pose. Il faut que sa pratique de la traduction change elle aussi.
Un héros de notre temps et La Geste du Prince Igor : des traductions littérales ?
In attempting to translate Lermontov, I have gladly sacrificed to the requirements of exactness a number of important things – good taste, neat diction, and even grammar (when some characteristic solecism occurs in Russian text). The English reader should be aware that Lermontov’s prose style in Russian is inelegant; it is dry and drab; it is the tool of an energetic, incredibly gifted, bitterly honest, but definitely inexperienced young man.
Vladimir Nabokov, préface à sa traduction d’Un héros de notre temps46
Dorénavant, Nabokov n’écrira sur la traduction que pour défendre le littéralisme qu’il essayera de respecter dans sa pratique. La préface et la traduction d’Un héros de notre temps (1958), le chef-d’œuvre de Lermontov, cimente le critère sacro-saint et intouchable de la littéralité. Cependant, contrairement à EO, cette traduction fut généralement bien accueillie et elle est toujours appréciée et lue quand elle n’est pas utilisée comme base pour une nouvelle traduction. À ce propos, Shvabrin commente :
L’habilité de Nabokov à insuffler sa perspective critique à la traduction littéraliste du roman de Lermontov faite en collaboration avec son fils est ce qui rend cette traduction unique. Le fait que la version des Nabokov n’hésite pas à représenter le style de la prose de Lermontov comme un travail en cours n’a pas empêché qu’elle devienne la norme de facto parmi les nombreuses versions anglo-américaines du roman. Grâce à la rigidité de la vision et de l’exécution de la version des Nabokov, les traducteurs et les traductrices successifs ont acquis la liberté d’un choix éclairé entre suivre leur voie en créant des interprétations encore plus littérales, ou revenir à une forme plus proche de l’adaptation pré-nabokovienne, pour ainsi dire. En ce sens, la traduction est un succès. Elle prouve largement que l’approche littéraliste – le jumelage de la précision lexicale et de la perspicacité critique – a tout le potentiel d’être une combinaison gagnante47.
Si la traduction littérale d’Un héros de notre temps ne semble pas poser de problèmes majeurs, la traduction de The Song of Igor Campaign (La Geste du Prince Igor, 1960), un texte anonyme, fondateur de la littérature slave, qui remonte au xiie siècle, se révèle bien plus compliquée. Encore une fois, Nabokov traducteur insiste sur la littéralité de sa traduction : « Dans ma traduction de The Song j’ai sacrifié sans pitié la manière à la matière et essayé de restituer une version littérale du texte tel que je le comprends48. » Il ajoute une note où on apprend qu’il avait déjà traduit ce texte quelques années auparavant :
J’ai essayé de traduire une première fois Slovo o Polku Igoreve en 1952. Mon objectif était purement utilitaire – procurer aux étudiants un texte en anglais. Dans cette première version, j’ai suivi sans recul l’édition critique de Roman Jakobson telle qu’elle a été publiée dans La Geste du Prince Igor. Plus tard, cependant, j’ai commencé à être insatisfait non seulement de ma propre traduction beaucoup trop « lisible » mais aussi des réflexions de Jakobson. Les copies ronéotypées de cette version obsolète qui circule toujours à Cornell et Harvard devraient maintenant être détruites49.
Nabokov n’hésite pas à revenir sur son travail de traducteur et à le critiquer ou même à le renier quand il ne respecte pas les critères de traduction littéraliste qu’il a lui-même forgés. C’est la raison qui le pousse à désavouer ses traductions des trois poètes russes, qu’il considère désormais comme trop poétiques. Maintenant c’est le tour de La Geste déjà traduite auparavant et qu’il décide de réviser, modifier amplifier. Il écrira ainsi à son ami Edmund Wilson :
Je travaille d’arrache-pied sur mon livre, que j’avais traduit autrefois mais que j’ai entièrement remanié. Le commentaire que j’en ai fait a hérité d’un gène d’Eugène et menace de devenir un autre mastodonte50.
Le « gène d’Eugène » : le volume, la précision obsessionnelle d’un commentaire qui se voudrait exhaustif. Mais quant au littéralisme, un chercheur attentif et compétent comme Shvabrin observe que La Geste de la campagne d’Igor51 reste plus proche « de la manière que de la matière52 », pour reprendre l’expression de Nabokov. Le fait même que l’ancien titre, Discourse (« dit »), ait été remplacé par Song (« geste ») soulignerait la finalité poétique de sa traduction. Shvabrin va jusqu’à considérer plus littérale la version de Jakobson que celle de Nabokov et voit dans cette traduction une digression entre deux versions littérales, A Hero of Our Time et EO53. On pourrait cependant croire que Nabokov se serait accordé cette « digression », parce que sa compréhension du texte (« tel que je le comprends », écrit-il) serait conforme à sa lecture et à son idée de littéralisme qui l’éloignerait de la version, d’abord approuvée, de Jakobson. Quoi qu’il en soit, une chose est claire : la traduction littérale ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée d’un « gratte-ciel » de notes.
Un outil indispensable : les notes du traducteur
I want translations with copious footnotes, footnotes reaching up like skyscrapers to the top of this or that page so as to leave only the gleam of one textual line between commentary and eternity. I want such footnotes and the absolutely literal sense, with no emasculation and no padding – I want such sense and such notes for all the poetry in other tongues that still languishes in « poetical » versions, begrimed and beslimed by rhyme. And when my Onegin is ready, it will either conform exactly to my vision or not appear at all.
Vladimir Nabokov, « Problems of Translation. Onegin in English54 »
Nabokov n’a de cesse d’œuvrer en faveur du littéralisme et contre toute traduction qui s’éloignerait trop du texte d’origine. Avant même la publication de La Geste et d’Un héros, il écrit et publie des commentaires contenant une partie de ses notes à EO, où il justifie ses choix de traduction : « Notes du traducteur I » et « Notes du traducteur II »55. Il s’agit bien de ses notes en russe que nous avons choisi d’ajouter à ce recueil de textes parce qu’elles confirment, entre autres, que Nabokov s’adresse également aux lecteurs et lectrices russes. À ce propos, dans sa demande pour une bourse Guggenheim pour traduire EO en anglais, il souligne que :
Il n’existe, dans aucune langue (sans faire exception de la langue d’origine), d’édition accompagnée des commentaires exhaustifs que le texte devrait comporter pour être compris et apprécié à sa juste valeur56.
Et d’ajouter :
Puisqu’il n’y a pas moyen de trouver une forme versifiée anglaise adaptée à la complexe structure russe du poème, je suggère non seulement d’en proposer une traduction littérale mais aussi de l’accompagner d’une profusion de notes afin d’expliquer, avec le plus de précision possible, l’effet musical du vers russe et les diverses composantes de la technique de Pouchkine57.
Nabokov cherche à obtenir une traduction proche d’un précis, d’un manuel. Ainsi le traducteur ne remplacerait pas l’auteur tout en pouvant se distinguer dans ses notes qui, elles, non seulement rendent son travail unique et indispensable mais lui permettent de s’exprimer également en sa qualité de savant et de lui donner une visibilité toute particulière. Nabokov devait bien être conscient de l’ambiguïté de sa position. Car les traductions de La Geste et celle d’EO ont inspiré Feu pâle, où Kinbote le critique du poème de Shade (le nom est d’ailleurs bien choisi, Shade restant dans l’ombre de Kinbote), parle surtout de lui tout en prétextant d’être en train de commenter le poème de son feu ami. L’auto-ironie présente dans ce roman drôlatique n’empêche cependant pas notre auteur de progresser sur « le chemin servile » du traducteur. « Le chemin servile » (1959)58 est d’ailleurs le titre d’un autre texte consacré à la traduction. Ce texte contient encore et surtout des notes et des commentaires destinés, cette fois-ci, à un lectorat anglo-saxon, mais la différence entre les notes russes et celles en anglais dont nous avons un avant-goût ici, montre qu’elles s’adressent moins aux profanes qu’à toutes celles et ceux qui, ayant déjà une bonne connaissance du russe contemporain, sont moins familiers avec la langue de Pouchkine. Il en va de même pour la traduction littérale qu’il définit pour la première fois, rappelons-nous, dans la préface à son EO et que nous reprenons ici. Enfin, la traduction littérale se doit de rendre « autant que le permettent les capacités associatives et syntaxiques d’une autre langue, l’exacte signification contextuelle de l’original. Il s’agit là de la seule traduction véritable59 ». La condition « autant que le permettent les capacités associatives et syntaxiques d’une autre langue » compromet, au fond, l’idée de « précision » (que Nabokov attribue à la poésie), qui, d’après Nabokov, ne peut être que contextuelle. Au fond, il considère que la manière (la forme) et la matière (le contenu) ne peuvent coexister en traduction. Est-ce la crainte de devoir reconnaître que la correspondance entre les deux textes ne peut être parfaite qui le pousse à ne pas insister auprès de l’éditeur pour que sa traduction soit, comme il l’avait demandé au préalable, interlinéaire ou avec le texte original en regard ? Le littéralisme et la pléthore de notes que Nabokov demande à la pratique de la traduction ne seraient-ils pas, alors, une façon de reconnaître que la traduction ne peut pas être un art, car elle ne peut être qu’un commentaire du chef-d’œuvre ?
La traduction est-elle toujours un art ?
Dans mes cours, chaque année, je ressens le douloureux besoin d’une telle entreprise puisque ce roman, fondement de toute étude de la littérature russe, ne peut être enseigné correctement, ou apprécié par les étudiants, faute de traduction convenable60.
Revenons donc au titre de premiers essais, « L’art de la traduction », et reprenons l’idée de traduction comme art qui était implicite dans ses premiers écrits. Nous avons vu que l’œuvre d’art, pour Nabokov, était la combinaison de la précision de la poésie et de l’exaltation de la science. Nabokov se rend compte que la précision en traduction ne peut pas être atteinte sinon au prix d’une montagne de notes. Est-ce là le travail « excitant » du scientifique ? C’est à cette faiblesse, si c’en est une, que s’en prend, avec un plaisir presque sadique, l’ancien ami, devenu ennemi, Edmund Wilson dans « L’Étrange cas de Pouchkine et Nabokov61 ». Mais la réponse de Nabokov est celle d’un homme droit dans ses bottes, un homme qui ne parle plus d’art de la traduction mais de « méthode » :
Je me moque de ce qu’un terme soit « archaïque » ou « dialectal » ou argotique. Je suis un démocrate éclectique en la matière et ce qui me convient fait l’affaire. Ma méthode n’est peut-être pas bonne mais c’est une méthode et le véritable travail d’un critique devrait être de l’analyser, au lieu d’aller pêcher de mon étang avec malignité les bizarreries que j’y ai délibérément glissées62.
On dirait que Nabokov a enfin trouvé sa méthode. Elle consisterait à disséquer et à monter, tels les papillons qu’il collectait, le chef-d’œuvre, l’original que la traduction ne peut ni ne doit avoir la prétention de reproduire ni d’imiter. Le modèle reste ainsi inaltéré et la traduction n’est qu’un précis, le travail d’un compilateur, d’un savant. Celui ou celle qui traduit se doit de présenter le texte dans sa nudité structurelle, en explicitant sa genèse, son fonctionnement. C’est là l’éthique du compilateur. Après la polémique suscitée par son EO, Nabokov n’écrira presque plus rien sur la traduction, mais il continuera à réviser sa traduction, pour qu’elle devienne encore plus « interlinéaire » et « illisible » jusqu’à sa nouvelle publication en 197563.
Sur un plan personnel, cet entêtement peut se justifier. Nabokov, au fond, pense que ce qui devrait lui accorder une place dans le Parnasse, avec sa Lolita, n’est pas tant d’avoir repris et fait sien le littéralisme en traduction que d’avoir pu préserver dans son intégrité tout ce que ce poème représente pour la littérature russe et non russe, en donnant « au lecteur américain, et aux Russes qui lisent l’anglais un ouvrage unique et exhaustif sur le sujet64 ». Ce travail représente un double défi : trouver la façon juste de faire les choses, et pouvoir approcher d’une certaine façon, la sienne, la réalité de Pouchkine, à travers sa traduction65. Son EO se devra d’être la référence absolue du chef-d’œuvre de la littérature russe, « un ouvrage unique et exhaustif66 », comme il l’écrit à Katharine White. Depuis l’étranger, dans une langue étrangère, Nabokov a rendu son hommage au plus grand poète russe et à la Russie de son enfance qu’il a vu disparaître67. EO est le couronnement d’une œuvre qui, avec ses écrits et ses autres traductions, a permis de préserver cette mémoire. Mais à quel prix ? « La Russie, écrira-t-il à Edmund Wilson, ne pourra jamais rembourser toutes les dettes qu’elle a envers moi68. »
- 1. Cité par Francine Kaufmann, dans « La Bible Chouraqui : genèse d’une traduction et de ses retraductions au regard des archives », Continents manuscrits, no 21 (« Génétique des traductions », dir. Chiara Montini et Giuseppe Sofo), 2023.
- 2. Vladimir Nabokov, Strong Opinions, New York, Vintage international, [1973] 1990 : Intransigeances, traduit par Vladimir Sikorsky, Paris, Julliard, 1986 ; Partis pris, traduit par Vladimir Sikorsky, Paris, Laffont, 1999.
- 3. « Ou bien le traducteur laisse l’écrivain le plus tranquille possible et fait que le lecteur aille à sa rencontre, ou bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa rencontre. » Friedrich Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire et autres textes [1813], traduit de l’allemand par Antoine Berman et Christian Berner, Paris, Seuil, « Points-Essais », 1999, p. 49.
- 4. « Nowadays – an unheard of case ! – the first of French writers is translating Milton word for word and proclaiming that an interlinear translation would be the summit of his art, had such been possible. » Cette affirmation est reprise d’un article de Pouchkine écrit vers la fin de l’année 1836 ou bien au début de l’année 1837 à propos de la traduction de Chateaubriand du Paradis Perdu. Voir « Introduction du traducteur », dans Aleksandr Pushkin, Eugene Onegin in 4 Volumes : A Novel in Verse, Translated from the Russian, with a Commentary by Vladimir Nabokov, 4 vols., New York, Pantheon Books, Bollingen Series LXXII, 1964, p.1.
- 5. Dorénavant abrégé EO.
- 6. Ibid. Une version révisitée fut publiée en 1976.
- 7. Voir, infra dans ce volume, chapitre 5, « Réponse à mes critiques (par Vladimir Nabokov) ».
- 8. Cette éthique suscite depuis deux décennies un regain d’intérêt. Si les traductions de Nabokov restent une référence, il n’existe pas beaucoup d’études sur Nabokov et la traduction. Ces dernières années, des ouvrages importants à ce sujet ont enfin vu le jour. En particulier, Julia Trubikhina, The Translator’s Doubts : Vladimir Nabokov and the Ambiguity of Translation, Boston, Academic Studies Press, 2015 ; Stanislav Shvabrin, Between Rhyme and Reason : Vladimir Nabokov. Translation and Dialogue, Toronto, University of Toronto Press, 2019 ; Julie Loison-Charles et Stanislav Shvabrin (dir.), Vladimir Nabokov et la traduction, Arras, Artois Presses Université, 2021 ; Julie Loison-Charles, Vladimir Nabokov as an Author-Translator, Londres, Bloomsbury, 2022. Sur Nabokov et la traduction, Julie Loison-Charles et Stanislav Shvabrin ont organisé deux colloques qui ont eu lieu respectivement à Lille (2018) et à Chapel Hill (2019). D’autres études importantes ont été menées par Elizabeth Klosty Beaujour : « Nikolka Persik », « Translation and Self-Translation », dans Vladimir E. Alexandrov (dir.), The Garland Companion to Vladimir Nabokov, chap. 55 et 72, New York, Garland, 1995.
- 9. Vladimir Nabokov, Strong Opinions, op. cit., p. 106. C’est la réponse à la question d’Herbert Gold : « Si vous deviez désigner un livre, un seul grâce auquel votre mémoire survivrait, lequel choisiriez-vous ? » « Celui que j’écris ou plutôt que je rêve d’écrire. En fait, on se souviendra de moi à cause de Lolita et de mon travail sur Eugène Onéguine. » Intransigeances, traduit de l’anglais par Vladimir Sikorsky, Paris, Julliard, 1986, p. 119.
- 10. Les textes anglais sur la traduction de Nabokov ont été réunis pour la première fois dans Vladimir Nabokov, Traduzioni pericolose. Scritti 1941-1969, éd. Chiara Montini, Modène, Mucchi, 2019. Le présent recueil, en plus des essais en anglais, inclut les deux textes russes « Notes à la traduction I » et « Notes à la traduction II ». La majorité des traductions est de Cécile Giroldi.
- 11. Voir, infra dans ce volume, chapitre 5.
- 12. Voir, infra dans ce volume, chapitre 5.
- 13. Publié le 8 janvier 1955 dans New Yorker, repris dans la traduction de Nabokov Eugene Onegin in 4 Volumes : A Novel in Verse, op. cit., p. 9-10. « Qu’est-ce que la traduction ? Sur une assiette,/La tête pâle d’un poète au regard indigné,/Un singe qui jacasse, un perroquet qui caquète/Et les morts que l’on a profanés » : voir infra la traduction complète de Julie Loison-Charles proposée en fin du chapitre 1 (« En traduisant Eugène Onéguine »).
- 14. Brian Boyd, Vladimir Nabokov. The Russian Years, Princeton, Princeton University Press, 1990.
- 15. Julie Loison-Charles, dans Vladimir Nabokov as an Author/Translator. Writing and translating between Russian, English and French (Londres, Bloomsbury, 2022) étudie en détail les pseudo-traductions chez Nabokov, de ses débuts en 1921 jusqu’aux années 1950. Cela confirme l’intérêt de Nabokov pour la traduction qui fut une partie importante de sa formation.
- 16. Brian Boyd, Vladimir Nabokov. The Russian Years, op. cit., p. 187.
- 17. Lewis Carroll, Anja v strane chudes, traduit par Vladimir Nabokov, Berlin, Gamayun, 1923.
- 18. Brian Boyd, Vladimir Nabokov. The Russian Years, op. cit. Nabokov traduisit aussi de l’allemand.
- 19. Vladimir Nabokov, Lettre à John Lang, 28 août 1936, Lettres choisies (1940-1977), traduites de l’anglais par Christine Bouvart, introduction de Dmitri Nabokov, choix des lettres et notes de Dmitri Nabokov et Matthew J. Bruccoli, Paris, Gallimard, 1989.
- 20. Ibid., p. 47.
- 21. Vladimir Nabokov, Lettre du 16 juilllet 1942 à J. Laughlin, Selected Letters, éd. Dmitri Nabokov and Matthew Bruccoli, San Diego/New York/Londres, Harcourt Brace Jovanovich, 1989, p. 42.
- 22. Voir, infra dans ce volume, chapitre 1, « L’art de la traduction I ».
- 23. Vladimir Nabokov, Invitation au supplice. Dans la version française, la préface de Nabokov est absente. Je traduis à partir de la version anglaise : Vladimir Nabokov, Invitation to a Beheading, traduit du russe par Dmitri Nabokov en collaboration avec l’auteur, New York, Vintage International, 1989, p. 7. Traduit en français par Jarl Priel, Paris, Gallimard, 1960.
- 24. Ce mot traduit раздраконю, le mot dont Nabokov se sert à l’origine, et qui a été rendu en français par Olga Anhokina par une longue paraphrase : « dont je ne laisserai probablement pas grand-chose au final » (« Vladimir Nabokov and His Translators : Collaboration or Translating under Duress ? », dans Anthony Cordingley et Céline Frigau Manning (dir.), Collaborative translation. From the Renaissance to the Digital Age, Londres, Bloomsbury, 2016, p. 111-129.)
- 25. Contrairement aux théories sur le cannibalisme en traduction, il ne s’agit pas, ici, de cannibaliser le texte source : c’est l’auteur qui cannibalise la traduction elle-même.
- 26. « J’ai vu les traductions qu’ont fait Yarmolinski et sa femme de Pouchkine : leur travail est consciencieux, raisonnablement exact et soigné mais il leur manque mes exigences premières : le style et un vocabulaire riche. Sans une bonne part d’imagination linguistique et poétique, il est inutile de s’attaquer à ma production. Je contrôlerai le sens précis et les nuances de la traduction, mais mon anglais ne vaut pas mon russe, donc quand bien même aurais-je le temps nécessaire, je ne pourrais parvenir à faire cela seul. Je sais qu’il est difficile de trouver un homme qui connaisse assez bien le russe pour comprendre mes œuvres et puisse retourner son anglais sens dessus dessous et slicer, couper, imprimer une rotation, volleyer, smasher, éliminer, driver, reprendre en demi-volée, lober et placer chaque mot à la perfection ; Yarmolinski poussera doucement la balle dans le filet – ou la fera atterrir dans le jardin du voisin. Tout difficile que ce soit, je pense qu’on peut trouver une telle personne. » (À James Laughin, Lettres choisies, op. cit., 1936, p. 80.)
- 27. Voir, à ce sujet, l’étude d’Elizabeth Klosty Beaujour, Alien Tongues : Bilingual Russian Writers of the « First » Emigration, Ithaca/New York, Cornell University Press, 1989.
- 28. Dmitri Nabokov, qui accepte que sa traduction soit transformée même de façon radicale par son père sans que son amour-propre en souffre, deviendra le traducteur privilégié de Vladimir Nabokov. Voir, à ce sujet, Chiara Montini, Il Clan Nabokov. Quando l’erede è il traduttore, Milan, Mimesis, 2021.
- 29. Voir Stanislav Shvabrin, Between Rhyme and Reason. Vladimir Nabokov, Translation and Dialogue, Toronto, University of Toronto Press, 2019. Le 20 mars 1952, à l’université Harvard, Nabokov présenta une sélection de ses traductions avec les originaux. Une d’entre elles était « Appeasement ». Dans sa postface orale, il avouera avoir pris des libertés avec l’original en expliquant pourquoi il avait décidé de « spécifier » la nature de certaines images. Cité par Shvabrin (p. 241), le texte est un enregistrement appartenant aux archives de Harvard : Vladimir Nabokov Reads his Own Prose and Poetry and his Translations of Russian Poets in English and Russian, Stratis Haviaras et Michael Milburn (éd.), deux audiocassettes, Cambridge, MA, Harvard College Library, 1988.
- 30. Dans « L’art de la traduction I », infra dans ce volume, chapitre 1.
- 31. Between Rhyme and Reason. Vladimir Nabokov, Translation and Dialogue, op. cit., p. 318.
- 32. Op. cit., p. 106. Traduit par Vladimir Sikorsky, Partis pris, op. cit., p. 98 : « L’anglais, le second instrument que j’ai toujours possédé, est cependant une chose un peu apprêtée, artificielle, qui convient peut-être pour décrire un coucher de soleil ou un insecte, mais qui ne saurait dissimuler la pauvreté de la syntaxe et la misère du parler familier quand j’ai besoin du chemin le plus court entre le dépôt et le magasin. Une vieille Rolls Royce n’est pas toujours préférable à une simple jeep. »
- 33. Vladimir Nabokov, Intransigeances, op. cit., p. 25.
- 34. Op. cit., p. 10. Traduit par Vladimir Sikorsky : « Je pense que dans une œuvre d’art il y a une sorte de fusion entre deux choses : la précision de la poésie et la fièvre de la science pure. » (Intransigeances, op. cit., p. 20.)
- 35. Le « I » a été ajouté au titre « L’art de la traduction » pour le distinguer du II. Les deux textes sont édités infra dans ce volume, chapitre 1.
- 36. Vladimir Nabokov, Strong Opinions, op. cit., p. 10. Il ne faudrait que peu de sens commun, qu’il abhorrait, pour croire que Nabokov aurait inversé les termes en attribuant ce qui relève de la science (la précision) à l’art et, vice-versa, ce qui serait plutôt du domaine de l’art (l’exaltation) à la science, mais nous savons qu’il mesure ses paroles et qu’il n’improvise jamais ses entretiens qui sont soigneusement préparés à l’avance. Voir aussi Vladimir Nabokov, Lectures on Literature, « The Art of Literature and Commonsense », New York, Harvest, p. 371-380.
- 37. « L’art de la traduction I », infra dans ce volume (chapitre 1).
- 38. Il est bien connu que Véra Nabokov aidait son mari dans son travail, qu’elle révisait et corrigeait. On ne sais pas à quel point elle contribuait aux traductions, mais on sait qu’elle était polyglotte, très cultivée et avait été traductrice elle-même.
- 39. EO, p. 38.
- 40. Voir, infra dans ce volume, chapitre 1, « L’art de la traduction I ».
- 41. Vladimir Nabokov, Brisure à senestre, traduit par Gérard-Henri Durand, Paris, Juillard, 1978, p. 258.
- 42. « [A]ct like that mad (?) mathematician who used a different principle of measurement at each step of his calculation. » Samuel Beckett, « The German Letter », dans Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, éd. Ruby Cohn, New York, Grove Press, 1984, p. 173.
- 43. Op. cit., p. 44-45. Traduit par Vladimir Sikorsky : « En fait, plus votre science est grande, plus est profonde votre conscience du mystère. En outre, je ne pense pas qu’une branche quelconque de la science moderne ait percé un seul mystère. Le lecteur de journaux en nous a tendance à appeler science l’habileté d’un électricien ou les incantations d’un psychiatre. Il s’agit dans le meilleur des cas de la science appliquée, et une des caractéristiques de la science appliquée est que le neutron d’hier comme la vérité d’aujourd’hui mourront demain. Mais, même si l’on prend “la science” dans son meilleur sens – c’est-à-dire en tant qu’étude de la nature visible et palpable, ou de la poésie des mathématiques pures et de la philosophie pure –, la situation reste tout aussi désespérée. Jamais nous ne connaîtrons l’origine de la vie, le sens de la vie, ni la nature de l’espace et du temps, ni la nature de la nature, ou la nature de la pensée. » (Intransigeances, op. cit., p. 54-55.)
- 44. C’est moi qui souligne. J’avoue que, même aujourd’hui, je ne suis pas sûre de ma traduction de « certaines conclusions » dans le passage cité : s’agit-il, comme on le traduirait instinctivement, de « certaines conclusions » ou bien de « conclusions certaines » ? À la lumière de la lecture de ces conclusions, mais aussi à la lumière de ce qui viendra après, cet essai qui clôt définitivement l’approche tâtonnante où la traduction se situe dans un entre-deux, entre l’art et la science, entre la précision et la transgression, pour privilégier enfin une approche heuristique, le doute que Nabokov ait intentionnellement voulu garder l’ambiguïté entre l’adjectif « certain » et l’adverbe « certain » n’est pas tout à fait dissipé.
- 45. This is my task – a poet’s patience/And scholiastic passion blent :/Dove droppings on your monument. (Verses and Versions, op. cit., p. 17.)
- 46. Vladimir Nabokov, « Préface à Hero of Our Time » : Mikhaïl Lermontov, A Hero of Our Time, traduit par Dmitri et Vladimir Nabokov, Oxford, Oxford University Press, 1984, p. xii-xvi. Voir, infra dans ce volume (chapitre 2), la traduction de Cécile Giroldi : « En tentant de traduire Lermontov, j’ai volontiers sacrifié aux exigences de l’exactitude nombre de choses importantes – le bon goût, la pureté de la diction et même la grammaire (quand le texte russe présentait des solécismes caractéristiques). Le lecteur anglais doit être conscient que le style de la prose de Lermontov est inélégant ; il est sec et terne ; il s’agit de l’outil d’un jeune homme énergique, incroyablement doué, terriblement honnête, mais indéniablement inexpérimenté. »
- 47. Stanislav Shvabrin, Between Rhyme and Reason : Vladimir Nabokov. Translation and Dialogue, op. cit., p. 285-286.
- 48. Préface à The Song of Igor’s Campaign, traduit et dirigé par Vladimir Nabokov, New York, Vintage Books, p. 19. Ma traduction. Je souligne.
- 49. Ibid., note 18, p. 80. Ma traduction.
- 50. Vladimir Nabokov, À Edmund Wilson, 2 mars 1959, Lettres choisies, op. cit., p. 287-288.
- 51. The Song of Igor’s Campaign. An Epic of the 12th Century, traduit du vieil anglais par Vladimir Nabokov, New York, Vintage, 1960.
- 52. On pourrait commenter : « tel que je le comprends », car s’agissant d’un texte du xiie siècle d’un auteur inconnu, le littéralisme demande un effort supplémentaire de compréhension (et donc d’interprétation), ainsi cet élan poétique que Nabokov restitue à la chanson serait-il un espace de liberté qu’il s’accorde faute de précision possible ?
- 53. Between Ryhme and Reason, op. cit., p. 290.
- 54. Partisan Review, XXII, 1955. Publié ensuite dans Lawrence Venuti (dir.), The Translation Studies Reader, Londres/New York, Routledge, 2000, p. 83. Traduit par Chiara Montini : « Ces conclusions peuvent être généralisées. Je veux des traductions avec de copieuses notes de bas de page, des notes de bas de page qui s’élèvent comme des gratte-ciel jusqu’au sommet de telle ou telle page, de manière à ne laisser que la lueur d’un vers du texte entre le commentaire et l’éternité. Je veux des notes de bas de page de cette sorte et un sens absolument littéral, sans émasculation ni remplissage. Je veux un sens et des notes de ce genre pour toute la poésie écrite dans d’autres langues, qui languit encore dans des traductions “poétiques” que les rimes ont souillées et gâtées. Et quand mon Onéguine sera prêt, il se conformera exactement à ma vision ou ne verra pas le jour. » (Voir, infra dans ce volume, chapitre 2, « Problèmes de traduction. Onéguine en anglais ».)
- 55. Voir, infra dans ce volume, chapitre 4.
- 56. Vladimir Nobokov, Lettres choisies, op. cit., p. 180.
- 57. Ibid., p. 181.
- 58. Voir, infra dans ce volume, chapitre 4.
- 59. Aleksandr Pushkin, Eugene Onegin. A Novel in Verse, traduit par Vladimir Nabokov, « Note du traducteur », Princeton, Bollingen Foundation/Princeton University Press, [1964] 1975, p. viii-ix.
- 60. Vladimir Nabokov, Lettres choisies, op. cit., p. 181.
- 61. Voir, infra dans ce volume, chapitre 5.
- 62. Voir, infra dans ce volume, chapitre 5, « Réponse à mes critiques (par Vladimir Nabokov) ».
- 63. Vladimir Nabokov, À Gleb Struve, le 15 avril 1971, Lettres choisies, op. cit., p. 570 : « J’espère que la traduction encore une fois remaniée (et déjà d’une interlinéarité et d’une illisibilité idéales) sortira avant la fin de l’année. »
- 64. Vladimir Nabokov, À Katharine White, le 16 février 1957, Lettres choisies, op. cit., p. 259.
- 65. Vladimir Nabokov, Strong Opinions, op. cit., p. 13.
- 66. Vladimir Navokov, À Katharine White, le 16 février 1957, Lettres choisies, op. cit., p. 259 : « J’ai hâte de finir ma gigantesque œuvre sur Pouchkine et de me remettre à l’écriture romanesque. Ce monstre s’est développé bien au-delà de tout ce que j’avais prévu au départ mais je suis heureux désormais de ne pas avoir reculé devant la tâche – il y a huit ans. Il va non seulement permettre de rendre Eugène Onéguine a accessible au lecteur étranger, mais il va aussi donner au lecteur américain, et aux Russes qui lisent l’anglais un ouvrage unique et exhaustif sur le sujet. »
- 67. Ceux qui, comme Arndt et Lowell, ne connaissant pas ce monde, composent de textes nouveaux en traduisant ne peuvent que subit la foudre de Nabokov. Voir, infra dans ce volume, chapitre 3, « En martelant le clavicorde » et « De l’adaptation ».
- 68. Vladimir Nabokov, À Edmund Wilson, Lettres choisies, op. cit., p. 365.