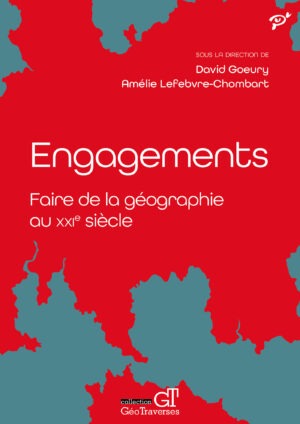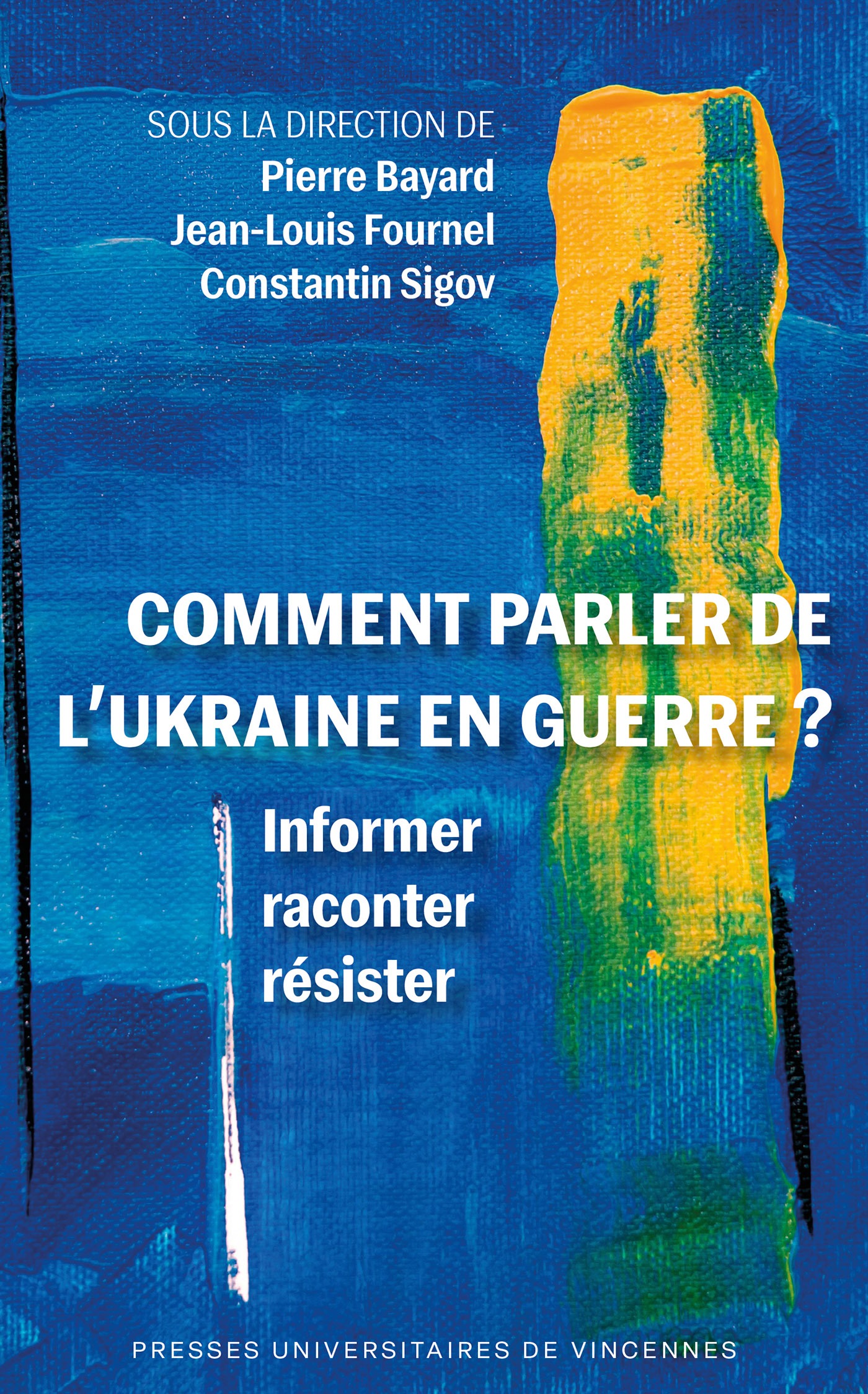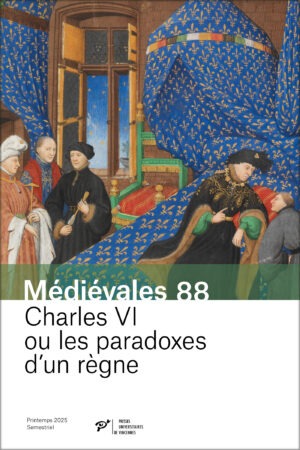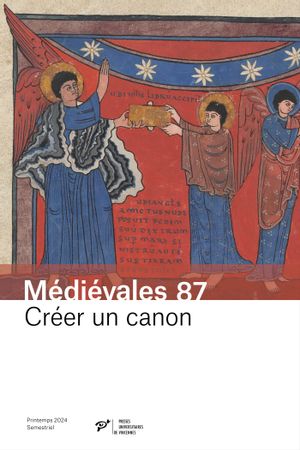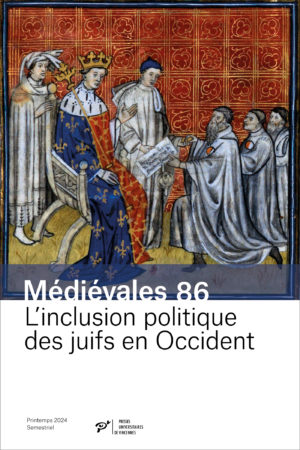Introduction
La guerre, comme le montre à nouveau l’agression russe en Ukraine, transforme le langage. Il en va ainsi, on le sait bien, de la propagande, portée par nature à distendre le lien entre les mots et la réalité, voire à inventer des faits alternatifs, comme l’illustrent, en Russie, non seulement les médias d’État (où le mot même de « guerre » est banni au bénéfice de ce que le régime nomme une « opération spéciale »), mais aussi, fait nouveau, les nombreuses chaînes de pseudo-journalistes russes sur Telegram 1. La place qu’occupe la vieille tradition de la propagande contribue ainsi au « brouillard de guerre » selon l’expression dont on use, et parfois abuse, pour dire combien le tempo et les modalités des conflits compliquent la perception des faits.
De ce fait, si la façon la plus simpliste, la plus vulgaire sans doute, est en effet de réfléchir sur cette question en termes de propagande, elle n’est pas satisfaisante (sans compter qu’elle nous enferme dans d’interminables polémiques). Non que la propagande ne suscite des conséquences parfois terribles, mais ce qu’elle produit reste attendu, ne surprend pas, ne relève pas d’une rationalité audible en tant qu’elle n’est pas instrumentale. On sait depuis longtemps que la première caractéristique d’une tyrannie est de tordre le langage et d’instiller le soupçon sur la vérité, voire sur la possibilité même d’une vérité.
Il en va de même des éléments de langage des politiciens et de leurs « communicants », qui souvent ne sont adaptés qu’à des séquences circonscrites, vite oubliées. Le fonctionnement de la démocratie que nous voulons et devons défendre peut nourrir ainsi malheureusement cette limitation de l’information à ce qui est strictement utile aux gouvernants et à ce qui justifie les décisions qui ont déjà été engagées.
Un dernier écueil auquel peut se heurter toute entreprise de déclinaison des façons de parler de la guerre est de s’arrêter à une sorte de relativisme qui poserait en définitive que la multiplication des énoncés différents et des langages utilisés pourrait justifier une forme de sinistre équilibre sans choix et sans prise de position. Ce serait renoncer à penser les manières possibles de construire une analyse et un jugement, et donc à fournir une aide pour comprendre et discerner une hiérarchie des causalités, fondée sur le compte rendu des responsabilités entre les uns et les autres.
Face à ces impasses il n’existe pas de solution miracle, mais seulement des tentatives, des tâtonnements, des fragments de vérités multiples, qui tous ensemble permettent de présenter un tableau des régimes discursifs de vérité, certes moins ambitieux que ceux des épistémès de Foucault imposant une vérité d’époque, mais sans doute plus humains et plus fragiles, moins livresques et absolus parce que rien n’est absolu dans la guerre, sinon la mort.
Et face à la mort qui menace, informer et raconter, c’est aussi résister et donner une chance à la vie, à une Histoire qui se fait, pour qu’elle ne glisse pas du mauvais côté. Informer, raconter, résister : l’association de ces trois termes, qui figuraient dans le titre de la rencontre à l’origine de ce volume collectif, nous dit ce que celle-ci voulait tenter de thématiser à partir d’une question centrale : comment le rassemblement d’informations possibles et plausibles peut-il contribuer à construire un récit juste, qui ne tende pas seulement à décrire, mais, le cas échéant, selon celle ou celui qui parle ou qui écoute, aide à vivre et à résister à l’insupportable ?
Autrefois, l’écriture de la guerre n’était pas une écriture comme une autre, dans la mesure où elle participait toujours d’une vision du monde avant de vouloir raconter vraiment ce qu’il en était de l’histoire des combats. La rationalisation de l’espace et de l’histoire de ceux qui écrivent comme de ceux qui lisent était une composante du récit de guerre, ce qui suscitait en son sein une forte présence de la tradition et de l’héritage. L’écriture de la guerre se prêtait à un processus de modélisation tout aussi systématique que varié au gré de ses formes et de ses supports (monumentaux ou textuels, poétiques ou historiographiques, fonctionnels, représentatifs et littéraires, techniques, ritualisés ou célébratifs).
L’enjeu de cette écriture fondamentalement répétitive devenait dès lors de passer de la répétition (qui se contente de reprendre et d’imiter) à l’analogie (qui compare pour distinguer, en montrant comment les choses qui se ressemblent ne se recouvrent pas pour autant), afin de mettre en évidence la spécificité de chaque conflit, tout en prenant en compte le fait que le récit d’une guerre tend à ressembler à celui des guerres qui l’ont précédée.
En effet, la narration de la guerre présente une double caractéristique. D’un côté, elle est toujours déjà là, en tant qu’écriture « classique », c’est-à-dire a-temporelle, dans une transmission attendue des heurts des héros et des hommes, qui court si l’on veut de l’Iliade à La Promesse de l’aube. D’un autre côté, elle s’avère toujours lacunaire, dans la mesure où la guerre, par sa nature même, est aussi inscrite dans la radicalité d’un présent riche de surprises et produit une exigence de compréhension de ce que chaque conflit peut présenter d’unique.
Dans cette perspective, la langue mobilisée pour ce type de récit s’exprime à la fois ou tour à tour (selon les lieux, les pratiques ou les textes) par la reprise de matrices/modules (il faut chanter les héros, les amours et les armes depuis Homère et Virgile), par l’aveu de l’incapacité à rendre compte d’une réalité belliqueuse qui garde une part d’indicible et par le dispositif de distinction que produit une logique d’approximations successives autour d’un objet qui ne va jamais de soi.
Il n’est pas sûr que nous nous trouvions encore dans cette situation aujourd’hui pour au moins deux raisons. D’une part, le récit de guerre souvent immédiat n’est plus constitutif d’une logique identitaire a posteriori : il concerne les Ukrainien·nes bien sûr, mais aussi les citoyen·nes du monde ou plutôt, en tout cas, les citoyen·nes d’une Europe qui ont de bonnes raisons de penser que ce qui se passe en Ukraine est annonciateur de ce qui pourrait se passer à moyen terme plus à l’ouest.
D’autre part, les guerres actuelles se disent avec des moyens et selon des positions tellement diversifiées que nous devons transformer nos questionnements sur les façons d’en parler. C’était déjà vrai depuis qu’au récit des historiens attablés à leur bureau s’était ajouté celui des journalistes présents sur le terrain, ces correspondants de guerre dont le rôle s’est accru depuis le milieu du xixe siècle. Mais ce l’est manifestement encore plus depuis que nous vivons l’accélération incessante de la transmission des informations, la multiplication des canaux de sa diffusion, l’articulation toujours plus complexe des mots et des images et la diversification professionnelle de celles et ceux qui s’en chargent 2.
Ce point est d’autant plus crucial que les effets et l’horizon du discours ne sont pas seulement ici de nature cognitive : les langages de la guerre engagent un rapport radical à la nécessité, à la survie, à l’existence même des groupes impliqués. Les enjeux de tout conflit ont en effet ceci de singulier que s’y mêlent inextricablement des conséquences lourdes pour tous les sujets de l’Histoire, de l’individu à la communauté à laquelle il appartient.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il y a un moment où analyser les langages de la guerre ne signifie pas seulement parler du conflit qui leur sert de référent, puisque les façons de le mener et de le vivre sont des indices d’une façon singulière de penser l’avenir de la communauté, donc de faire de la politique autant que de l’information ou de la communication de données. Au-delà de ce qui est dit, au-delà des faits, se dessinent leurs conséquences dans la mesure même où y apparaît une lecture des responsabilités.
Nous avons ainsi voulu réfléchir sur les multiples pratiques de discours suscitées par la situation en Ukraine et sur leurs régimes de vérité, en confrontant les questionnements d’acteurs très divers. Dans la guerre, la véracité des énoncés recouvre des enjeux existentiels. Dire mal, nommer mal, dire ce qui est faux, ce n’est plus seulement ajouter au malheur du monde, comme le posait Camus dans une citation trop souvent répétée, c’est produire un mal nouveau dont les effets ne peuvent être évalués a priori. Ce constat est partagé par celles et ceux qui travaillent avec les mots, qu’iels soient journalistes ou enseignant·es, militaires ou politiques, artistes, juristes, poétesses ou poètes, ce qui ne signifie pas pour autant qu’iels s’accordent pour affronter la question.
Il faut donc essayer sans cesse sinon de dire bien, en tout cas de dire juste. C’est là que, avec modestie mais aussi détermination, les universitaires peuvent jouer un rôle, en dialogue avec celles et ceux qui font un autre métier plus dangereux en temps de guerre, les journalistes et les membres des ONG. Les paroles de ces derniers, qui rendent plus directement compte du monde, croisent les nôtres face à la brutalité aveugle et au mépris des lois des sociétés. Car si informer ou témoigner, c’est raconter une histoire, ce n’est pas raconter des histoires, mais construire un récit qui permette de comprendre, et aussi d’agir et de résister.
Aussi éloignées puissent-elles sembler, toutes ces activités ont en commun de chercher à saisir les situations humaines et concrètes, en conduisant à aller voir sur place ou, quand elles se trouvent à distance de leur objet, à imaginer et à raisonner. Leurs régimes de discours, certes différents, visent à contribuer à l’élaboration non d’une vérité unique, mais d’un dialogue réflexif entre les éléments fragmentaires qui la composent, ici et maintenant.
Nous avons découpé cet ouvrage en quatre sections, correspondant à quatre types différents de discours. La première réunit des interventions de spécialistes du droit, qui tentent, avec la rigueur du discours juridique, de trouver les mots adéquats pour préciser ce crime de masse qu’est la violence sexuelle (Yuliia Chystiakova), pour évoquer le sort des exilé·es de guerre (Jean-Louis Iten), mais aussi pour lutter contre le risque de détournement par l’agresseur de notions comme celle de génocide (Gabriel Sebbah).
La deuxième section est consacrée à une réflexion sur l’éthique. Oleksiy Panych rappelle les positions de quelques grands philosophes sur la guerre et Valentin Omelyantchyk s’interroge sur la manière de dénommer justement le conflit en cours. Volodymyr Yermolenko expose le risque que la violence soit esthétisée, tandis que Gulliver Cragg se demande ce qu’il est possible aux journalistes d’écrire, en s’efforçant de tenir un discours de vérité.
La troisième section est centrée sur les images et la manière dont elles sont utilisées dans ce conflit, où elles peuvent, après vérification, servir de preuves (Christian Delage), et ce d’autant plus aisément que, comme l’expliquent Antoine Garapon et Jean Lassègue, l’open source en facilite aujourd’hui l’accès. Luba Jurgenson expose pour sa part comment les représentations de paysages parlent du conflit, tandis que Ninon Grangé étudie la manière dont des représentations fictionnelles peuvent aider à penser la violence.
La quatrième section porte sur la littérature et sur l’art, qui disposent de moyens originaux pour exprimer l’indicible et donner par là accès à un autre type de vérité. Au plus fort de l’agression russe, comme le montrent Tetyana Ogarkova pour la poésie ou Soko Phay pour l’art, les créateurs et créatrices d’Ukraine n’ont jamais cessé de s’exprimer, illustrant ce rôle décisif de la culture en tant que mode de résistance à la barbarie que rappelle Alexis Nuselovici 3.
Dans un envoi à notre volume, enfin, Barbara Cassin montre, à partir de l’exemple de la version ukrainienne du Dictionnaire des intraduisibles et des autres chantiers de traduction en cours, comment la langue est politique, car « parler une langue est à soi seul un acte de résistance ». C’est aussi cela réfléchir sur la façon de parler de la guerre en Ukraine, grâce à la traduction qui permet de passer d’un monde à un autre et d’imposer la nécessité féconde de « plus d’une langue ».
Enfin, la postface de Constantin Sigov engage à réfléchir sur la conjonction du récit juste et du discours judiciaire, entre littérature, journalisme, poésie, philosophie, histoire et droit, au fil d’une intertextualité éthique.
Aucun de ces discours, évidemment, n’a le monopole de la légitimité ni de l’efficacité, encore moins celui de la rationalité, mais le pari est que leur rencontre peut aider à comprendre les événements en cours, et aussi, car c’est là un enjeu crucial, à ne pas renvoyer dos à dos ceux qui s’affrontent aujourd’hui en Ukraine depuis plus de dix ans, et plus encore depuis le 24 février 2022, avec l’invasion à grande échelle de ce pays par la Fédération de Russie. Ce livre n’est pas écrit après mais pendant une histoire encore ouverte : il voudrait contribuer à réfléchir sur les moyens d’informer, raconter, résister, témoigner face à l’agression 4.
Depuis la fin du mois de janvier 2025, la question existentielle posée à l’Ukraine du fait de l’agression russe se double d’une stratégie du chaos entretenue par certains acteurs, alliés de l’Ukraine. Il n’est pas exclu de penser que rendre la situation incompréhensible est un pas pour décider de ce qui adviendra en se passant de l’avis des principaux intéressés. Il est d’autant plus crucial de déployer sur ces nouvelles narrations toutes les ressources de notre esprit critique, quels que puissent être les développements dans une crise dont à l’heure où nous clôturons cet ouvrage, personne ne peut prévoir l’issue.
Paris, 6 mars 2025
- 1. Voir Le Monde, 18 octobre 2024, « Les messagers russes de la guerre » par Isabelle Mandraud. À cet égard l’arrestation puis la mise en examen par la justice française du patron de Telegram, Pavel Dourov, même si elles ne concernent pas au premier chef son rôle dans la guerre, se chargent d’une actualité singulière.
- 2. Voir par exemple sur ce point le livre de Michele Mezza, Net-war Ucraina : come il giornalismo sta cambiando la guerra, Rome, Donzelli, 2022.
- 3. Voir les poètes et poétesses ukrainien·nes publié·es dans la revue Po&sie depuis début 2023 [https://uacrisis.org/fr/ukraine-face-a-la-guerre-68].
- 4. On rappellera ici que deux des participant·es à cet ouvrage, Tetyana Ogarkova et Volodymir Yermolenko, publient régulièrement en français et anglais des podcasts sur l’actualité de la guerre, comme autant de témoignages précieux et libres. Voir [https://uacrisis.org/fr/ukraine-face-a-la-guerre-41].