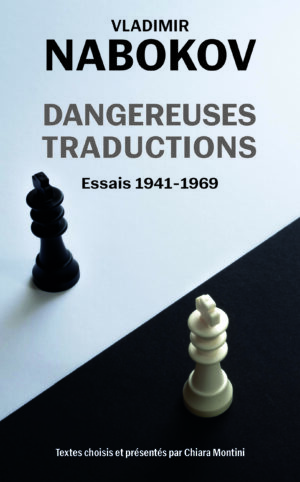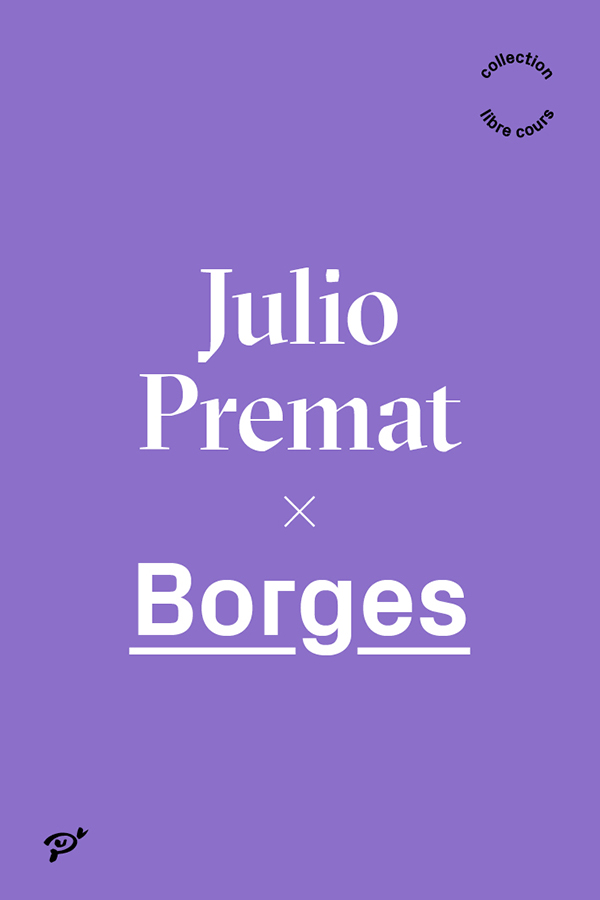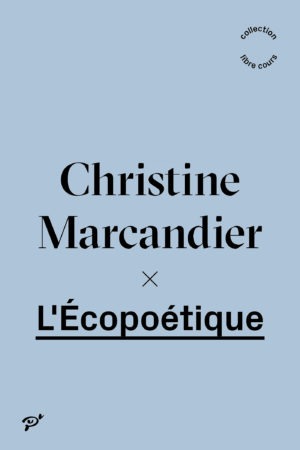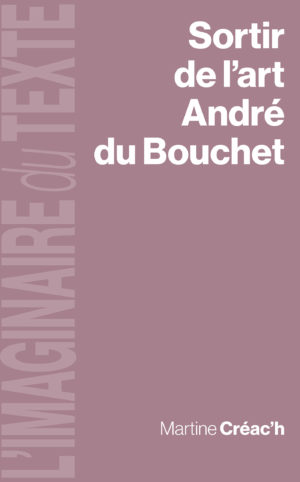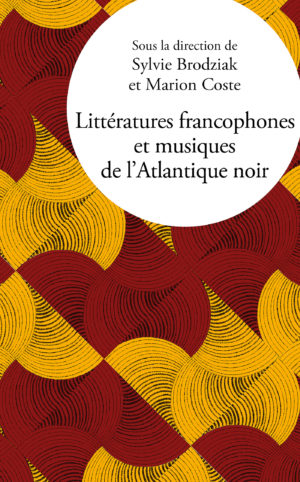Un classique de la modernité
Julio Premat
Si Jorge Luis Borges (1899-1986) est l’un des écrivains emblématiques de la modernité, c’est certainement par l’acuité avec laquelle il a posé les enjeux de l’originalité, du passé et du dialogue avec les héritages culturels mais aussi par sa manière d’interroger l’éventualité même de pouvoir continuer la littérature dans une époque où, d’après Hannah Arendt, la citation et la réécriture devenaient le seul refuge, une époque où la tradition semblait rompue et la perte de valeur des autorités, irréparable (Arendt 2007 : 64). Cette crise de la culture et de sa transmission se trouve accentuée chez Borges par le lieu périphérique de son activité, c’est-à-dire un pays aux faibles traditions littéraires en ce début du xxe siècle ; pour être écrivain il lui fallait se créer en quelque sorte une tradition et inventer les moyens de légitimer sa position face à la littérature universelle.
Car tout comme Proust, tout comme Kafka, Borges a fait du « devenir auteur » une aventure vitale majeure, que ce soit par la mise en scène d’une fiction autobiographique volontiers légendaire ou par le déploiement d’une perspective existentielle qui engage la mort, la perte, l’aliénation et la mélancolie. Pour tous les trois, l’écriture est une tâche à la fois ardue et puissante tandis que la question « Quoi écrire ? » revient, lancinante. Leurs réponses diffèrent : la profusion pour Proust, confronté à la mort et augmentant la masse textuelle à chaque correction de la Recherche ; un infini et un échec, dans l’inachèvement radical de Kafka ; l’allusion à des livres imaginaires que l’on n’essaie pas d’écrire mais qui prolongent l’idéal d’un Livre total, chez Borges. Leurs écritures problématisent jusqu’à l’exaspération la question du sujet (mémoire, dédoublement, aliénation) et celle d’une quête manquée de l’impossible, d’un impossible en dialogue avec un passé fuyant et avec des cauchemars modernes. De surcroît, comme pour la judéité de Kafka écrivant en allemand à Prague, la place culturelle et historique de Borges – l’Argentine – ne lui facilitait pas la tâche bien que, en tant que contrainte, cette place lui a imposé des choix qui ont fini par tracer une originalité littéraire aussi paradoxale que remarquable.
Il est ainsi que Borges est devenu le plus grand classique des lettres latino-américaines dans le sens canonique du terme (place dans les histoires de la littérature ou dans les programmes d’enseignement, référence obligatoire et révérencieuse dans d’autres types de discours), mais aussi par la passion qui a caractérisé sa réception. Lire Borges est une expérience qui laisse une impression de richesse de sens et qui suscite une espèce de compulsion herméneutique ; le résultat, après une soixantaine d’années de commentaires sur son œuvre, est que la production critique sur lui dépasse le concevable ou, pourrait-on dire en paraphrasant le ton volontiers ironique de l’écrivain, la décence.
Si l’on reprend sa propre définition à la fois iconoclaste et fonctionnelle du terme, on peut considérer donc que Borges a été lu comme un « classique ». Un classique est pour lui un livre que pour « diverses raisons les générations des hommes lisent avec une préalable ferveur », supposant que « dans ses pages, tout [est] délibéré, fatal, profond comme le cosmos et susceptible d’interprétations sans fins » (1993a : 818). Pour ses lecteurs, Borges a pu signifier à lui seul la littérature, toute la littérature : une vie et un monde faits de livres, de citations, de parcours infinis dans la bibliothèque, une attirance sans faille pour les effets des mots et un culte de leur agencement esthétique, une curiosité pour tout ce qui touche à l’imagination, à la métaphysique, aux rêves, et une indifférence apparente envers les enjeux politiques des sociétés humaines. Les choses ne sont pas exactement ainsi et un grand nombre de textes viennent contredire cette vision idéaliste, autonome et élitiste d’un Borges érudit – des pans entiers de sa production établissent un dialogue intense et complexe avec les constructions idéologiques et les formes du pouvoir – (Balderston 1993), mais c’est là le cœur de son image. Lire Borges, aimer Borges, c’est aimer la pensée, la réflexion, l’imaginaire, la littérature, du moins dans une certaine vision de celle-ci, une littérature qui conçoit l’homme et le monde dans un dialogue étroit avec la métaphysique.
Quoi qu’il en soit, l’œuvre borgésienne présente une extraordinaire plasticité sémantique et ouvre la voie à des interprétations foisonnantes qui renvoient à des références historiques et à des problématiques très éloignées les unes des autres. Lui, qui a apparemment tourné le dos à sa contemporanéité, qui a exalté le passé et la tradition érudite, qui a revendiqué une transhistoricité de la littérature, lui, qui au milieu du xxe siècle en Argentine tissait des intrigues mythologiques ou chantait les guerriers saxons du Moyen Âge ou bien qui prolongeait les merveilles de Les Mille et Une Nuits, a été aussi l’emblème de toutes les modernités : avant-gardes transformatrices et parricides, désarroi mélancolique devant le temps des mutations, mises en cause des grands mythes littéraires de la tradition (auteur, chronologie, réalisme), intertextualité généralisée, réécritures et pastiches, scepticisme relativisant, hypothèse d’une littérature universelle.
Dans ce processus entravé et complexe du devenir écrivain qui le caractérise, la grande tradition du récit occidental, à savoir le roman de la fin du xviiie siècle au début du xxe, est en quelque sorte éludée. Malgré ses lectures assidues de Faulkner (qu’il a traduit) et de Kafka (encore lui), donc de deux grandes figures du renouvellement du genre, Borges trouvera sa filiation ailleurs. S’il est le grand narrateur sans roman du xxe siècle, c’est parce qu’il prendra ses modèles et sa rhétorique dans la philosophie, dans la théologie, dans des formes propres aux Encyclopédies, autant que dans la poésie, dans la short story anglo-américaine ou bien dans la science-fiction.
Son écriture est faite de textes courts, souvent fragmentaires, qui croisent les genres et constituent, au bout du compte, un corpus atypique marqué par des opérations multiples lors de l’édition ou de la réédition de ses livres (du moins jusqu’à l’établissement du Livre, le volume imposant de ses œuvres complètes qui paraît en 1974). L’histoire de la publication de ses livres est en effet très complexe : premières versions, rééditions corrigées, rééditions avec ajout de textes, prologues et épilogues de dates différentes et parfois déterminants, etc. Il s’agit d’un domaine où la stratégie d’auteur s’est manifestée assez directement : éditer, pour lui, c’était construire une image d’écrivain et délimiter les contours de l’œuvre qu’il souhaitait faire lire, en écartant ce qui dépassait, ce qui gênait, mais aussi en additionnant les opérations interprétatives et indiciaires. Dans ces conditions, il est bien difficile de fixer les limites de l’œuvre de l’auteur, ce qui explique les nombreuses différences entre l’édition française de La Pléiade et l’argentine d’Emecé ; ce sont des éditions posthumes qui ont incorporé des textes laissés de côté par l’auteur tout en écartant d’autres, publiés pourtant séparément. S’il y a un noyau de recueils majeurs et reconnus, la périphérie de l’œuvre reste floue ; l’œuvre de Borges est aujourd’hui un ensemble mouvant.
L’objectif de ce livre est de présenter cette figure d’auteur et cette œuvre, c’est-à-dire de rendre intelligibles des phénomènes d’une très grande complexité tout en évitant de simplifier leur contenu, de limiter leur portée ou de schématiser leur fonctionnement. Cette double contrainte a imposé des choix. Sans renoncer à une vue d’ensemble, il m’a semblé nécessaire ici d’assumer et de développer une hypothèse de lecture et par conséquent de ne pas évoquer tous les sujets possibles ni toutes les interprétations acceptables et encore moins tous les liens de cette œuvre avec ses différentes contextes intellectuels et artistiques. Gérard Genette résumait À la recherche du temps perdu par une phrase, « Marcel devient écrivain » (1972 : 75) ; notre feuille de route ici sera motivée par une question similaire : quelles sont les étapes et les choix esthétiques d’un « devenir écrivain » qui est, dans l’œuvre de Borges, aussi problématique que structurant ? Le geste d’établir une sorte d’autobiographie légendaire devrait permettre d’articuler les différentes étapes de l’œuvre et de rendre compte des nombreuses tensions qui la traversent. Après avoir évoqué des modalités d’autoreprésentation dans la première partie du livre, je proposerai dans un deuxième temps des parcours transversaux qui, sans être exhaustifs, sont en relation directe avec les étapes dégagées dans la première partie. Les lecteurs anglophones ou hispanophones trouveront des compléments bibliographiques et des informations multiples dans le site du Centre Borges de l’université de Pittsburgh [http://www.borges.pitt.edu/].
Un deuxième choix qui régit ce livre a été fait à la lumière de la bibliographie borgésienne disponible. Il y a en France une tradition spécifique de lecture dont les noms historiques sont ceux de Blanchot, Foucault, Genette, Anzieu, parmi d’autres. La plupart des livres qui ont suivi ces premiers textes se concentrent sur certains aspects qui sont les plus intelligibles pour la critique littéraire française et ils insistent sur les volets les plus proches d’elle. Certaines périodes de la production et certaines problématiques sont parfois négligées dans la lecture habituelle de Borges, à l’exception de deux livres de référence disponibles en France : Borges ou la réécriture de Michel Lafon et Le Facteur Borges d’Alan Pauls, livres qui offrent l’avantage, parmi d’autres qualités, d’avoir été écrits par de bons connaisseurs de la littérature argentine. En suivant leur exemple, j’ai essayé ici de mettre l’accent sur des aspects moins connus et moins visibles, en particulier sur les relations de Borges avec les avant-gardes, avec la tradition culturelle argentine ou avec la célébrité dans ses vieux jours.
Par ailleurs, qu’on prenne note des spécificités du corpus borgésien évoquées et qu’on ne me tienne pas rigueur de simplifier à de nombreuses reprises la chronologie de publication ou de choisir une date comme étant celle d’une édition définitive, même si parfois cette simplification et ce choix sont discutables. Il convient en outre de préciser que l’édition française de l’œuvre (dans La Pléiade) est extrêmement irrégulière en termes de traduction ; des erreurs sémantiques évidentes sont parfois commises, ce qui m’a amené à refaire quelques traductions ponctuelles. J’ai traduit moi-même tous les textes tirés d’ouvrages en espagnol. Je remercie les lectures faites par Daniel Balderston et par Federico Calle Jordá du manuscrit de ce livre.