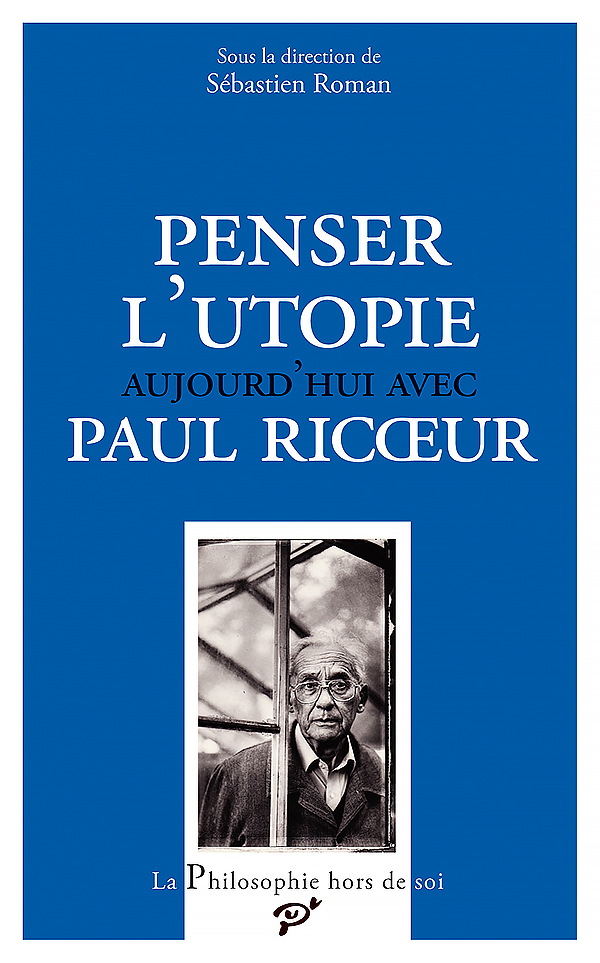Introduction Sébastien Roman Il y a, depuis peu, en philosophie, un certain renouveau de l’utopie, pour ne pas dire une certaine mode, si bien que l’on ne peut plus écrire, comme le faisait encore récemment Miguel Abensour, qu’elle a aujourd’hui mauvaise presse en étant considérée comme un concept désuet et dangereux[1]. Le vieux discours de haine de l’utopie, hérité notamment des ouvrages d’Alfred Sudre et de Louis Reybaud en France[2], et ravivé au XXe siècle par la dénonciation des expériences totalitaires, est peut-être en train d’être dépassé sous la pression d’événements majeurs tels que la crise financière mondiale de 2008, les révolutions des printemps arabes, également suite à la remise en cause – de diverses manières et dans différents pays – du néocapitalisme et de l’hégémonie libérale en politique, ainsi que de la définition de la démocratie par le mécanisme représentatif qui aurait pour défaut de rendre les citoyens trop passifs en limitant la souveraineté populaire à l’élection, sans oublier les problèmes écologiques que sont les nôtres aujourd’hui. Ici et là sont apparus et continuent d’apparaître des mouvements sociaux de contestation qui proposent des alternatives à l’ordre social établi, pour penser la politique et la démocratie autrement. Occupy Wall Street, les Indignés, Nuit Debout, plus récemment les Gilets jaunes en France ainsi que de nombreux foyers de contestation dans le monde – au Liban, au Chili, en Irak par exemple – attestent une mobilisation forte des citoyens. La question se pose de savoir s’il est possible de parler de ces mouvements en termes d’ « utopie », mais il est en tout cas certain, aujourd’hui, qu’un besoin de « changer les choses » se fait ressentir, sans doute d’une manière encore plus forte depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui nous contraint de nous interroger sur les limites de notre propre modèle de croissance. Notre temps est à l’orage, ce qui explique que la question de l’utopie émerge de nouveau et soit ravivée[3]. Or, dans les débats contemporains qui ont précisément pour enjeu de penser l’utopie, contre le risque d’en faire simplement une tendance – ce qui serait une autre façon de prolonger son discrédit – il est frappant de constater que les travaux de Paul Ricœur sont très peu ou pas du tout cités, comme s’ils étaient de faible importance. Certes, l’utopie n’est pas un thème que Ricœur a autant travaillé que ceux par exemple de volonté, de justice, de la mémoire et de l’oubli, ou bien encore de reconnaissance. Il n’en demeure pas moins que l’utopie est à ses yeux capitale, pour la raison simple qu’elle est liée à l’unique problème – celui de la créativité – qu’il a travaillé depuis qu’il a commencé à réfléchir : Pour ma part, lorsque j’aurai terminé ce travail dont nous avons parlé sur le narratif, sur le récit, je voudrais revenir au problème de l’imaginaire social dans une ligne voisine de celle de Castoriadis et de Claude Lefort, c’est-à-dire une réflexion sur le pouvoir. Ce n’est d’ailleurs pas du tout étranger à ce que je suis en train de faire, car, malgré les apparences, mon unique problème depuis que j’ai commencé à réfléchir, c’est la créativité. Je l’ai pris du point de vue de la psychologie individuelle dans mes premiers travaux sur la volonté, puis sur le plan culturel avec l’étude des symbolismes. Mes recherches actuelles sur le récit me placent précisément au cœur de cette créativité sociale, culturelle, puisque raconter […] est l’acte le plus permanent des sociétés. […] Par conséquent, je suis ramené au cœur du problème de la créativité au plan collectif, communautaire. J’ai été silencieux, oui, du point de vue de la pratique et de l’engagement, mais pas du tout sur le plan théorique, car les quelques écrits que j’ai déjà publiés sur le rapport entre Idéologie et Utopie sont tout à fait au centre de cette préoccupation[4]. Créativité, utopie, et imaginaire social : la singularité des travaux de Ricœur est d’intégrer la question de l’utopie dans la figure d’un imaginaire social, indissociablement de la sphère politique. L’idéologie et l’utopie (qui reprend ses cours donnés à l’université de Chicago en 1975) et Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, sont pour cette raison ses deux ouvrages majeurs sur cette notion[5]. Mais dès les années 1950, Ricœur n’hésite pas à parler de l’utopie tout en sachant que le contexte historique rend la notion suspecte et très critiquable. En effet, c’est à la fois le marxisme et sa critique qui invitent à l’abandonner. Le marxisme d’abord : le défaut inhérent à Marx (à partir du Capital[6]), mais aussi à partir de lui ou après lui dans l’héritage tiré de sa pensée, est de condamner l’utopie, plus encore d’identifier l’imaginaire social dans son ensemble à de l’idéologique. Avec Marx puis le marxisme a triomphé l’idée d’une politique juste parce que sans fard, dans la nécessité de se débarrasser de tout imaginaire – illusion, utopie, rêve, symbolique – pour cesser d’être idéologique. Le discrédit de l’utopie se retrouve également du côté de la critique, chez les pourfendeurs du marxisme, mais cette fois-ci au nom de ce que prouverait l’histoire : le communisme, bien que ses partisans s’en défendent, est une utopie politique dont le stalinisme prouverait nécessairement le caractère dystopique. Le XXe siècle a connu ses utopies noires avec le totalitarisme. L’histoire elle-même inviterait à tourner la page. Or Ricœur, de son côté, non seulement ose parler d’utopie mais propose d’en faire le « plaidoyer » : « Ce plaidoyer pour l’utopie, par lequel j’essaie de riposter à la menace du non-sens […][7] ». Même chose dans « Être protestant aujourd’hui » qui date de 1965 : « Si le mot n’était suspect ou ambigu, je dirais : plaidons pour l’utopie[8] ». Et Ricœur tout de suite d’ajouter pour lever toute ambiguïté : « J’appelle utopie cette visée d’une humanité accomplie, à la fois comme totalité des hommes et comme destin singulier de chaque personne[9] ». Cette définition, comme nous l’expliquerons plus tard, revient à la figure de la bonne utopie chez Ricœur sur le plan axiologique. Il convient seulement ici d’en comprendre l’utilité : Ricœur précise son propos car il sait qu’il a toutes les chances d’être mal compris. Aux raisons que nous avons déjà évoquées du discrédit de l’utopie à cette époque, s’ajoute la crainte, propre à Ricœur, d’être confondu avec les mauvais utopistes, ceux qui n’ont en tête qu’un rêve sans du tout se soucier de son caractère réalisable. L’utopie est vitale pour toute société, sans elle il n’y a pas de démocratie. Elle est la désignation d’un « nulle part » ou d’une « extraterritorialité[10] » qui permet de contester le caractère idéologique de l’ordre social établi. Mais si sa « fonction extrêmement positive » est d’être la « percée du possible », elle peut aussi « tomber malade dès qu’elle devient la peinture figée d’une société qui serait créée de toutes pièces, y compris par la violence[11] ». Et Ricœur ajoute : C’est pourquoi les utopistes sont souvent des gens extrêmement dangereux qui ont une idée immobile, non critique de leurs propres rêves. Ils sont même incapables de suggérer le premier pas qu’il faudrait faire dans la direction de leur utopie[12]. L’histoire, en effet, fait apparaître deux sortes d’utopie pour Ricœur, l’utopie littéraire et l’utopie pratique : d’un côté l’utopie comme simple fiction, rêve – qui peut avoir son aspect pathologique quand le rêve devient refuge ou est synonyme d’« évasion[13] » – et de l’autre l’utopie comme projet politique, que l’on accepte de confronter au réel et aux contraintes qu’il impose pour entrer en tension avec lui. Seule l’utopie pratique a de la valeur aux yeux de Ricœur, raison pour laquelle il s’intéresse à Thomas Münzer et non à Thomas More pour ce qui est du fondement de l’utopie, mais aussi particulièrement aux utopies socialistes du XIXe siècle, c’est-à-dire une fois que l’histoire permet réellement à l’utopie de devenir un contre-pouvoir[14]. D’ailleurs, à ce sujet, il est frappant de constater combien Ricœur lie très vite l’utopie à l’éthique de la responsabilité pour distinguer ce que l’on peut nommer une bonne et une mauvaise utopie. Déjà, dans le tome 1 de la Philosophie de la volonté (1950) est affirmée que l’intention, seule, dissociée de l’action, ne vaut rien : « La légitimité d’une intention séparée de l’efficacité de l’action est déjà suspecte. […] Dès que la conscience se replie dans une intériorité méprisante, la valeur est frappée d’une stérilité qui l’altère profondément. […][15] ». Si le chrétien est porteur d’une utopie qui lui est propre, s’il y a un « style[16] » propre au chrétien en politique, tout un chacun ne peut ignorer que l’État est inexorablement « la contradiction non résolue de la rationalité et de la puissance[17] ». Il s’agit autant de se garder « de la critique stérile que de l’utopie millénariste[18] », et pour ce faire, il est nécessaire pour l’utopiste – quelle que soit sa conviction – de lier l’absolu souhaitable à l’optimum réalisable. Ricœur s’inspire de Max Weber pour affirmer que la vie morale est un état de « tension » interne entre l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité[19]. C’est pourquoi tout en exprimant sa sympathie à l’égard du projet marxien – bien des raisons justifiant de « penser qu’une société radicalement égalitaire, où chacun recevrait selon ses besoins et son selon son travail, est la vérité[20] » – il dit ne pas pouvoir s’accorder avec un tel absolu qui ne prend pas suffisamment en compte l’optimum réalisable, rappelant à ce propos les critiques que Weber adresse, pour la même raison, aux socialistes révolutionnaires de la tendance Zimmerwald[21]. L’utopie relève de l’éthique de la conviction pour la désignation d’un absolu souhaitable ; ce n’est pas n’importe quelle conviction qui est proposée, mais un idéal, une idée-limite, une conviction forte ; « absolu » signifie donc une exigence radicale, Ricœur étant convaincu pour sa part que « les choses avancent par des ruptures, par des gens qui posent des actes qui forcent à redistribuer des règles[22] ». Mais l’utopie doit aussi relever de l’éthique de la responsabilité pour être une bonne utopie, car seule la prise en compte de la réalité, ou de l’optimum réalisable pour faire pression sur lui, est ce qui peut la rendre praticable. L’utopie, en conséquence, est identifiée à un idéal dans de nombreux textes ricœuriens. Encore faut-il entendre par là un idéal qui, pour servir d’horizon régulateur et motiver l’action, exige d’une part qu’il ait des racines dans l’expérience – que des possibles non encore actualisés dans le passé mais « sédimentés[23] », c’est-à-dire toujours accessibles, rendent possible son effectivité – d’autre part qu’il donne lieu, en pratique, à des motivations d’agir qui intègrent la question de l’optimum réalisable. C’est uniquement de cette manière que l’utopie peut avoir la fonction de critiquer ce qui est par ce qui doit être. L’idéal ne peut servir de moteur à l’action que si ce qu’il désigne est praticable – a déjà été pratiqué ou peut l’être à titre de possible – et réalisable en partie, à défaut de l’être totalement, sans quoi il n’est qu’une simple idée qui tourne à vide. Par exemple, s’il est tout à fait inconcevable de penser une suppression totale de l’avoir, par laquelle on aimerait mettre fin au problème de la propriété ou du partage entre le tien et le mien, « une juste possession qui distinguerait les hommes sans les exclure mutuellement[24] », et qui revient à imaginer « une relation innocente de l’homme à l’avoir dans une utopie de l’appropriation personnelle et communautaire[25] », est non seulement possible mais nécessaire pour critiquer les dérives liées à la propriété. Autre exemple : après avoir parlé péjorativement d’Ernst Bloch pour son utopie « sans prise historique[26] », Ricœur parle de la dimension dialogique de la Selbstreflexion chez Fichte qui est capable de « fonder l’utopie d’une communication sans entraves et sans bornes[27] » en faisant référence à l’histoire, parce qu’elle peut s’appuyer sur de telles expériences de langage. Autrement dit, l’utopie est un idéal qui ne peut servir d’« horizon d’attente » que s’il bénéficie ou fait référence à un « espace d’expérience[28] », que cette expérience, encore une fois, ou bien soit effective ou déjà effectuée, ou bien soit simplement possible, et ce grâce au recours à la mémoire et à la tradition pour réveiller dans le passé des possibles non encore actualisés : Pour échapper à la fuite sans fin d’une vérité parfaitement anhistorique, il faut tenter d’en discerner les signes dans les anticipations de l’entente, à l’œuvre en toute communication réussie, en toute communication où nous faisons l’expérience d’une certaine réciprocité d’intention et de reconnaissance d’intention […] ; […] le potentiel de sens ainsi libéré de la gangue des traditions peut contribuer à donner chair et sang à celles de nos attentes qui ont la vertu de déterminer dans le sens d’une histoire à faire l’idée régulatrice, mais vide, d’une communication sans entraves ni bornes. C’est par le jeu de l’attente et de la mémoire que l’utopie d’une humanité réconciliée peut s’investir dans l’histoire effective[29]. De cette manière, l’optatif de l’utopie n’est pas une « vaine rêverie », mais est indissociable du registre de l’impératif. À la question de savoir s’il ne vaut pas mieux se débarrasser du terme d’ « utopie » pour revendiquer « ce qui est bel et bien possible[30] », et penser par là ce que la justice doit être, Ricœur répond : Exigence dit bien impératif et pas seulement vœu pieux. Mais je ne voudrais pas non plus réduire l’optatif, ce mode grammatical propre à l’utopie, à une vaine rêverie. L’optatif exige, il conjoint, il convoque l’impossible dans le champ du possible. L’utopie est militante. Une fuite dans le réel est aussi redoutable qu’un consentement à l’impossible justice au nom du tragique. Ni le lyrique, ni le tragique ne doivent dispenser de l’impératif qui arme la lutte pour la reconnaissance[31]. Il y a donc deux manières de rendre l’utopie chimérique : d’une part en restant confiné dans son utopie, en ne se confrontant pas au monde ; d’autre part en partant d’un absolu trop absolu, dont on ne pourrait rien tirer en pratique, ou que l’on ne pourrait pas traduire même partiellement. La mauvaise utopie est celle qui se différencie de l’espérance par son caractère impraticable. L’espérance est une « novation de sens » qui est un « excès de sens[32] » ; par exemple, croire en la résurrection introduit à la fois quelque chose de nouveau dans le monde, et déborde le sens commun en paraissant être une croyance insensée ; mais l’espérance n’est un futur eschatologique que parce qu’elle est « une exigence d’intelligibilité[33] » qui donne à penser par sa dimension et sa visée pratiques. La pression que l’utopie doit exercer sur le réel exige que le réel soit pris en compte pour espérer le modifier. Cela est valable aussi bien dans le jeu des rapports de force qui opposent par exemple des partis politiques, que dans celui de l’ascension et de l’exercice au pouvoir d’un d’entre eux, s’il veut rendre praticable son projet de la meilleure des façons. La bonne utopie n’a donc rien à voir avec la posture du conflit radical – le conflit pour le conflit, au nom d’un idéal absolu sur lequel on ne veut pas transiger – et tout de la recherche du meilleur compromis ou de la meilleure négociation[34]. Le « compromis est toujours faible et révocable[35] », mais c’est désormais le seul moyen dans les sociétés contemporaines de viser le bien commun en raison de la diversité des points de vue et des ordres de grandeur propre à chacun. Le bon compromis n’est pas la compromission : celle-ci advient non seulement quand de mauvaises concessions sont faites, qui lèsent injustement une partie au bénéfice d’une autre, mais quand il y a confusion entre les ordres de grandeur qui avantage l’un d’entre eux, que cette confusion soit volontaire, intentionnelle, ou bien structurellement produite comme c’est le cas avec le capitalisme qui fait que « tout actuellement appartient à l’ordre marchand[36] ». Il peut ainsi y avoir compromission sans conflit, sans négociation autour d’une table, mais si compromission il y a, alors toute discussion est nécessairement faussée ou pipée. Au contraire, le compromis honnête respecte le conflit des valeurs. Il ne « camoufle pas les conflits[37] » en n’étant qu’un « suspens du différend par quoi la violence est évitée[38] ». Non seulement Ricœur parle très tôt et jusque dans ses derniers textes de l’utopie, même si c’est dans les années 70 qu’il approfondit ce thème, mais il y fait également référence pour penser et critiquer son temps, et avec lui l’état de la société instituée. Dès les années 1960, Ricœur a des mots très durs envers la société de consommation, également envers la rationalité instrumentale qui règne dans les sociétés modernes qui sont avant tout des sociétés de la technique. Les sociétés modernes sont des sociétés de l’abondance qui encouragent l’expérience du « mauvais infini[39] », à savoir l’insatisfaction perpétuelle liée à l’insatiabilité des désirs sur le mode de la surconsommation, encore appelé « esclavage de la convoitise[40] ». L’image platonicienne du tonneau percé est devenue une réalité. L’homme contemporain est un consommateur que l’on incite à la boulimie, mais aussi que l’on déshumanise sous l’effet d’une société qui est elle-même déshumanisante : reprenant de l’anthropologie kantienne les domaines de l’avoir, du pouvoir et du valoir[41], Ricœur dit respectivement qu’il s’accorde avec Marx pour dénoncer le malheur de la propriété encouragé par le système capitaliste, « Monstre-Capital[42] » ; il dénonce également que les institutions modernes, sous-entendu même en démocratie, favorisent elles-mêmes des passions du pouvoir : le problème n’est pas seulement que le pouvoir corrompt, mais qu’institutionnellement on encourage une telle corruption ; enfin, sur le plan du valoir, il reproche que la lutte pour la reconnaissance, qui se fait nécessairement par l’intermédiaire de « réalités culturelles », à savoir « à travers des images de l’homme » qui « font toutes la réalité de la culture[43] » – images qui relèvent de la coutume, des mœurs, du droit, ainsi que des arts – ne bénéficie pas des conditions culturelles satisfaisantes pour être non seulement réussie, mais menée de manière équitable par tout un chacun. La rationalité instrumentale gangrène la société – Jürgen Habermas dirait qu’elle la menace d’un point de vue éthique en la « colonisant » – mais c’est aussi elle qui paradoxalement fait que le temps est à l’utopie. L’excellence dans la réalisation pose en effet de manière aiguë la question de la finalité. La rationalité instrumentale, parce que purement technicienne, évince la question du sens pour poser uniquement celle des moyens. Elle ne relève pas du registre de la décision mais du calcul des moyens pour parvenir à n’importe quelle fin, quelle que soit sa valeur. Ce n’est pas le pourquoi qui l’intéresse, mais le comment. Une société technicienne est « très consciente de ses moyens et parfaitement aveugle sur ses buts[44] ». Par le développement de la technique, nous sommes devenus de plus en plus capables de faire des choses, comme on nous fait aimer et désirer le changement pour le changement – le changement perpétuel sous prétexte qu’il serait synonyme d’évolution, de « progrès », et avec lui de « croissance » – et cela dans une logique de la prospective ou de la prévision qui consiste à vouloir se rendre maître autant que possible de l’avenir. D’une certaine manière, c’est donc contre la dystopie technicienne d’une société tournée mécaniquement ou automatiquement vers la croissance que Ricœur rappelle que d’autres utopies ou projets sont possibles, parce que la question de la finalité se pose. « Il y a un service de l’utopie aujourd’hui en un temps où la société a beaucoup de moyens et peu de buts[45] ». Paradoxalement, dans une société où tout devient prévisible, la possibilité de choisir est augmentée et non pas diminuée ; si je peux mieux savoir, calculer ce qui peut advenir demain, alors j’ai davantage la possibilité de faire un choix en connaissance de cause. L’utopie est le « futur remis à notre arbitre » : [C]’est du futur projeté et voulu que naissent les véritables eschatologies : elles s’appellent utopies ; ce sont elles qui dessinent, à la merci du faire humain, l’horizon d’attente ; ce sont elles qui donnent les vraies leçons de l’histoire : celles qu’enseigne dès maintenant le futur remis à notre arbitre. La puissance de l’histoire, au lieu de nous écraser, nous exalte ; car elle est notre œuvre, même dans la méconnaissance de notre faire[46]. Les sociétés de la prospective ravivent d’autant plus la question de la perspective que Ricœur dit en 1985, quand il commente les trois topoï hérités de la philosophie des Lumières[47], que nous ne croyons plus ou très faiblement à une accélération vers le progrès, de même que nous ne pouvons plus affirmer que l’homme maîtrise le cours de l’histoire. Si le temps est à l’utopie, c’est donc d’une part parce que la question de la finalité se pose, d’autre part parce que le modèle hégémonique de la croissance est de plus en plus remis en cause. La perte de sens ravive ainsi la question du sens. Le dialogue de Ricœur avec Michel Rocard en 1991 est sur ce point très intéressant : en s’inspirant de Michael Walzer, Ricœur propose à Rocard de poser la question de ce qu’est être socialiste aujourd’hui, ou de ce que doit être la conception socialiste du capitalisme, en termes de problème de distribution des biens. C’est-à-dire : quels sont ceux qui peuvent être distribués selon les règles du marché, et ceux qui échappent à une telle logique marchande ? Rocard répond en présentant le socialisme comme une utopie sociale née d’une réaction morale à un capitalisme en plein essor, qui a d’autant plus favorisé la richesse sans bornes qu’elle s’est faite au nom de la liberté. « Le socialisme a d’abord été une utopie éthique, celle d’une société radicalement non marchande, ce qui a correspondu sur le plan des idées au fouriérisme par exemple, et dans les faits à une pratique de l’association[48] ». Se disant lui-même socialiste dans l’esprit des « premiers fondateurs du socialisme », à savoir le socialisme comme « une volonté collective de justice sociale, de diminution de la dose d’arbitraire, de réduction des inégalités à ce qui est acceptable avec une répartition des talents, du risque ou de la responsabilité[49] », il affirme ne pas juger incompatible une société de marché avec le socialisme. Ricœur prolonge la discussion en parlant de la nécessité, « sans tarder », de critiquer le capitalisme « en tant que système de distribution qui identifie la totalité des biens à des biens marchands[50] » et, jugeant que la perspective proposée par Rocard mériterait d’être davantage accentuée si l’on veut se donner