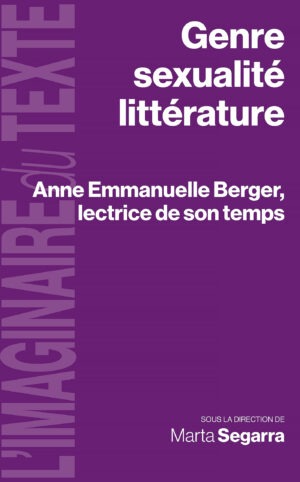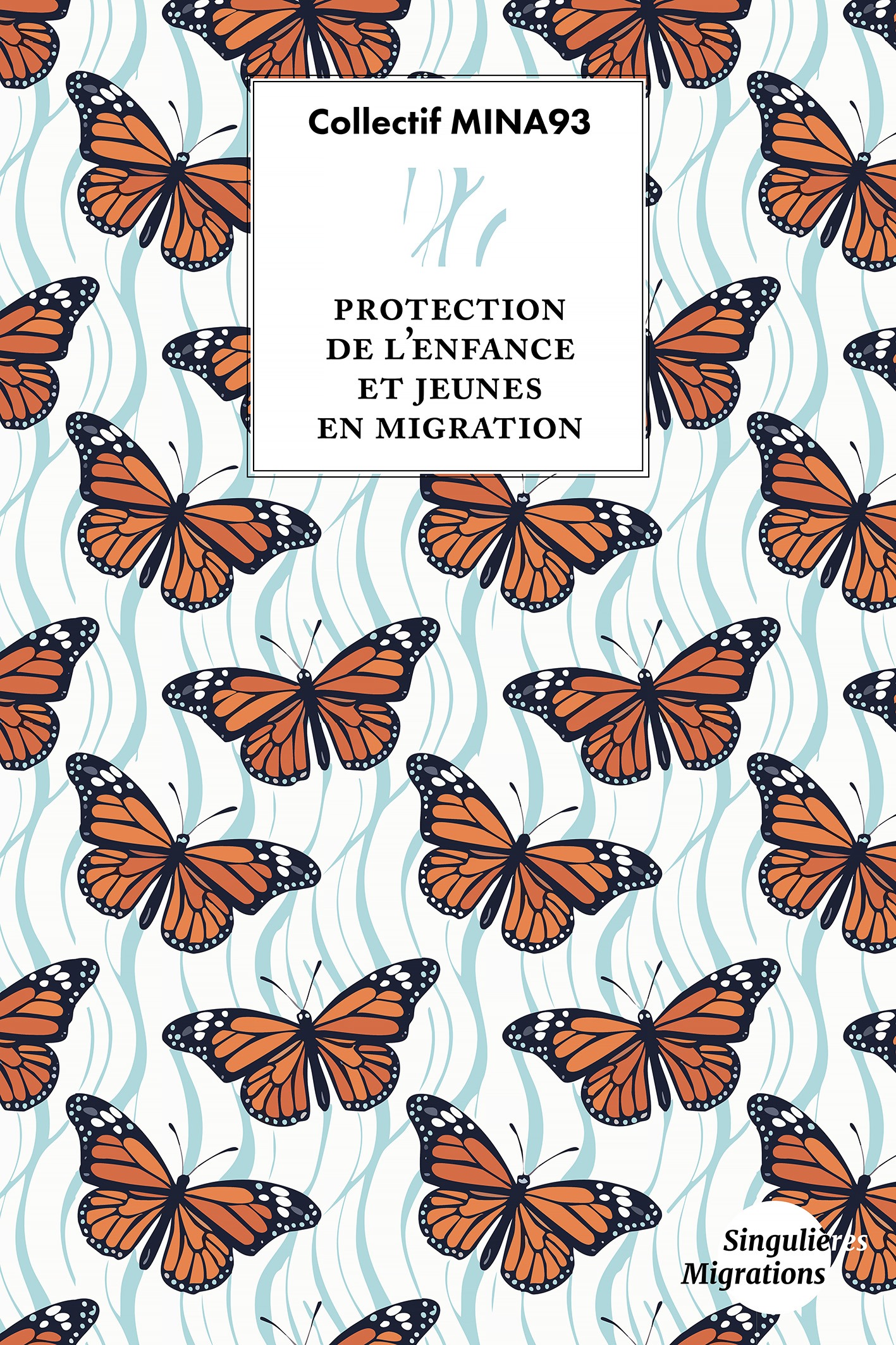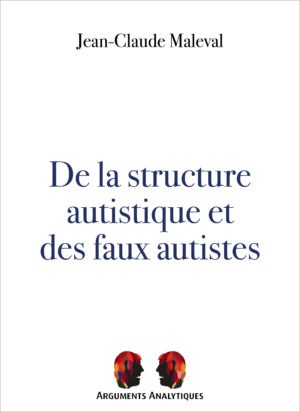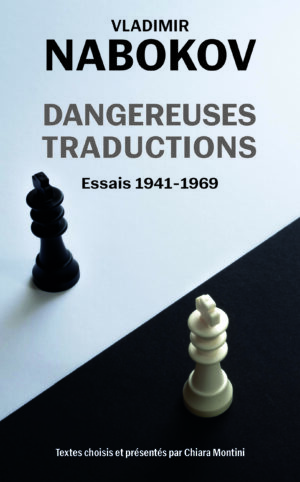Introduction générale
Yasmine Bouagga et Nora El Qadim
Les « mineur·es non accompagnés1 » sont devenus une catégorie à part entière de l’action sociale et, plus largement, d’un débat politique et médiatique concernant l’accueil en France de jeunes migrant·es sollicitant les services de protection de l’enfance. Ce débat clivé oppose deux regards sur ces jeunes, dont on ne connaît pas l’âge précis : d’une part, celui du contrôle migratoire ; d’autre part, celui des droits de l’enfant. Les institutions ont un devoir de protection des mineur·es isolés de leur famille, quelles que soient la nationalité ou les conditions d’entrée en France, sous réserve que l’administration française soit assurée de leur minorité. Sous l’angle du contrôle migratoire, les acteurs institutionnels se méfient d’un recours instrumental à une procédure qui utiliserait les services de protection de l’enfance pour faciliter l’accès au séjour sur le territoire. La multiplication, au cours des années 2010, d’interpellations politiques, de mobilisations associatives, de rapports parlementaires ou de préconisations relatives au respect des droits fondamentaux alerte sur la sensibilité de ce sujet, souvent formulé comme une « crise ». Les services de la protection de l’enfance en charge de ces mineur·es ou jeunes majeur·es se sont décrits comme débordés, en incapacité de répondre aux besoins ou en manque de formation ; en réponse, des unités dédiées ont été créées, spécialisées sur le public des jeunes en migration. Pourtant, la question de leur prise en charge est relativement méconnue, tant au niveau des procédures que de l’expérience des acteurs, et ce alors même que la compréhension de ce qui se fait localement est indispensable pour éclairer les débats publics.
Cet ouvrage propose de contribuer aux connaissances sur la protection de l’enfance et les jeunes en migration, en mobilisant les apports de la recherche et des témoignages de terrain. L’objectif est de permettre une prise de recul par les outils d’analyse des sciences sociales, afin de saisir les enjeux et la manière dont ils se sont constitués dans le contexte français. Cependant, il s’agit aussi d’entendre directement les acteurs de terrain, dans un contexte où l’intensité des débats crée des confusions mettant en jeu leur identité professionnelle, leur travail spécifique auprès des jeunes en migration. La démarche de recherche-action mobilisée vise à informer le débat public par l’analyse des tensions concrètes expérimentées sur le terrain et, dans le même temps, à contribuer à la formation des professionnel·les et bénévoles. Au croisement de plusieurs disciplines – histoire, sociologie, anthropologie, science politique – l’équipe MINA93 propose ici, en partenariat avec les acteurs et actrices de terrain, une approche mêlant l’histoire et l’anthropologie des migrations des jeunes ; la sociologie du travail social ; la sociologie de l’action publique, de ses organisations et catégorisations des publics. Passant au crible de l’analyse différentes notions ou mots communément employés sur le terrain, tels que « parcours », « accompagnement », « autonomie », l’ouvrage fait connaître une diversité de pratiques en même temps qu’il propose un recul réflexif sur celles-ci.
Les « Mineurs non accompagnés »,
une nouvelle catégorie de migration juvénile
Les migrations juvéniles ne sont pas un phénomène nouveau. L’émergence d’un « problème public » de ces migrations a toutefois pris des formes spécifiques à la période contemporaine, conduisant à la création d’une catégorie qui s’impose au secteur de la protection de l’enfance. Dans leur ouvrage Enfances et jeunesses en migration, Virginie Baby-Collin et Farida Souiah soulignent la relative stabilité dans le temps du phénomène de la migration des enfants (2022). Toutefois, le sujet a acquis une plus grande visibilité politique et médiatique notamment du fait de l’augmentation des migrations de mineur·es isolés, désignés comme « mineur·es non accompagnés ». On peut questionner cette migration sous l’angle des trajectoires individuelles, et notamment interroger comment « les jeunesses sont des transitions et des passages qui peuvent rendre à la fois possible et désirable la migration internationale » (op.cit, p. 25). On peut aussi, et c’est la principale approche de cet ouvrage, l’interroger sous l’angle de son traitement institutionnel et des enjeux politiques et compassionnels qui le façonnent.
Ce traitement institutionnel apparaît tout d’abord comme celui de la police et de la justice, confrontées – au cours des années 1990 et au tournant des années 2000 – à un type spécifique de délinquance juvénile étrangère, celle d’enfants des rues, semblant livrés à eux-mêmes ou sous l’emprise de réseaux. Interpellés sur la voie publique ou dans les transports en commun par les forces de police, ils sont confiés à la Protection judiciaire de la jeunesse ou à l’Aide sociale à l’enfance qui, faute de pouvoir identifier leurs représentants légaux sur le territoire (bien qu’ils n’en soient en général pas dépourvus), les place dans des foyers dont beaucoup fuguent. Dans un contexte de forte politisation des questions sécuritaires, ces enfants errants sont vus tant comme en danger que comme dangereux – un phénomène de « panique morale » cible les « petits Roumains », dans un contexte plus large tendant à attribuer l’insécurité aux jeunes étrangers ou d’origine étrangère (Terrio, 2008 et 2009).
Au cours de la même décennie, une autre figure de la migration juvénile émerge, celle des « enfants de Roissy » qui, interceptés au contrôle frontalier à l’aéroport et dépourvus de documents en règle, sont placés en « zone d’attente », espace d’enfermement destiné au traitement de l’immigration irrégulière (Ben Yahmed, 2008). Les défenseurs des droits des étrangers déplorent le vide juridique concernant ces « mineurs isolés étrangers » et ce, alors même que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant, et que des dispositifs concernant les mineur·es isolés demandeurs d’asile avaient été mis en place dès la fin des années 1970. L’enfermement en zone d’attente est dénoncé comme un traitement intolérable pour des mineur·es qui devraient relever en premier lieu de la protection de l’enfance : le dispositif institutionnel qui se met alors en place est façonné par le cadrage moral de l’enfance en danger (Fischer, 2012). Ils sont représentés par des administrateurs ad hoc en charge de veiller à la protection de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Pour éviter que, relâchés de la zone d’attente, les mineur·es ne se retrouvent aux mains de réseaux de prostitution ou de travail forcé, le parquet est saisi pour les placer à l’aide sociale à l’enfance – ce sont donc les départements qui en ont la responsabilité, en premier lieu la Seine-Saint-Denis.
Une catégorie particulière d’enfance en danger commence à s’institutionnaliser et à se traduire dans des pratiques professionnelles : ainsi par exemple, la création dans le logiciel statistique de gestion des dossiers de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis d’une catégorie « Mineur Isolé ou Errant » (MIE), qui, progressivement, sert à encoder les situations de migrations juvéniles – pourtant très diversifiées, dans leurs motivations comme dans leurs moments, comme l’a montré Angelina Etiemble (2002). Julien Long expose dans la première partie de cet ouvrage les spécificités de ces situations selon les moments et les lieux. Là où des concentrations importantes de jeunes sont constatées, notamment à Paris avec les jeunes Afghans au milieu des années 2000, des dispositifs ad hoc sont expérimentés, sollicitant des associations issues de l’aide aux étrangers et de l’humanitaire international. En 2015-2016, lorsque le nombre d’arrivées de demandeurs et demandeuses d’asile augmente fortement en Europe, les mineur·es isolés sont aussi bien Afghans que Syriens, Soudanais ou Érythréens. Mais c’est dans les années qui suivent ce pic que le nombre de jeunes migrant·es se déclarant mineur·es auprès des services de l’aide sociale à l’enfance connaît une croissance importante, avec une large majorité de garçons (95 %) en provenance d’Afrique de l’Ouest, en premier lieu la Guinée. Il s’agit là d’une particularité française : au niveau européen, les mineur·es non accompagnés originaires d’Afghanistan représentent le groupe le plus important et constituent plus de la moitié des demandes d’asiles enregistrées par des mineur·es non accompagnés, selon les données des organisations internationales (UNHCR, UNICEF, IOM, 2022). Les pays européens ont, il faut le noter, des approches contrastées de la prise en charge des jeunes en migration, certains privilégiant l’orientation vers le dispositif de l’asile, quand d’autres, comme la France ou l’Espagne, mobilisent la protection de l’enfance (Senovilla-Hernandez, 2010). L’augmentation des arrivées conduit à dessiner une nouvelle géographie de cette migration juvénile, à mesure que la responsabilité de la prise en charge est assignée aux services de protection de l’enfance de départements auparavant peu concernés par la migration (Przybyl, 2017 ; Lardeux, 2018).
De plus, avec l’augmentation de sollicitations directes par les jeunes, des services de protection de l’enfance, les institutions se dotent de dispositifs spécifiquement destinés à examiner leur éligibilité à la catégorie « mineur non accompagné ». Cette désignation, produit d’une harmonisation européenne, fait disparaître toute référence à l’extranéité, comme pour affirmer une égalité de traitement des individus sous l’unique angle de leur minorité. Mais ce sont bien des dispositifs spécifiques pour les mineur·es étrangers qui sont mis en place, tant pour leur entrée dans le système de la protection de l’enfance que pour leur prise en charge et accompagnement. L’émergence de la catégorie de « mineur·e non accompagné » tient ainsi moins à l’apparition de formes particulières de migrations (puisque ces migrations juvéniles, notamment de jeunes garçons, ne sont pas nouvelles) qu’aux réponses institutionnelles apportées, au niveau national comme au niveau européen (Pettenella, 2022). Celles-ci remettent en cause, par les logiques protectrices de la protection de l’aide à l’enfance, les pratiques de répression des migrations.
Cette remise en cause est le fait de la mobilisation d’acteurs humanitaires et d’acteurs issus du militantisme pour les droits des étrangers, pour qui le « mineur isolé » est vu comme un·e migrant·e vulnérable par hypothèse, et de manière inconditionnelle (Fischer, 2012). Les associations jouent un rôle fondamental dans l’assistance aux personnes étrangères mais aussi dans les évolutions des politiques les concernant et dans leur mise en œuvre. La politique migratoire contemporaine se fait « avec, et en partie par, les associations de la cause des étrangers » (Pette, 2014). Ces associations investissent tout particulièrement l’arène juridique, au moyen de recours dont certains font jurisprudence, de sorte que les intermédiaires du droit (juristes, avocat·es, interprètes, etc.) jouent un rôle important dans le parcours des personnes en migration et dans la mise en œuvre des politiques migratoires (Miaz, Odasso et Sabrié, 2021). Dans le cas des mineur·es non accompagnés, le militantisme juridique n’a pas consisté à contester le régime appliqué aux personnes étrangères – comme pour les autres publics migrants (Israël, 2003) – mais plutôt à exiger l’application du droit des enfants, des dérogations et des protections spécifiques prévues pour les mineur·es. Une figure importante de ce militantisme est le magistrat Jean-Pierre Rosenczveig, qui a présidé le tribunal pour enfants de Bobigny de 1992 à 2014, a participé à différents comités pour la protection de l’enfance et a publié de nombreux textes sur la question des « mineurs étrangers isolés » dès la fin des années 1990 (Rosenczveig, 2004).
Le caractère particulièrement sensible du sujet en France se traduit par la multiplication d’articles, de rapports associatifs et institutionnels au cours des décennies 2010-2020. On peut ainsi citer : le rapport « Les mineurs isolés étrangers en France » de la sénatrice Isabelle Debré (2010) ; le rapport « Évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés étrangers mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013 » (Debart et al., 2014) ; le rapport d’information au Sénat « Mineurs non accompagnés : répondre à l’urgence qui s’installe » remis en 2017 par Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy ; le rapport de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance (Ramadier et Goulet, 2019) ; le rapport d’information au Sénat « Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale » (Bourgi, 2021) ; le rapport d’information à l’Assemblée nationale « sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés » (2021) ; le rapport de la Défenseure des droits « Les mineurs non accompagnés au regard du droit » (Hédon, 2022). À cela s’ajoutent des rapports d’inspection des affaires sociales, des rapports de la Cour des comptes, des rapports portant sur certains départements, et les travaux de recherche2.
Cette sensibilité particulière du sujet tient à l’identification des mineur·es non accompagnés comme vulnérables selon les critères universels de la Convention internationale des droits de l’enfant, impliquant une action de protection quelle que soit la situation spécifique ou le parcours individuel. Comme lors de la controverse sur les étrangers malades (Fassin, 2001), la question des jeunes migrant·es active tout à la fois des logiques de répression (raidissement des contrôles migratoires) et de compassion (vulnérabilité des enfants ou adolescent·es). La cristallisation des émotions morales relatives à la souffrance des enfants participe à une « économie morale » propre à l’époque contemporaine (Fassin et Eideliman, 2012). Le sentiment que l’atteinte à l’enfant est intolérable mobilise la société civile comme le politique et l’idée est validée par la jurisprudence. Toutefois, cette circulation émotionnelle entre en tension avec des pratiques concrètes relatives au traitement migratoire, celles de l’exclusion de personnes migrantes au nom de la souveraineté et des frontières. Pour comprendre l’action publique, il convient dès lors d’interroger les rapports de pouvoir entre les acteurs mais aussi les contours de l’État social, autrement dit ses divisions territoriales (État central/collectivités locales), son hétérogénéité (acteurs publics, parapublics, associations, etc.) et les débats moraux qui traversent l’ensemble. La prise en compte de cette complexité permet d’éclairer les hésitations, les frustrations, les sentiments d’incohérence et de contradiction observés sur le terrain.
Ces tensions sont d’autant plus fortes que les questions migratoires sont davantage politisées et que les législations successives durcissent les modalités d’entrée et de séjour des étrangers en France (Hamidi et Fischer, 2016). Cette évolution engage des logiques de soupçon vis-à-vis des « faux mineurs », tout comme on l’observe, en parallèle, vis-à-vis des « faux demandeurs d’asile », sommés alors de démontrer leur vulnérabilité (d’Halluin-Mabillot, 2012) : des modalités de contrôle de la fraude sont mises en place, ainsi qu’un fichier d’identification biométrique qui devient progressivement obligatoire. Avec cette logique de durcissement, les taux de reconnaissance comme « mineurs non accompagnés » baissent et conduisent à exclure un nombre croissant de jeunes hors de toute protection : un phénomène qu’il ne faut pas négliger même si, dans le même temps, le nombre de jeunes pris en charge augmente.
Une spécialisation des services
d’aide sociale à l’enfance
La cellule nationale mise en place par le ministère de la Justice estime que le nombre de jeunes reconnus mineur·es non accompagnés par les départements est passé de 8 000 en 2016, à 17 000 en 2018. Si cette augmentation n’a rien d’un phénomène migratoire massif et qu’elle demeure concentrée dans quelques départements (départements franciliens et des Hauts-de-France, Métropole de Lyon, Bouches-du-Rhône et Gironde), elle conduit néanmoins les services de protection de l’enfance à se déclarer saturés. Les conseils départementaux sont quant à eux peu enclins à assumer une charge financière qu’ils estiment du ressort de l’État, au titre de sa compétence en matière migratoire (Crombé, 2019). Les services de protection de l’enfance sont au cœur des tensions, alors qu’ils connaissent, sur la même période, de profondes mutations : beaucoup sont en effet déjà en difficulté pour assurer leurs missions habituelles, du fait du manque de moyens financiers et de difficultés de recrutement.
Des services de protection de l’enfance se trouvent dans l’incapacité d’accueillir normalement le public des mineur·es non accompagnés : les délais de prise en charge s’allongent, le recours au placement hôtelier non conforme aux agréments de protection de l’enfance se systématise… partout, on bricole des solutions d’urgence, faute de mieux. Le nombre de jeunes non reconnus mineur·es et laissé·es sans aucun secours s’accroît, créant de nouvelles mobilisations solidaires autour de cet entre-deux qui conduit à les désigner comme « mijeur » (Perrot, 2016). Certaines collectivités comme Paris ou la Métropole de Lyon (qui ont les compétences départementales) mettent en place à partir de 2020 des dispositifs d’hébergement d’urgence et d’accompagnement pour ces jeunes qui sont recalés à l’entrée de la protection de l’enfance mais en recours devant le juge des enfants. Dans un contexte d’aide sociale à l’enfance en difficulté, l’intervention d’acteurs administratifs, judiciaires mais aussi associatifs ou citoyens participe à produire des formes complexes et enchevêtrées de prise en charge, alors que les situations de non prise en charge sont aussi préoccupantes et soulèvent le problème des « oubliés » de la protection de l’enfance, parfois livrés à des situations d’exploitation et de mise en danger (Peyroux, 2020).
Revenons rapidement sur l’organisation institutionnelle de la protection de l’enfance en France : sa genèse remonte au décret de la Convention de 1793, qui prévoyait que la Nation « assure l’éducation physique et morale des enfants abandonnés ». Plus près de nous, l’ordonnance du 2 février 1945 a introduit dans le droit français l’idée que tout·e mineur·e, même délinquant·e, doit avant tout être protégé·e. L’Aide sociale à l’enfance a été créée, suivie, en 1958, par la mise en place d’une juridiction compétente pour le placement des enfants. Les services de l’État sont en charge à la fois de l’enfance en danger et de l’enfance délinquante. Suite à la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant et aux lois de décentralisation, la législation de 1989 sur la protection des mineur·es et la prévention des mauvais traitements crée le dispositif départemental. Ce sont donc les services des conseils départementaux qui ont la responsabilité de l’aide sociale à l’enfance. L’État conserve la compétence sur les mineur·es visés par une sanction pénale, avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui travaillent en articulation avec l’aide sociale à l’enfance mais relèvent d’une administration distincte. Cette évolution, actée par la loi de 2007, tend à segmenter la protection de l’enfance et à transformer les missions des éducateurs et éducatrices (Sallée, 2016).
Sur le plan de la procédure, depuis 2007, l’action de protection est enclenchée par un signalement, document adressé à l’autorité administrative (conseil départemental) ou judiciaire (tribunal pour enfants) comprenant une évaluation de la situation de l’enfant en danger (Rault, 2013). Lorsqu’un·e jeune sans autorité parentale reconnue sur le territoire est pris en charge par les services de protection de l’enfance, il y a une double décision : administrative et judiciaire (ordonnance de placement). Toutefois, s’agissant des jeunes migrant·es, la logique de cette procédure diffère puisque, à partir de 2016, la plupart ne sont pas signalés par un tiers habilité mais se présentent pour demander une protection, ou sont orientés par des associations d’aide, des collectifs, des personnes solidaires. Comme ces jeunes arrivent pour la plupart sans document d’identité, se pose la question de l’évaluation de leur âge. Les conseils départementaux les plus sollicités mettent en place des dispositifs d’évaluation dédiés, souvent en impliquant des associations expérimentées dans le domaine des migrations. L’usage de déterminations physiologiques est controversé, pour des raisons éthiques comme pour leur imprécision : la circulaire Taubira de 2013 impose une procédure pluridisciplinaire d’évaluation s’appuyant sur une observation et des entretiens socio-éducatifs. Si ces procédures visent à mieux protéger les droits, elles n’en traduisent pas moins le renversement de la logique qui prévalait auparavant dans la protection de l’enfance. En effet, au lieu d’une logique dans laquelle le signalement d’un danger conduit à l’activation d’une protection, s’impose celle où la sollicitation d’un service conduit à la vérification de l’éligibilité du demandeur. Cette logique introduit aussi le soupçon de fraude, maintenant le recours par les juges à des méthodes d’objectivation de l’âge pourtant estimées peu fiables, comme les tests osseux (Lendaro, 2020) et justifiant la création en 2018 d’un fichier biométrique géré par la préfecture pour identifier les jeunes (fichier AEM, « aide à l’évaluation de minorité »), et éviter qu’ils ne tentent leur chance dans plusieurs départements.
L’action des services de protection de l’enfance est d’ordinaire organisée sur une base territoriale (circonscription), en fonction du domicile des parents. Pour les enfants sans autorité parentale connue sur le territoire, cette organisation du travail s’avère inopérante dans les départements accueillant plusieurs centaines de mineur·es non accompagnés. Les services mettent alors en place des systèmes d’affectation tournante, ou bien créent une division distincte spécifiquement affectée au suivi de ces jeunes. Ensuite, bien que ces jeunes soient censés être traités sans distinction parmi l’ensemble du public de la protection de l’enfance, en pratique les services s’adaptent à l’augmentation de leur nombre en créant des voies particulières pour l’hébergement ou l’accompagnement, considérant que ce public est plus mature que le public habituel de la protection de l’enfance. Des dispositifs moins coûteux sont mis en place plus rapidement, visant à amener les jeunes plus tôt à l’autonomie notamment en tenant compte de leur situation administrative au regard du droit au séjour. Ces dispositifs spécialisés se répandent au niveau national à travers des appels d’offres par lesquels les conseils départementaux délèguent à des prestataires spécialisés l’accompagnement de ces jeunes (Zougbédé, 2022). Il ne s’agit pas pour autant uniquement de dispositifs au rabais : dans certains départements, ces structures bénéficient d’un engagement financier conséquent, y compris pour le soutien aux jeunes majeur·es.
Comment comprendre le paradoxe de services de protection de l’enfance, qui admettent les mineur·es non acccompagnés de façon inconditionnelle, au nom de principes universels, mais qui développent des prises en charge spécialisées pour ces jeunes en migration ? Il importait d’entrer dans la « boîte noire » de la protection de l’enfance : s’intéresser concrètement au travail des agent·es des services départementaux, partenaires (en premier lieu, les associations agréées) pour comprendre les modalités de prise en charge, les spécificités du suivi, les objectifs assignés. Construite à l’occasion d’un partenariat entre l’Institut Convergences Migrations et le conseil départemental de Seine Saint-Denis, cette recherche-action a permis d’observer un terrain central pour comprendre la formulation de la « crise » de l’accueil des jeunes en migration et la réponse institutionnelle.
La Seine-Saint-Denis, laboratoire de la « crise » ?
Laboratoire malgré lui d’une « crise » de l’accueil des mineur·es non accompagnés, le département de Seine-Saint-Denis est à l’origine d’évolutions majeures du dispositif au niveau national pour répondre à une situation d’incapacité des services à poursuivre leur fonctionnement routinier face aux nouveaux besoins. La Seine-Saint-Denis, territoire francilien au nord-est de Paris, présente le taux le plus important de personnes immigrées dans sa population (30 %) parmi les départements de France métropolitaine (Service de l’observatoire départemental, 2019). En raison de sa position géographique proche de la capitale, de l’implantation antérieure de communautés immigrées, mais aussi de la présence de services comme des foyers de travailleurs migrants ou des associations d’aide, elle est un territoire privilégié d’entrée des primo-arrivant·es. Ajoutons que le principal aéroport international, Roissy Charles de Gaulle, est implanté à proximité de ce territoire, faisant de son tribunal la juridiction compétente pour le contentieux de l’entrée irrégulière aérienne. La Seine-Saint-Denis est confrontée de façon précoce (comme Paris, Lille, la région calaisienne et Marseille), à la question de l’accueil des jeunes en migration. Le conseil départemental interpelle l’État pour être accompagné dans la mise en place d’une « politique digne en faveur des mineurs isolés » (Roméo, 2009). Du fait d’une accumulation de problématiques, tenant non pas seulement au simple nombre de jeunes pris en charge mais aussi aux difficultés de financements des politiques sociales d’un département qui est à la fois l’un des plus pauvres de France et qui, marqué à gauche, tient à maintenir des services sociaux ambitieux, la question des mineur·es non accompagnés va cristalliser, courant 2011, de fortes tensions entre le conseil départemental et l’État. Le président (socialiste) du conseil départemental, Claude Bartolone, dénonce une politique gouvernementale qui se défausse sur quelques départements de l’accueil des mineur·es non accompagnés, sans apporter l’appui budgétaire nécessaire : « On demande aux plus pauvres d’accueillir plus pauvres qu’eux », déclare-t-il dans un entretien au journal Libération le 23 juillet 2011. Dans un contexte d’opposition au gouvernement de droite et à la politique répressive de Nicolas Sarkozy, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis s’engage dans un bras de fer pour obtenir une répartition des mineur·es non accompagnés sur le territoire. Celle-ci est mise en œuvre avec quelques départements et non sans un certain tâtonnement. En 2013, sous un gouvernement de gauche, une mission est créée au niveau national ainsi qu’une « clé de répartition » : celle-ci vise à définir des quotas de mineur·es non accompagnés à prendre en charge par les départements en fonction de leur capacité d’accueil, mesurée à partir de différents critères dont la part de jeunes dans leur population. Ainsi, cette clé de répartition permet de plafonner le nombre de jeunes à prendre en charge en affectant certains mineur·es non accompagnés vers d’autres départements. Cependant, la Seine-Saint-Denis, dont la population est jeune, accueille un nombre de mineur·es non accompagnés supérieur à celui d’autres départements, notamment ruraux : par exemple, pour l’année 2019, la clé prévoyait l’affectation par décision judiciaire de 2,96 % des MNA vers le département de Seine-Saint-Denis, soit 495 sur 16 760. Par comparaison, un département comme le Tarn en accueillait 93 la même année, pour une moyenne de 173 au niveau national, selon les tableaux de suivi annuels publiés sur le site internet du ministère de la Justice. De plus, la clé de répartition n’entre en action qu’au moment de l’ordonnance de placement et donc n’affecte pas le moment de l’évaluation et du premier accueil : le conseil départemental de Seine-Saint-Denis indiquait ainsi recevoir en 2018 entre 186 et 429 jeunes par mois, pour une moyenne mensuelle de 260 jeunes. Le nombre de jeunes pris en charge durablement après avoir été confiés à l’aide sociale à l’enfance était de 1 155 mineur·es cette année-là et 299 jeunes majeur·es. Les MNA représentent alors une part très significative du public accueilli par l’aide sociale à l’enfance : un quart en 2018, un tiers en 2019. Parmi eux, les jeunes majeur·es représentent une part croissante (voir graphiques « Évolution de la part des mineurs non accompagnés » et « Âge des MNA parmi les jeunes pris en charge par l’ASE », p. 20 et 21). Cette évolution du public et les problématiques spécifiques d’accompagnement ont conduit à la décision de créer, en septembre 2018, un service spécialisé, la CAMNA (Cellule d’accompagnement des mineurs non accompagnés). Par ailleurs, afin de faire face aux besoins d’hébergement, un appel d’offres a été lancé pour la création de plus de 800 places. Dans le même temps, le bras de fer avec l’État s’est poursuivi pour obtenir un appui financier à l’évaluation d’un nombre croissant de jeunes, pour refuser le recours au fichier biométrique de la préfecture et enfin, pour protester contre les délais d’attribution de rendez-vous pour les titres de séjour des jeunes atteignant la majorité.
Le choix de la recherche-action :
créer une communauté participative
Cette recherche est issue du regroupement de chercheuses et chercheurs en sciences sociales qui, au sein de l’Institut Convergences Migrations, ont répondu à une proposition de partenariat avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis dans une perspective de dialogue sciences-société. En mobilisant des approches disciplinaires complémentaires dans les sciences sociales (sociologie, anthropologie, histoire, science politique), l’équipe « MINA93 » a soumis un projet d’étude de la mise en place du dispositif spécialisé de prise en charge des mineur·es non accompagnés dans les services de l’aide sociale à l’enfance. Alors que l’équipe de recherche bénéficiait de l’appui de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, le démarrage de l’enquête avec les équipes de la direction enfance et famille du département s’est heurté à un contexte tendu par sa surcharge immédiate, le dispositif a été confronté à des mouvements de grève, arrêts maladie pour épuisement, et rotations rapides des personnels. Les équipes ressentaient de l’inconfort face à leurs nouvelles missions et à la charge de travail importante ; à cela s’ajoutait une forte exposition médiatique et politique du sujet, donnant lieu à des reportages sensationnalistes, des interpellations virulentes d’associations ou de collectifs citoyens, et des recours en justice. La crise sanitaire a, de plus, interrompu pendant plusieurs mois l’accès au terrain.
Nous avons pourtant persévéré, considérant que cette situation critique au niveau local renvoyait plus largement aux problématiques soulevées au niveau national quant à l’accueil de ces jeunes et à leur traitement institutionnel. Nous avons ainsi envisagé la Seine-Saint-Denis comme un terrain d’enquête privilégié, miroir grossissant du problème de l’accueil des mineur·es non accompagnés, et laboratoire expérimentant de nouvelles organisations pour leur prise en charge. Nous avons aussi d’emblée envisagé les professionnel·les de la protection de l’enfance, agents du département ou des structures agréées, comme des partenaires de ce travail, afin de coconstruire l’enquête et de créer des espaces d’échanges, tout particulièrement à travers des ateliers-formation permettant de discuter d’autres recherches et de l’expérience pratique des acteurs et actrices impliquées au quotidien.
Dans ce contexte alliant chercheur·es et praticien·nes, le recours à la recherche-action s’est rapidement imposé. L’expression recherche-action connaît sans doute autant de définitions possibles que de généalogies ou de projets différents (Adelman, 1993 ; Bourassa, 2015). Il s’agit d’une « famille de pratiques d’enquête vivante, qui vise, de diverses façons, à connecter pratiques et idées au service de l’épanouissement humain. […] Elle cherche à créer des communautés participatives d’enquête, dans lesquelles l’engagement, la curiosité et le fait de poser des questions sont des qualités qui sont amenées à peser sur des enjeux pratiques significatifs. […] Elle est une pratique de participation qui engage dans une plus ou moins grande mesure en tant que cochercheur·es celles et ceux qui pourraient sinon être les sujets de la recherche ou les récipiendaires d’interventions » (Reason et Bradbury, 2008 : 1, notre traduction). Cette transformation du rapport au terrain d’enquête est aussi liée à la visée transformatrice de ce type de recherches qui, comme leur nom l’indique, sont plus directement tournées vers l’action. Au-delà d’objectifs d’évaluation et d’adaptation qui peuvent être définis en amont, c’est le dispositif de recherche qui porte en lui-même une transformation des perspectives et des positions des cochercheur·es.
Provenant d’horizons disciplinaires divers, les chercheur·es à l’origine de ce projet se sont accordés sur trois principes. Un premier principe consiste à tenir compte des savoirs de terrain, des praticien·nes, au même titre que de ceux des chercheur·es, car « chercheurs et praticiens sont avant tout considérés comme des agents compétents qui ont une connaissance remarquable des conditions et des conséquences de ce qu’ils font » (Bourassa 2015 : 34). Du fait de considérations pratiques et éthiques, le projet ne s’est pas concentré sur les mineur·es non accompagnés mais sur l’action publique dont ils et elles sont destinataires, et qui est mise en œuvre par les travailleuses et travailleurs sociaux.
Un deuxième principe de la recherche-action est de « servir à la fois le développement des pratiques et l’avancement des connaissances scientifiques » (Bourassa 2015 : 33). En effet, le projet est né en grande partie du constat d’une action publique défaillante, d’un service d’aide sociale à l’enfance en désarroi, pris entre une mission d’accompagnement des mineur·es, les injonctions de contrôle des politiques migratoires nationales, les changements juridiques sur la prise en charge et les situations spécifiques de jeunes en grand dénuement. Le projet avait pour vocation à la fois de comprendre la situation et d’y apporter quelques éléments de réponse.
Enfin, troisième principe, l’importance d’un processus collaboratif et évolutif dans l’élaboration et le déroulement du projet : l’équipe a dès le départ discuté du programme de recherche avec les personnes en charge du partenariat au conseil départemental, afin de répondre autant à des questions de recherche qu’aux besoins du terrain. C’est donc à travers une adaptation progressive, en fonction des échanges, qu’un programme satisfaisant a pu être mis en place, avec par exemple l’organisation d’ateliers de discussion dont la programmation était élaborée avec des personnels de la CAMNA et en fonction des enjeux qui les intéressaient.
Ce type d’investissement au long cours dans des interactions permettant une confiance réciproque a été rendu possible par un financement de l’Institut Convergences Migrations, grâce auquel une chercheuse postdoctorale, Emeline Zougbédé, a été recrutée sur une période de 18 mois, avec un investissement intensif sur le terrain – en plus des frais d’enquête de terrain et de l’organisation du colloque final. Le soutien des institutions de rattachement des différents membres-chercheur·es du collectif MINA93, titulaires de postes permanents, doctorant·es, postdoctorante, masterant·es en stage, a également été indispensable à la bonne réalisation de ce travail. Cette recherche-action a également été, comme toute chose pendant cette période, fortement affectée par la pandémie de Covid-19, les confinements répétés, ainsi que la fermeture des frontières qui a eu des effets spectaculaires sur le travail de la cellule d’accompagnement des mineur·es non accompagnés en Seine-Saint-Denis. L’un des effets principaux pour la recherche a été la difficulté plus grande d’accéder aux lieux, le travail dans un contexte d’exceptionnalité ; et plus généralement la plus grande difficulté à avoir des échanges en personne. Le travail et l’énergie d’Emeline Zougbédé ont permis de faire avancer le projet malgré ces conditions difficiles, notamment au moyen d’ateliers de discussion et d’échange à la CAMNA avec une possibilité de participation à distance pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes.
L’ouvrage reflète cette démarche : il s’agit d’un objet inhabituel dans lequel cohabitent des analyses de chercheuses et chercheurs sur leurs terrains d’enquête et des témoignages de praticiens et praticiennes. L’ambition de cet ouvrage est d’être un outil d’information et de formation, qui, dans le même temps, apporte les éléments d’un recul critique sur les situations.
Avant de présenter l’organisation de l’ouvrage, il convient d’expliciter certains choix d’écriture importants pour sa lecture. Le premier concerne les expressions désignant les jeunes pris en charge par la CAMNA, le deuxième porte sur l’écriture du genre, et le troisième sur le statut et le format des différents textes.
Tout d’abord, comment désigner les jeunes pris en charge à la CAMNA ? La catégorie de « mineur non accompagné » est une catégorie juridique et administrative, issue de l’histoire récente des politiques migratoires et des politiques de l’enfance, en France et ailleurs. L’abréviation « MNA » paraît alors transformer des personnes en statut administratif et il nous a semblé préférable de l’éviter. Sur le terrain, les travailleurs et travailleuses sociales parlent souvent des « jeunes », un terme fréquemment employé pour désigner les adolescent·es et jeunes adultes, et qui semble plus juste que celui d’ « enfants », notamment au vu des enjeux éducatifs, d’insertion professionnelle et d’autonomie qui se posent. Nous avons choisi, dans l’écriture, d’utiliser le terme « MNA » lorsque la catégorie administrative est l’objet d’un enjeu organisationnel, juridique ou légal ; mais nous lui préférons le terme de « jeune » lorsque nous parlons de trajectoires individuelles ou des interactions dans le travail social. Les termes utilisés donnent donc aussi à voir une partie du contexte analysé.
Deuxième discussion, comment écrire le genre ? En effet, s’il nous semble important de ne pas invisibiliser les filles migrantes, qui sont très minoritaires mais malgré tout présentes parmi les mineur·es non accompagnés, il nous semblait également important de rendre compte de dynamiques sociales genrées qui se manifestent dans le travail social. Ainsi, à la CAMNA, le travail social et éducatif est effectué en grande partie par des femmes auprès d’un public largement masculin ; le travail de suivi éducatif comporte un peu plus d’effectifs masculins mais reste très féminisé ; enfin, d’autres postes, notamment à l’accueil et à la sécurité, sont plutôt occupés par des hommes. Dans de nombreuses situations, ce sont donc des femmes qui accompagnent des garçons. De même que les dynamiques d’assignation ethno-raciales peuvent avoir un impact sur les relations qui se jouent dans le lien de suivi et le lien éducatif qui se créent, des dynamiques genrées sont à l’œuvre et ne peuvent être ignorées dans le cadre d’un travail qui mobilise de nombreuses qualités souvent associées aux femmes et relevant du care, c’est-à-dire d’un travail de soin qui est souvent effectué soit gratuitement dans le cadre privé, soit à faible rémunération – un travail dont la valeur économique est sous-évaluée. Comment rendre compte de ces dynamiques sur le terrain sans les rigidifier ? Le choix a été de ne pas adopter systématiquement une écriture inclusive (qu’il s’agisse de l’usage du point médian ou d’autres formes), mais de s’adapter aux contextes décrits : ainsi, la catégorie juridique « mineur non accompagné » apparaît au masculin (et entre guillemets) lorsque nous examinons son usage dans des débats législatifs ou politiques. En revanche, pour parler des jeunes, l’expression mineur·es non accompagnés est utilisée lorsqu’il s’agit aussi de jeunes filles, même si elles sont minoritaires. Dans des contextes où il ne s’agit que de jeunes garçons, comme dans le travail mené par la protection judiciaire de la jeunesse, l’expression est utilisée au masculin. Lorsque les relations d’accompagnement qui sont décrites sont marquées par des dynamiques genrées, nous faisons référence aux travailleuses sociales, même si certains hommes occupent ce poste ; mais lorsque nous évoquons des dynamiques organisationnelles, ou d’autres situations, nous parlons aussi des « travailleurs et travailleuses ». Enfin, lorsque nous citons des personnes impliquées dans le travail social, nous avons choisi de ne pas féminiser l’expression « le jeune » : omniprésente à la CAMNA, elle dénote à la fois une distinction par rapport à la catégorie administrative de « MNA », et l’usage quotidien d’un référentiel masculin. Cet usage s’explique par le profil démographique des jeunes accueillis. Nous espérons que ces précautions ne compliquent pas la lecture, mais rendent au contraire nos analyses plus proches des réalités du terrain.
Enfin, dernière question importante : celle du statut et du format des textes. La recherche-action a été le lieu d’échanges riches et fournis entre chercheur·es et praticien·nes. Un premier moment de restitution a eu lieu lors d’un colloque organisé à la bourse du travail de Bobigny et à l’Institut Convergences Migrations en 2021 : le programme intégrait des interventions par des praticien·nes de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis et de la CAMNA, des chercheur·es de l’équipe MINA93 et des chercheur·es extérieurs à l’équipe et travaillant sur les parcours des jeunes migrant·es non accompagnés et sur leur accueil en France. Au moment de la préparation de l’ouvrage, les chercheur·es disposent de plus de temps pour la coordination de l’ouvrage et pour l’écriture. De plus, leur plus grande familiarité avec l’activité d’écriture donne lieu à des textes souvent plus longs que ceux proposés par les praticien·nes. L’ouvrage rassemble donc des textes très divers : description au plus proche du travail quotidien à la CAMNA et des outils utilisés ; mise en perspective de ce travail par rapport aux enjeux auxquels est confrontée l’aide sociale à l’enfance en Seine-Saint-Denis et ailleurs ; retranscriptions d’ateliers menés avec des jeunes accueillis à la CAMNA ou des observations menées sur place ; éclairages sur le traitement des mineur·es non accompagnés dans d’autres institutions (la protection judiciaire de la jeunesse par exemple) ou dans d’autres régions, éléments de compréhension plus généraux sur les parcours de ces jeunes. Ces textes sont de longueurs et de tonalités variés, et proposent une perspective kaléidoscopique sur le travail de la CAMNA. L’objectif visé est celui de l’accessibilité des textes pour un public intéressé mais non nécessairement expert du sujet traité, des procédures ou des acronymes institutionnels. Pour faciliter la compréhension des architectures institutionnelles complexes et des multiples partenariats en jeu dans le quotidien du travail, des encadrés informatifs et des infographies, réalisées par l’atelier Valmy, accompagnent les textes.
Le parti pris pour lequel nous avons opté a été de travailler avec ces acteurs, pour comprendre ce qu’ils font au quotidien. L’attention sera donc focalisée sur ces dispositifs institutionnels, qui n’épuisent pas le sujet tant les parcours de vie des jeunes migrant·es rencontrent une diversité de figures, plus ou moins formelles ou informelles, allant des soutiens communautaires qui aident à trouver un hébergement de fortune à des associations d’aide aux personnes étrangères qui permettent de formuler une demande auprès du juge des enfants (Massion-Diez, Gerbier-Aublanc, 2021). Certaines problématiques auraient mérité des analyses spécifiques, que des travaux en cours poursuivent : c’est le cas en particulier de la situation des filles, public minoritaire, en augmentation au cours des années 2022-2025, qui, du fait de parcours de vie fréquemment marqués par une grossesse, étaient principalement prises en charge au sein des foyers mère-enfant (Sawaya, 2017 ; Antenet, 2023). D’autres travaux de membres de l’équipe ou de partenaires se poursuivent et donneront lieu à des publications dans les années à venir pour continuer à nourrir la réflexion sur les parcours des jeunes et sur les dispositifs d’action publique.
La première partie, « Entrer dans la protection de l’enfance », traite du parcours migratoire et de l’entrée dans la protection de l’enfance. La deuxième partie, « Accompagner », traite du dispositif institutionnel de prise en charge et de celles et ceux qui y travaillent, en interrogeant le processus de spécialisation à destination du public des jeunes migrant·es. Enfin, la troisième partie, « Rendre autonome », montre comment les tensions s’exacerbent avec l’arrivée à la majorité, moment auquel les jeunes perdent alors la protection que leur garantissait la minorité. Avec ce changement de statut administratif, ils et elles se trouvent exposés au risque de perdre la possibilité de poursuivre le parcours initié en France.
L’ouvrage saisit les grandes lignes du parcours de ces jeunes ainsi que les problématiques et débats liés à leur prise en charge. Sans viser l’exhaustivité, il s’agit de transmettre les éléments de recul et de compréhension qui ont permis aux professionnel·les, au cours du projet, de relever la tête de la « crise », d’échanger, et de se réapproprier le sens de leurs missions tout en les questionnant. Puisse ce travail servir autant aux futures éducatrices et éducateurs qu’aux actuels travailleurs et travailleuses sociales, aux cadres, magistrat·es, bénévoles associatifs, soutiens solidaires et citoyen·nes concernés. C’est par cette sensibilisation large, attentive aux conditions pratiques de l’accueil comme à la restauration de la fonction socio-éducative, que peut émerger une vision des territoires de protection possibles.
Repères chronologiques
1975
Circulaire du 4 juin 1975 (complétée par celle du 8 juin 1979) relative à la « protection de la personne et des intérêts des mineurs isolés provenant du Sud-est asiatique » déterminant le statut de « mineurs isolés étrangers » (MIE).
1983
Loi de décentralisation du 22 juillet 1983 confiant la protection de l’enfance aux départements, dont les missions sont élargies à l’accompagnement en 1986.
1986
Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dite « loi Pasqua ».
1990
Ratification par la France de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Années 1990
Émergence de la question des « enfants de Roissy », qui arrivent dans la « zone d’attente » de l’aéroport sans représentant·e légal·e.
1999
Création de centres d’accueil pour les mineurs demandeurs d’asile (MIDA).
2009
Émergence de la catégorie administrative « mineurs étrangers isolés » (MEI), distinguée des « mineurs isolés errants » (MIE).
2013
Circulaire du 31 mai 2013 relative « aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation » (dite circulaire Taubira) établissant un protocole d’évaluation de la minorité et de l’isolement.
2016
La catégorie de Mineur·es étrangers isolés devient « Mineur·es non accompagnés » (MNA), selon l’appellation européenne.
2016
Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif « aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille »
2022
Loi du 7 février 2022 « relative à la protection des enfants » (dite « loi Taquet ») : interdiction des placements à l’hôtel, fin des sorties « sèches » à la majorité, meilleure protection contre les violences. Modification de la clé de répartition des MNA entre départements.
1
- . Les choix en matière d’écriture inclusive sont précisés en page 27.
- 2
- Le site « Info-MIE », centre de ressources sur les mineur·es isolés étrangers, recense les publications institutionnelles ou associatives sur le sujet, mais également les articles de presse et les travaux scientifiques :
- w
- ww.infomie.net
Évolution de la part des mineurs non accompagnés (MNA)
parmi les jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) 2014-2022
Données : OPDE 93
Âge des MNA parmi les jeunes pris en charge
par l’ASE – novembre 2022
Données : OPDE 93