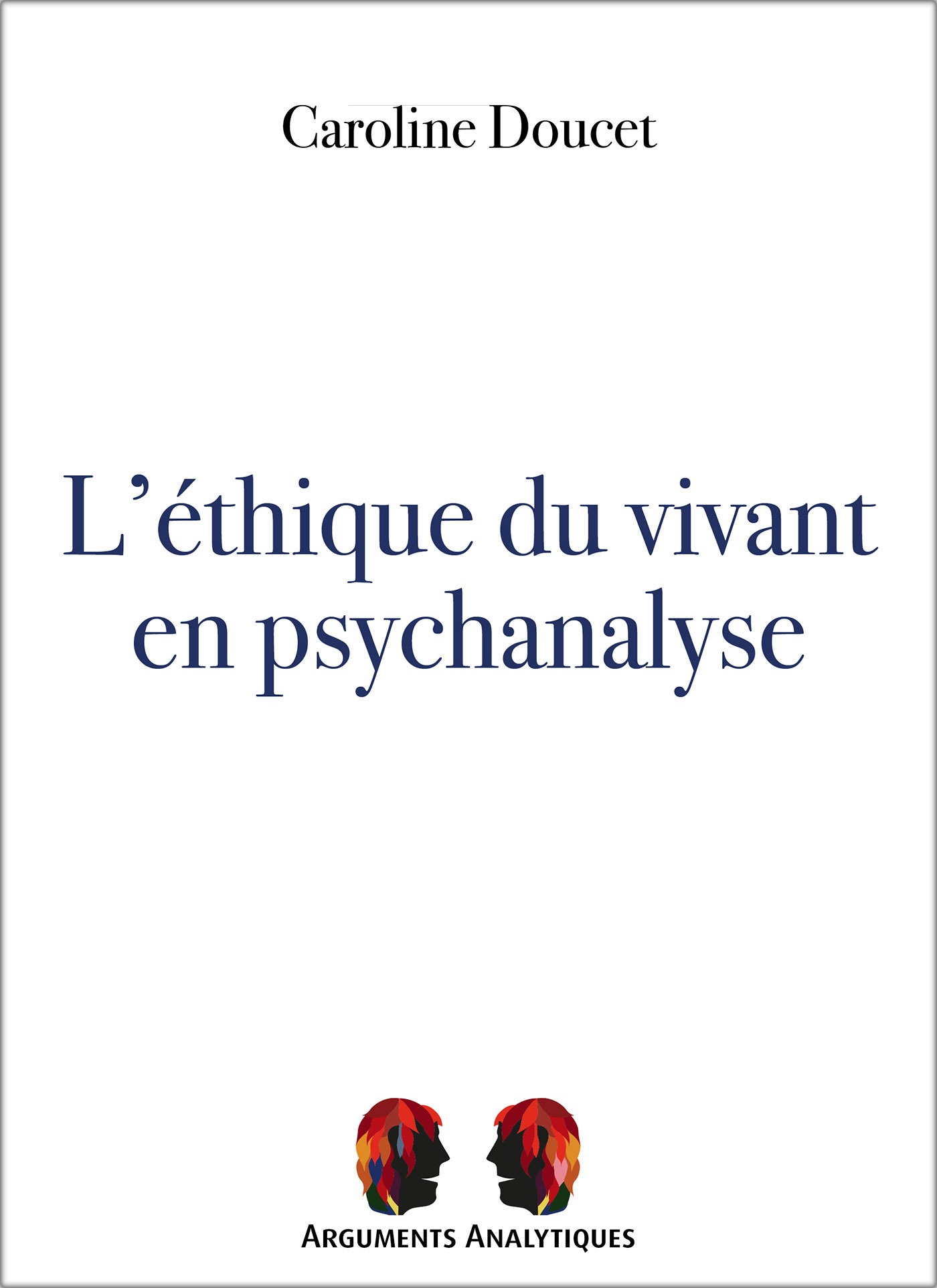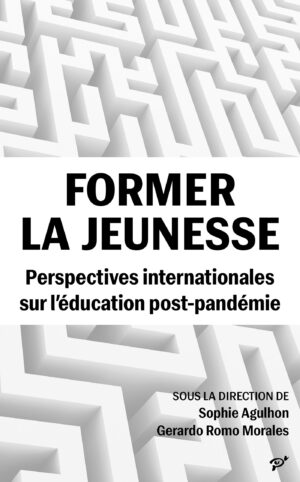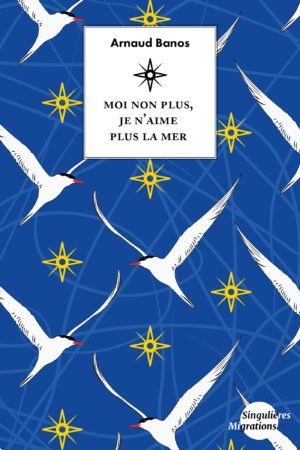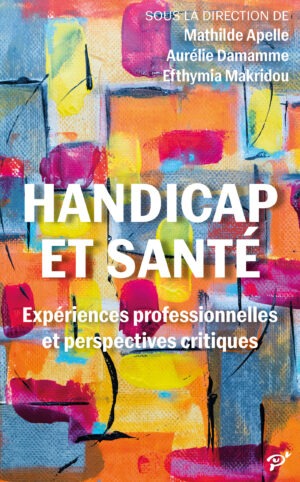Introduction. Les enjeux du vivant
Qu’est-ce que le vivant pour la psychanalyse ? Qu’est-ce qu’être vivant ? D’où proviennent le désir de vivre et ses aléas ? Le présent ouvrage part du postulat selon lequel il n’y a rien de naturel dans le rapport que chaque être humain entretient à la vie. D’autant que hors sens, la vie nous est inaccessible. Jacques Lacan soulignera l’impossible à supporter, à penser, à dire le réel de la vie. Dans son tout dernier enseignement, Lacan proposera le concept de non-rapport 1 pour évoquer l’incomplétude de la jouissance entre les sexes, un concept qu’il est possible d’appliquer plus largement ici à la disjonction entre le réel de la vie et le vivant au sens de la psychanalyse. Le non-rapport confère à l’existence sa dimension tragique et implique pour chacun d’inventer un savoir y faire avec cette fatalité.
Le rapport à la vie et le sentiment de la vie relèvent de l’inconscient. Ils dépendent de la façon dont le sujet s’est inscrit dans le langage, de la façon dont il a été parlé, de la place occupée dans le désir de l’Autre, mais aussi des éprouvés corporels et de ce que Lacan a nommé l’insondable décision de l’être. C’est par le langage et les signifiants qui le représentent (son genre, son métier, ses origines, sa religion, etc.) que le parlêtre cherche d’abord à faire entendre la différence qui le rend digne d’être remarqué. Le concept de parlêtre avancé par Lacan, associe l’être au corps, il se substitue et est préféré à celui de sujet limité à ce qui relève de la structure du langage.
Dans un moment où le séparatisme moderne fondé sur la distinction de l’homme et de la nature est remis en cause et où le problème du vivant s’est imposé dans les sciences de l’homme, le souci de se donner des raisons d’exister se pose aujourd’hui de façon plus aiguë. Sous l’influence de la pensée écologique, « l’idée d’appartenance commune à un seul et unique phénomène de la vie sur Terre fait ainsi son chemin 2 ». Tout en maintenant certains particularismes humains, en faisant valoir l’unité et la primauté du vivant, la pensée analogique et écosystémique n’est pourtant pas sans rappeler la doctrine stoïcienne d’un grand Tout vivant et immortel, ou celle d’un Diderot pour qui toute matière (minéral, animal, humain) est sensible, selon le principe des philosophies de la nature.
À l’instar de Politzer et de sa critique de Bergson 3 qui avait mis la philosophie du xxe siècle au défi d’en étudier la notion, la question métaphysique de la vie dans sa tension avec celle du vivant reprend place dans le débat épistémologique et culturel contemporain. La pandémie de Covid-19, qui a frappé le monde en 2020 telle une « secousse du réel 4 », a réinterrogé certaines notions anciennes des sciences humaines relatives à la place de l’homme dans le monde, au sens et au non-sens de la vie, au vrai et à la vérité, au destin et à la responsabilité, et ce par temps de « vogue relativiste 5 », où la défiance à l’égard de toutes formes de savoir et de connaissance s’est accentuée, y compris à l’égard de la pensée scientifique.
Paradoxalement, la pandémie Covid-19 peut être envisagée comme une irruption de la vie dans ce qu’elle a d’opaque et d’effrayant, y compris pour les savants eux-mêmes qui fabriquent pourtant la science pour en déjouer les mystères. La bioéthique est d’ailleurs née dans les années soixante-dix en réponse aux inquiétudes sociales que font peser certaines avancées scientifiques. Apparue sous la forme virale d’un réel instable et imprévisible, la vie a troué le savoir constitué sur le vivant, dévoilant l’énigme de l’existence tenue sous silence jusque-là par la société de consommation et la course au progrès.
Il arrive toujours des moments dans l’existence où l’on questionne le sens de sa vie et où l’on cherche des raisons d’exister. Pourquoi vivre, pour qui vivre ? Le sujet n’a de cesse de trouver un sens, une orientation à sa vie, non pas à partir de son vécu mais à partir du destin qu’il se construit. Or, il existe chez l’humain une temporalité spécifique à l’appréhension des événements, selon laquelle ceux-ci qui n’étaient au départ que pures contingences s’inscrivent immédiatement dans la destinée du sujet, donnant l’illusion après-coup, qu’ils ne pouvaient pas ne pas se produire. D’où l’impression que ce qui arrive au hasard était pourtant écrit d’avance dans ce qui serait la trame destinale du sujet. Pourtant, si la vie comme réel est dépourvue de signification et qu’elle insiste pour se ranger dans un ordre établi, « derrière le drame du passage à l’existence, nous ne trouvons rien d’autre que la vie conjointe à la mort 6 ». Ainsi, le langage, en tant qu’habitat caractéristique de l’humain, opère le passage de la vie à l’existence, selon une double opération. Il est tout à la fois ce qui dénature le rapport à la vie et offre la possibilité d’y réfléchir, mais il est aussi ce qui induit une perte en même temps qu’une fixation de libido dans le corps. Il est donc l’opérateur du passage du réel de la vie au vivant, selon les registres spécifiquement humains de l’être et de l’existence.
Il n’y a pas, chez l’humain, de réalité prédiscursive, au sens où le sujet – infans – naît toujours dans un bain de langage qui lui préexiste. Le langage fait obstacle au rapport direct à la vie et à la mort. Il n’y a pas de vie ou de mort naturelle chez l’humain, alors que la vie et la mort recèlent une dimension d’impossible à penser. Le langage existe indépendamment du sujet. Dès avant sa naissance, « le sujet est déjà situé, non seulement comme émetteur, mais comme atome du discours concret. Il est dans la ligne de danse de ce discours, il est lui-même […] un message. On lui a écrit un message sur la tête, et il est tout entier situé dans la succession des messages. Chacun de ses choix est une parole 7 ».
Le sujet doit se situer comme orateur dans le discours qui circule autour de lui, mais aussi en tant qu’il est déterminé par ce discours, qui n’a d’abord pour lui, aucune signification particulière. Dans la profusion langagière qui l’entoure, le sujet donne sa propre signification aux choses entendues. Le discours entendu fait surgir des ambiguïtés, des doutes, des angoisses, des énigmes qui ne sont pas sans effets corporels et trouveront, dans un second temps, des significations avec lesquelles le sujet construit sa réalité psychique, son rapport au corps, son rapport au monde.
Il n’y a pas d’autres modalités possibles pour exister que d’en passer par le langage. Il s’agit pour chacun de se faire représenter par un signifiant pour s’inscrire dans l’Autre. Le langage est donc la seule possibilité offerte au sujet de dire qui il est et, par là même, de justifier son existence. De ce point de vue, se présenter, dire « je suis », est transhistorique et transclinique, cela concerne les origines du sujet et relève de l’inscription première et primordiale dans le langage. Néanmoins, Lacan indique que « n’importe quelle façon de s’introduire dans le langage n’est pas également efficace […] n’importe quel morceau emprunté de langage n’a pas la même valeur pour le sujet 8 ». L’opération première de « changement en signifiant 9 », celle qui fait de nous des êtres vivants et souffrants, s’établit sous deux versants. D’une part, cela nous constitue comme sujet du signifiant et, d’autre part, comme être-de-jouissance, ce qui confère à chacun sa dimension vivante, ce dont le concept de pulsion rend compte.
La crise des semblants, qui caractérise le moment actuel, a accentué l’instabilité structurelle du rapport à l’être. C’est désormais à partir de son mode de jouir que chacun tente de se distinguer. Or il existe d’autres façons de faire valoir ce qui nous fait à nul autre pareil. Certains se distinguent, tels les artistes, par la voie de la sublimation. D’autres, ne trouvent plus dans l’époque les signifiants, les raisons et valeurs nécessaires à leur tenue dans le monde. Pour eux, trouver des raisons d’être et d’exister est empêché et se trouve intimement lié à la possibilité de parler de ce qui leur arrive à un psychanalyste. Là se situe un enjeu de l’ouvrage : permettre que s’entende l’importance de la parole analytique pour des sujets aux prises avec la perte du sens de la vie ou la douleur d’exister. Or on a assisté ces dernières années à la disparition de la clinique que les savoirs psychiatriques, psychanalytiques et psychopathologiques sous-tendaient, ainsi qu’à celle de l’éthique du vivant qui l’a constituée. Celle-ci considère que la souffrance humaine n’est pas qu’organique, mais qu’elle est la conséquence de l’insertion dans le langage. Car, du point de vue du parasite 10 qu’est le langage, l’humain est intraitable, sauf à supprimer l’espèce humaine. La douleur de vivre, quelles qu’en soient les expressions, est pour tous, elle est inhérente à l’humain. Au-delà des effets thérapeutiques recherchés, dans la rencontre avec un psychanalyste, le sujet s’affronte au non-sens fondamental de la vie qu’il a pour tâche de subjectiver. C’est cette part obscure située au cœur du sujet lui-même que la psychanalyse nomme pulsion de mort ou jouissance, et que le travail analytique contre, détourne, réduit ou sublime. C’est à cela qu’œuvre le psychanalyste, indépendamment des discours actuels qui promeuvent un individu abstrait, transhumaniste, séparé de toute réalité concrète et de tout lien à l’Autre et à son histoire.
Ce qu’un sujet cherche avant tout dans la parole, c’est la réponse qui lui vient de l’Autre. Les raisons d’exister et le désir de vivre n’adviennent que par la parole et le lien transférentiel à l’Autre (y compris hors analyse !). C’est pourquoi il n’y a pas d’autosoin, ni d’autoanalyse. Le sujet n’est pas un observateur impartial de lui-même, il n’est pas gouverné par un moi autonome. Une part de lui-même, que Freud nommait inconscient lui échappe, il peut agir contre lui-même et doit composer avec cette tendance. Le symptôme comme formation de l’inconscient est un recours face à l’angoisse, mais il est aussi à certains moments, ce qui entrave le sujet et lui rend la vie impossible. Parce que l’interprétation analytique met en jeu l’opérativité de la langue, celle dont l’usage nous dérobe à la douloureuse et intolérable proximité du réel, une analyse est à même de faire advenir la singularité du sujet et de soutenir ses dispositions à vivre dans un lien social à sa mesure.
Caroline Doucet
- 1. Cf. Jacques Lacan, « Radiophonie », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 413.
- 2. Dominique Bourg, Sophie Swaton, Primauté du vivant. Essai sur le pensable, Paris, PUF, 2021, p. 114.
- 3. Cf. Frédéric Worms, « Le défi de Politzer. Problèmes et tâches d’une philosophie critique de la vie, au XXe siècle et au-delà », dans Georges Politzer, le concret et sa signification, Paris, Brochet, 2016, p. 111-124.
- 4. Victor Hugo, Le Promontoire du songe, Domont, Gallimard, 2021, p. 21.
- 5. Étienne Klein, « Le goût du vrai », Tract, no 17, Paris, Gallimard, juillet 2020, p. 34.
- 6. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre II, Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique psychanalytique, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 271.
- 7. Ibid., p. 326.
- 8. Ibid., p. 321.
- 9. Jacques-Alain Miller, « L’orientation lacanienne. Du symptôme au fantasme et retour », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 3 mars 1983, inédit.
- 10. Cf. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 95.