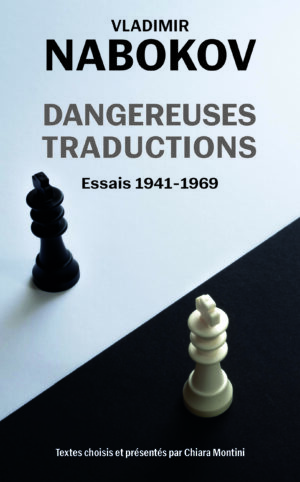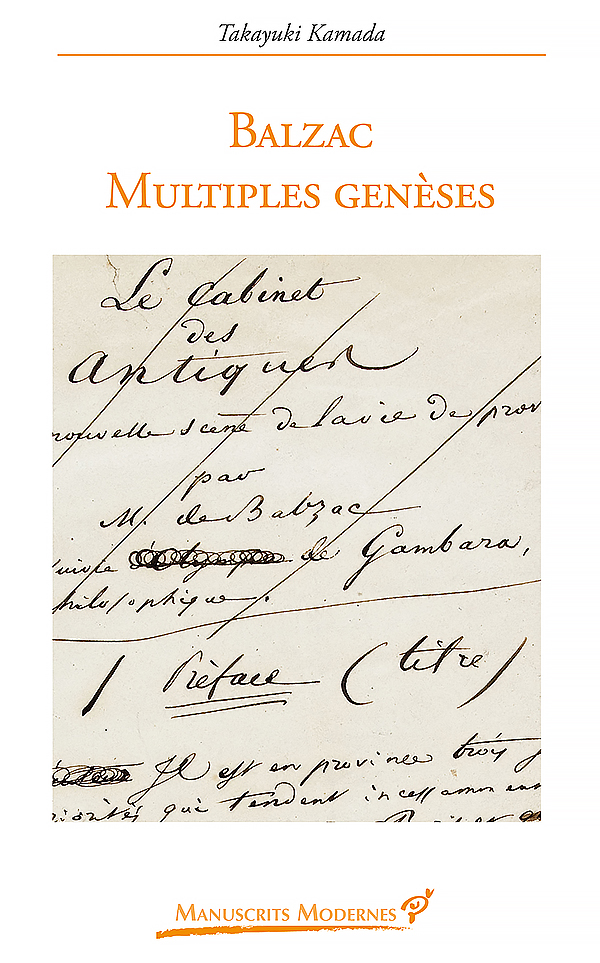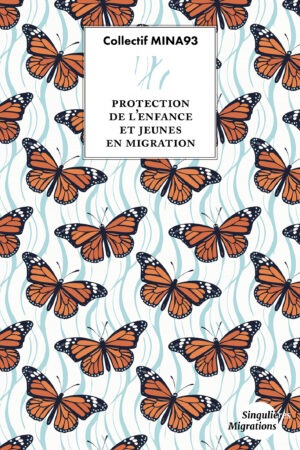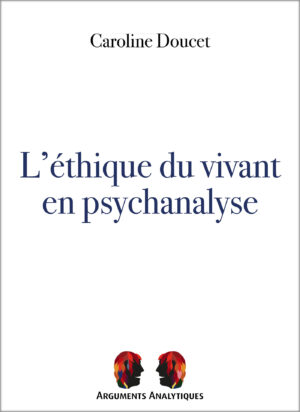Introduction
Expériences d’une immensité
Aborder Balzac, affronter son œuvre, c’est faire face à une immensité scripturale tout à fait originale et insolite. On connaît bien l’ambition sans pareille du romancier qui, dans le passage célèbre de l’« Avant-propos » de La Comédie humaine, s’érige en « secrétaire » de la société française dont il entreprend une description exhaustive :
La Société française allait être l’historien, je ne devais être que le secrétaire. En dressant l’inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des mœurs.
Pour faire apparaître la perspective d’une œuvre-somme à l’horizon, les affirmations qu’il multiplie dans ses discours préfaciels réitérés tout comme dans ses très nombreuses lettres personnelles sont toujours grandiloquentes : « Mais comment rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une Société ? » ; « moi, j’aurai porté une société tout entière dans ma tête ». En penseur de « l’homme social », l’auteur tente de « construire un monument, durable plus par la masse et par l’amas des matériaux que par la beauté de l’édifice », et « d’arriver à la synthèse par l’analyse, de dépeindre et de rassembler les éléments de notre vie, de poser des thèmes et de les prouver tous ensemble, de tracer enfin l’immense physionomie d’un siècle en en peignant les principaux personnages ». En effet, avec le procédé du retour des personnages, il s’évertue à « fabriquer le temps ». Tout ceci, d’ailleurs non sans humour, le romancier s’attribuant la figure du « grrrrand auteur de la grrrrrrrande Com[édie] hum[aine] ».
De la sorte, on rencontre chez lui une propension fondamentale au dépassement de toute délimitation générique et de toute convention éditoriale, préexistantes pour la mise en forme du roman, et une volonté d’apporter, par accumulation et remembrement, une série d’œuvres multiples, polymorphes, polycentriques et en même temps pourvues d’une orientation fortement totalisante. De fait, La Comédie humaine, selon son dernier plan de classement en « études » et en « scènes », rendu public dans le « Catalogue de 1845 », devrait contenir en vingt-six volumes cent trente-sept titres d’œuvre dont cinquante restent à faire. Si la plupart des récits notés comme en projet finissent par être laissés à l’abandon sur le chantier, cinq textes, sans être annoncés dans un tel catalogue apparemment complet, viendront rejoindre l’architecture romanesque. Finalement, l’armature de l’édifice, basée sur les consignes de reclassement données par l’auteur dans son exemplaire personnel en prévision d’une nouvelle édition, le Furne corrigé (« le manuscrit final de La Comédie humaine » d’après son testament du 28 juin 1847, et effectivement la dernière version revue par lui), nous offre aujourd’hui une centaine de textes romanesques environ, si l’on compte pour une unité chaque partie ou épisode d’une œuvre de grande dimension. Cette énorme masse d’écriture, qui représente douze volumes en édition Pléiade, se complète, pour en rester dans ce même cadre d’édition prestigieuse, de trois autres tomes consacrés aux Œuvres diverses, dont le dernier est encore en attente à ce jour. Nous nous trouvons, rappelons-le surtout, devant une collection exorbitante d’œuvres étroitement liées les unes avec les autres, du moins pour ce qui est de La Comédie humaine et d’une partie des Œuvres diverses, de façon à ce que la portée et les significations d’une pièce ne se comprennent pleinement que par rapport à la totalité qu’elles composent ensemble, comme l’a maintes fois souligné l’auteur. Cette obsession d’inclusion d’un Tout se manifeste chez lui d’autant plus fortement que, précisément, il sent toute unité humaine et sociale menacée comme jamais auparavant sur un fond de turbulences postrévolutionnaires conduisant à marquer le corps social par un défaut de cohésion et des effets de discontinuité. C’est là un véritable défi épistémologique et esthétique qui donne à l’œuvre balzacienne la facture d’un corpus littéraire singulièrement inédit.
Enjeux génétiques
Avec Balzac et la formule de l’œuvre-somme, l’œuvre-monde, dont il est largement l’inventeur, nous avons à faire l’expérience d’un immense complexe scriptural, d’un excès créateur, avant même que nous n’entrions pour de bon dans le champ des opérations de genèse chez cet auteur, que le présent livre se donne comme objet privilégié. On pourrait objecter, face à la prise de position génétique qui est la nôtre, que l’ensemble gigantesque des œuvres « finales » de Balzac constitue d’ores et déjà un corpus qui se suffit à lui-même, ou plus que cela : un objet herméneutique débordant de toutes parts, tel que le montre le texte critique dûment et magistralement établi dans l’édition de la Pléiade précédemment citée. Mais ainsi, la question serait sans doute mal posée. Car l’écriture balzacienne est fondamentalement de nature à rendre problématique toute délimitation, et en l’occurrence, celle du texte et des avant-textes, l’enjeu étant, pour le projet qui devient La Comédie humaine, de construire et intégrer de multiples portions textuelles les unes après les autres de manière mobile, en les corrigeant, augmentant et permutant sans cesse. Nous sommes en présence d’une nuée de textes interconnectés, toujours en mouvement et en action, et dont la configuration n’en finit pas de se transformer. Il serait alors particulièrement épineux d’en déterminer le terminus a quo et surtout le terminus ad quem à proprement parler. En effet, même le Furne corrigé, base textuelle des éditions critiques modernes de La Comédie humaine, ne livre pas un état textuel aussi stable que d’aucuns pourraient le croire : c’est une version qui, sans accéder à la publication du vivant de l’auteur, était encore au stade préparatoire pour une seconde édition de l’édifice romanesque, où Balzac a apporté des corrections de texte et de classement, certes apparemment modérées dans la plupart des cas, mais qui sont souvent significatives dans le fond. Dans cette mesure, nous avons affaire à un ensemble textuel hypertrophique et aux frontières en partie indéterminées. De ce fait, ce qu’on appelle l’œuvre balzacienne est à tout moment inséparable de sa dimension génétique, dont les tentatives de lecture ne peuvent difficilement se passer.
Le tropisme de réorganisation perpétuelle et la nature pléthorique de l’écriture balzacienne exigent qu’on l’appréhende sous différents états textuels et éditoriaux. Il faudrait l’explorer à toutes les échelles et dans toutes les directions. Mais s’agissant, encore une fois, d’un archipel scriptural démesuré, la tâche ne va pas de soi pour une discipline considérée comme « l’une des seules innovations notables » des dernières décennies du xxe siècle. S’entend pour nous, précisons-le, une génétique méthodologique, descriptive et analytique qui se doit de s’appuyer sur les traces repérables de création dans un ensemble de documents concrets. Puisqu’il est maintenant question d’envisager l’avant-texte, qui n’est pas une donnée, mais une construction à établir, quel corpus avant-textuel délimiter et aborder concernant l’œuvre de Balzac ? Pour tenter d’y répondre, il convient d’abord de rappeler que les documents « auctoriaux » de genèse chez Balzac, fort nombreux en proportion avec les publications effectuées par l’écrivain, sont abondamment conservés à ce jour. Ils se trouvent essentiellement dans le fonds Lovenjoul à la Bibliothèque de l’Institut de France. Pour se limiter à la rubrique œuvres et aux documents en matière rédactionnelle proprement dits, on ne compte pas moins de quelque deux cent cinquante dossiers originaux constitués de manuscrits et/ou épreuves corrigées de l’auteur concernant les romans qui forment La Comédie humaine, ainsi que les œuvres diverses des différentes périodes de sa carrière. Connues comme un outil de travail à part entière (« un second manuscrit », selon le romancier) et à ce titre une marque des inventions balzaciennes par excellence dès son vivant, les épreuves corrigées, parce qu’un texte en préparation nécessite une relecture à plusieurs reprises avant le bon à tirer, sont très massivement présentes dans ses papiers conservés, en portant d’innombrables traces de ses interventions manuscrites. Certains dossiers d’œuvres sont abrités ailleurs, certes en nombre relativement limité, sous l’égide de la Bibliothèque nationale de France, de la Maison de Balzac, de la Bibliothèque Bodmer à Genève, etc. Étant donné qu’il n’est pas rare qu’un recueil de documents donné contienne des centaines de pages, tout cela est ramené à une somme plus que gigantesque et intimidante. Bien entendu, s’y ajoutent encore les imprimés réalisés sous le contrôle du romancier : les pages périodiques et les volumes d’édition successivement publiés, dévoilant plus ou moins de variantes à retenir, jusqu’au Furne corrigé inclus. La valeur génétique de ces pages et fascicules attire toujours l’intérêt de la critique.
Par conséquent, nous avons un arsenal de documents foisonnants et hétérogènes qui sont peu ou prou dans une relation d’interdépendance les uns avec les autres. Cette situation met à mal le postulat de l’approche génétique mise en place au seuil du dernier quart du xxe siècle comme on l’a noté, car celle-ci a été établie fondamentalement pour l’exploration d’une œuvre (à l’autre) et non pour la recension unifiée de plusieurs œuvres en chantier. La confrontation avec l’écriture balzacienne dévoile l’absence d’un modèle d’application génétique – ceci malgré de nombreuses études traditionnelles portant sur les manuscrits et fragments particuliers de cet auteur – qui serait apte à l’examen d’une matière cyclique d’envergure. Dans ces conditions, toute une problématisation méthodologique et critique de la part des chercheurs en la matière parvient par la suite, durant les années 1980-1990, à l’instauration d’une nouvelle génétique balzacienne, avec une orientation précise et pointue : la macrogénétique. Ciblant un ensemble de gestions globales chez Balzac (planification de séries et de cycles, conclusions éditoriales, publication, rééditions), cette méthode, représentée entre autres par l’investigation magistrale de Stéphane Vachon, a su stimuler l’attention critique de plus en plus portée aux actes de création dynamiques et significatifs de l’auteur de La Comédie humaine.
Or, privilégier exclusivement cette approche macrostructurelle, ce serait oublier que l’objet final de la génétique balzacienne est d’appréhender dans son ensemble un mouvement de genèse des plus complexes. En effet, définie par essence comme une « génétique de l’imprimé », la macrogénétique implique pour corollaire un certain éloignement vis-à-vis des documents rédactionnels en amont, pages manuscrites et épreuves corrigées. Le mot d’ordre d’une nouvelle ère de l’application de la génétique pour l’écriture balzacienne devrait être d’en diversifier les points de vue et les procédés. Une telle démarche d’approfondissement se met désormais en place progressivement, mais avec une lenteur certaine, vu la totalité des matériaux à disséquer. Pour essayer de compléter et d’intensifier le mouvement d’étude engagé, il est nécessaire d’envisager d’explorer dans des directions multiples cet ensemble à géométrie variable, même si la restriction documentaire s’avère tout de suite impérative. Telle est la question devant laquelle nous nous trouvons.
Programme d’un parcours
Oscillant entre les deux pôles d’exigence – investigation des flots de récits, à quelque niveau que ce soit, pour en saisir les réseaux de la dynamique génétique balzacienne, d’une part, et implacable nécessité de délimitation documentaire à des fins d’analyse rigoureuse, de l’autre –, nous sommes amené à un choix : celui de lieux et sites qui semblent prégnants, stratégiques et sensibles, et qui rendraient palpable la richesse d’un terreau de multiples genèses. Il importe à cette fin d’assurer une diversité d’angles d’observation. Alors que la génétique balzacienne, ces dernières décennies, laissait voir quelque mise à l’écart des documents autographes pour favoriser la lecture des états successifs publiés, nous nous proposons d’intégrer en la revalorisant la partie manuscrite des dossiers de genèse dans l’exercice d’investigation qui suit. L’intérêt pour nous est de voir, à partir de différents espaces de genèse (documents d’initialisation et de rédaction, matériaux éditoriaux et post-éditoriaux, ensembles de récits et paratextes), comment s’élabore chez cet écrivain un questionnement inlassable sur la mise en forme romanesque, une articulation originale d’éléments de composition et une gestion dynamique de l’édition de son œuvre plurielle. Ces points d’exploration relèvent fondamentalement d’une poétique du style de genèse telle que la fait valoir Anne Herschberg Pierrot, impliquant une stylisation des pratiques de travail de l’écrivain ainsi qu’un examen des rapports de continuité chez lui entre style de genèse et style de l’œuvre. Nous tenterons alors d’étudier en cinq temps l’univers de la création balzacienne afin de nous pencher sur ses effets de déroulement et de dynamisation.
La première partie, préalablement à l’analyse proprement dite des matériaux génétiques ciblés, propose un passage en revue des enjeux de l’approche génétique confrontée au corpus balzacien. On examinera en premier lieu l’évolution historique des études de la genèse de cette immense matière littéraire depuis la documentation fondatrice du vicomte de Lovenjoul jusqu’aux travaux d’enquête avancés pendant les dernières décennies, afin de réexaminer l’intérêt du corpus et de cerner la problématique et la perspective d’une génétique balzacienne à venir. C’est également pour celle-ci que les deux chapitres suivants porteront sur la question de la mise à l’épreuve de la vulgate de la génétique textuelle. Ils auront respectivement pour objet de repenser sa portée herméneutique parfois contestée et de s’interroger sur l’autodéfinition méthodologique de l’étude de genèse, établie notamment par rapport aux disciplines concurrentes, la philologie traditionnelle et la théorie du texte. Cette partie se terminera en questionnant de quelle manière la génétique balzacienne en état d’actualisation peut mettre à profit les ressources des études dites classiques et en réévaluant à cet égard l’étude des Paysans par le vicomte de Lovenjoul.
Ensuite, nous essaierons de stipuler les principaux éléments de mise en œuvre des processus de création et des techniques rédactionnelles chez Balzac. Il s’agit d’une part de modéliser ses actes de composition et le mécanisme de leur dynamisation à deux niveaux, programmation globale et rédaction particulière, c’est-à-dire, planification structurante d’une série de romans et élaboration concrète de chaque texte. Ceci, en modulant les typologies des avant-textes qui ont précédemment été développées en théorie génétique et en proposant une nomenclature des documents balzaciens qui se détaillent assez singulièrement pour que soit nécessaire une redéfinition de la terminologie classificatoire dans un sens plus souple et étendu. Et il s’agit d’autre part d’étudier de plus près le mode d’emploi des supports habituels de Balzac, manuscrit et épreuves, servant à canaliser un déploiement original de son écriture narrative. Examinant l’organisation des étapes d’élaboration, sophistication des procédés et d’autres variations techniques, on verra comment s’articulent chez cet écrivain les gestes macrostructurels et « microstructurels », et quels rapports de dynamisation il y a dans leur combinaison.
Notre troisième partie portera sur la question de l’ordonnance à différents niveaux. Cela s’entend d’abord de la formule d’organisation éditoriale. Il s’agit de reconsidérer l’historique des élaborations sérielles et cycliques chez cet auteur, qui, en quête d’un livre-somme, décline et étend ses tentatives dans un itinéraire éminemment novateur : depuis le projet d’une Histoire de France pittoresque jusqu’aux derniers remaniements de La Comédie humaine en passant par différentes étapes expérimentales de regroupement des œuvres constitutives. Nous nous intéresserons également aux rapports entre les modes de publication et l’économie « chapitrale », en nous rendant attentif, sur le plan poétique, aussi bien à la mobilisation de stratégies éditoriales qu’à la disposition de la surface des récits multiples. Ensuite, nous nous arrêterons sur les efforts d’agencement génétique des personnages chez Balzac : d’un côté, la conception et la mise en application de la technique du retour des personnages romanesques dans ses œuvres en devenir, et de l’autre, l’organisation des réseaux actantiels à l’échelle d’un roman au fil de ses rééditions, La Peau de chagrin en l’occurrence .
Le quatrième temps de notre essai consistera à étudier la genèse de certains îlots textuels spécifiques : paratextes et textes-objets. Car le mécanisme complexe des parties et du tout chez Balzac, abordé dans les chapitres précédents, est à explorer également au niveau de la constitution des entités paratextuelles. La partie s’ouvrira sur un essai de problématisation théorique et critique de ces dernières, en mettant au point la dimension génétique des textes d’accompagnement balzaciens, et en proposant une perspective d’étude de leurs aspects de transformation en interférence avec l’espace matriciel (romans, cycles) qu’ils présentent. Nous analyserons de plus près les discours préfaciels autour d’Illusions perdues. Il s’agit de comprendre comment l’auteur dans la préface de l’actuelle première partie de la trilogie, à l’occasion de la clôture éditoriale des Études de mœurs au xixe siècle, conçoit et travaille tout au long de sa rédaction une logique de totalisation. Notre deuxième étude du dossier paratextuel cible la dédicace de la trilogie réunie, adressée à Victor Hugo, où Balzac parvient à construire un discours valorisant de son œuvre stratégiquement en rapport avec le dédicataire, mais non sans risques de dysfonctionnement et de dérapage. S’y ajoute une analyse des textes-objets au second degré dans les romans balzaciens, dont les modes d’insertion et le travail textuel et typographique méritent une attention particulière : on avancera un classement des procédés et une lecture de leurs effets, en privilégiant ici encore le dossier d’Illusions perdues.
Enfin, notre parcours se terminera sur une lecture de la genèse d’un dossier de roman substantiel : César Birotteau. Nous n’entendons pas, précisons-le, quitter le domaine de la multiplicité des foyers génétiques pour nous limiter aux réactivations d’un seul espace d’invention chez Balzac. Au contraire, l’objectif est ici de réfléchir sur différents aspects d’entrecroisement et d’échange entre un récit singulier en plein devenir et un horizon macrostructurel qui s’élabore en vue de la future Comédie humaine. Le roman de 1837 manifeste alors trois axes de dynamisation de première importance : 1) les deux textes de prospectus commerciaux insérés dans la matrice romanesque, qui, au niveau de la fiction, sont maniés respectivement par Birotteau et Popinot, 2) la construction langagière de Nucingen, personnage d’envergure au patois approximativement tudesque, singulièrement développé dans et par la double genèse