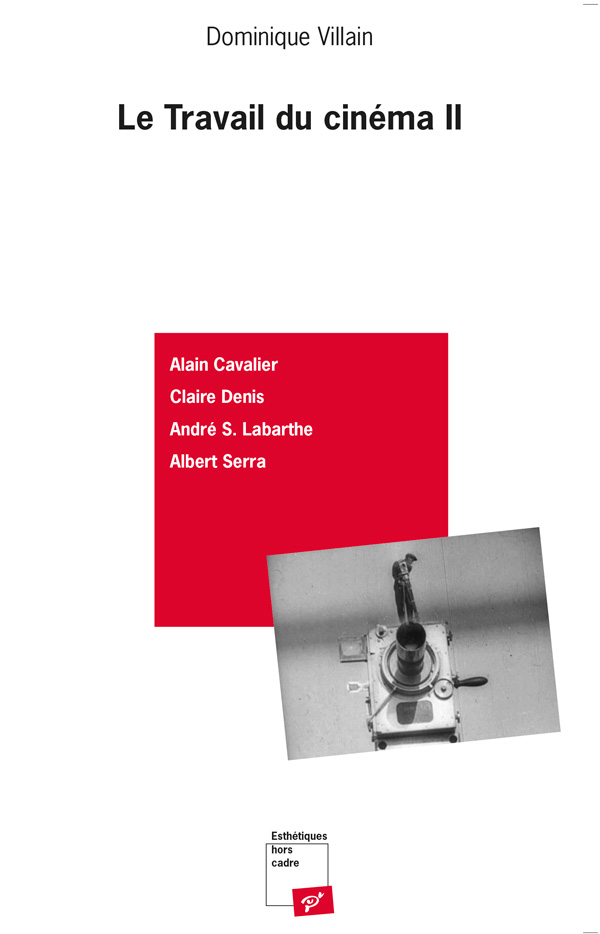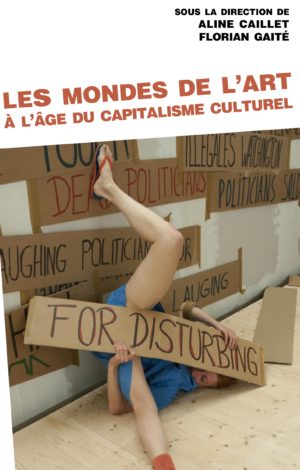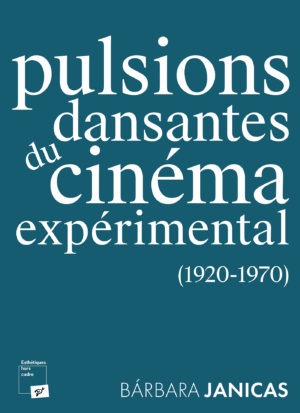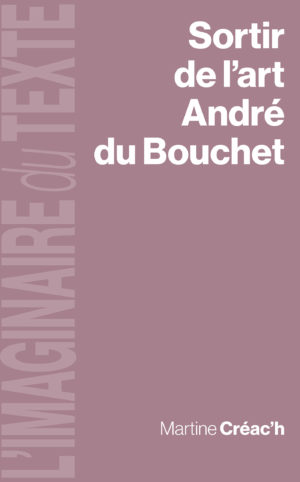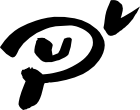Quatre cinéastes
Pour ce deuxième volume sur la création cinématographique, nous avons poursuivi les entretiens menés dans le cadre du master « réalisation-création » de Paris 8, qui permettent d’observer les ressemblances et les différences, les correspondances, entre ceux que l’on pourrait appeler des personnages parlants. Ils se lancent chacun à sa façon et très librement dans un monologue, s’appuyant concrètement sur des exemples dans leurs films, et répondant plus ou moins directement aux questions des étudiants. Où l’on constate que chacun, même si beaucoup d’aspects du travail du cinéma sont à chaque fois abordés, tourne autour d’une idée fixe, vitale, étayant ainsi cette expression décalquée du travail du rêve freudien.
Nous avons rencontré André S. Labarthe, dont on connaît l’habileté à faire parler des cinéastes de leur travail dans ses portraits filmés pour la télévision, alors qu’il venait de franchir une nouvelle étape grâce au film qu’Estelle Fredet avait réalisé sur et avec lui, expérimentant une véritable mise à nu, une traversée des apparences, pour tenter de montrer ce qu’il peut y avoir derrière un cinéaste qui se dédouble.
Nous avons fait nôtre son questionnement : « Quel genre de pensée circule – silencieusement – derrière celles qui nous accompagnent tout au long de la vie et qui ne sont, pour la plupart, que des stéréotypes de pensées, des masques ? »
Nous nous sommes ensuite adressée à Alain Cavalier, dont la réflexion s’inscrit dans le droit fil de celle qu’il menait en 1995 dans le film de la série Cinéastes de notre temps qui lui était consacré. Puis, c’est avec Claire Denis qui, elle, avait filmé au début de sa vie de réalisatrice Jacques Rivette le veilleur, que nous avons prolongé notre enquête. Enfin, Albert Serra, notre quatrième interlocuteur, avait plus récemment, lui aussi, un projet de film sur un cinéaste –… d’un autre temps ? – qui n’a finalement pas abouti.
Au cours de ces rencontres, la question s’est posée de savoir comment nommer, aujourd’hui, ceux qui sans relâche travaillent le cinéma et sont travaillés par lui, portés par leurs films, emportés dans une spirale – d’où l’idée fixe – qui leur interdit de s’arrêter. Depuis que nous l’avons rencontré, même Albert Serra semble s’y être fait prendre à son tour. Le travail a pris le pas sur l’amusement qu’il revendiquait alors.
« Cinéaste » peut sembler flou, « metteur en scène » trop marqué par le théâtre, et que « réalisent »-ils vraiment ? Déjà, Robert Bresson suggérait à sa manière :
« NI METTEUR EN SCÈNE, NI CINÉASTE. OUBLIE QUE TU FAIS UN FILM. »
« Metteur en scène ou director. Il ne s’agit pas de diriger quelqu’un, mais de se diriger soi-même. »
Sans s’être donné le mot, chacun a cherché – derrière les masques et les silences – à formuler des instants de sa trajectoire et à définir son travail au plus près de sa singularité :
Où l’on verra André S. Labarthe, cinéaste de notre temps, peaufiner ses pièges, Alain Cavalier, homme-caméra réconcilié, se réjouir d’être le filmeur qu’il avait toujours rêvé d’être, Claire Denis se dire avant tout regista, mais heureuse de quelques greffes réussies au montage, enfin Albert Serra nous convaincra en torero.
Fragments de leurs métamorphoses, retracés ici.
Dominique Villain