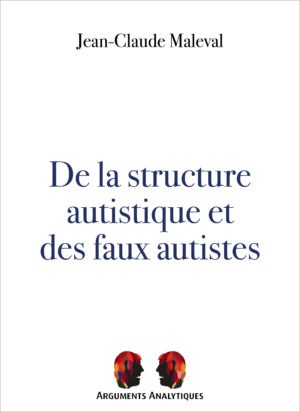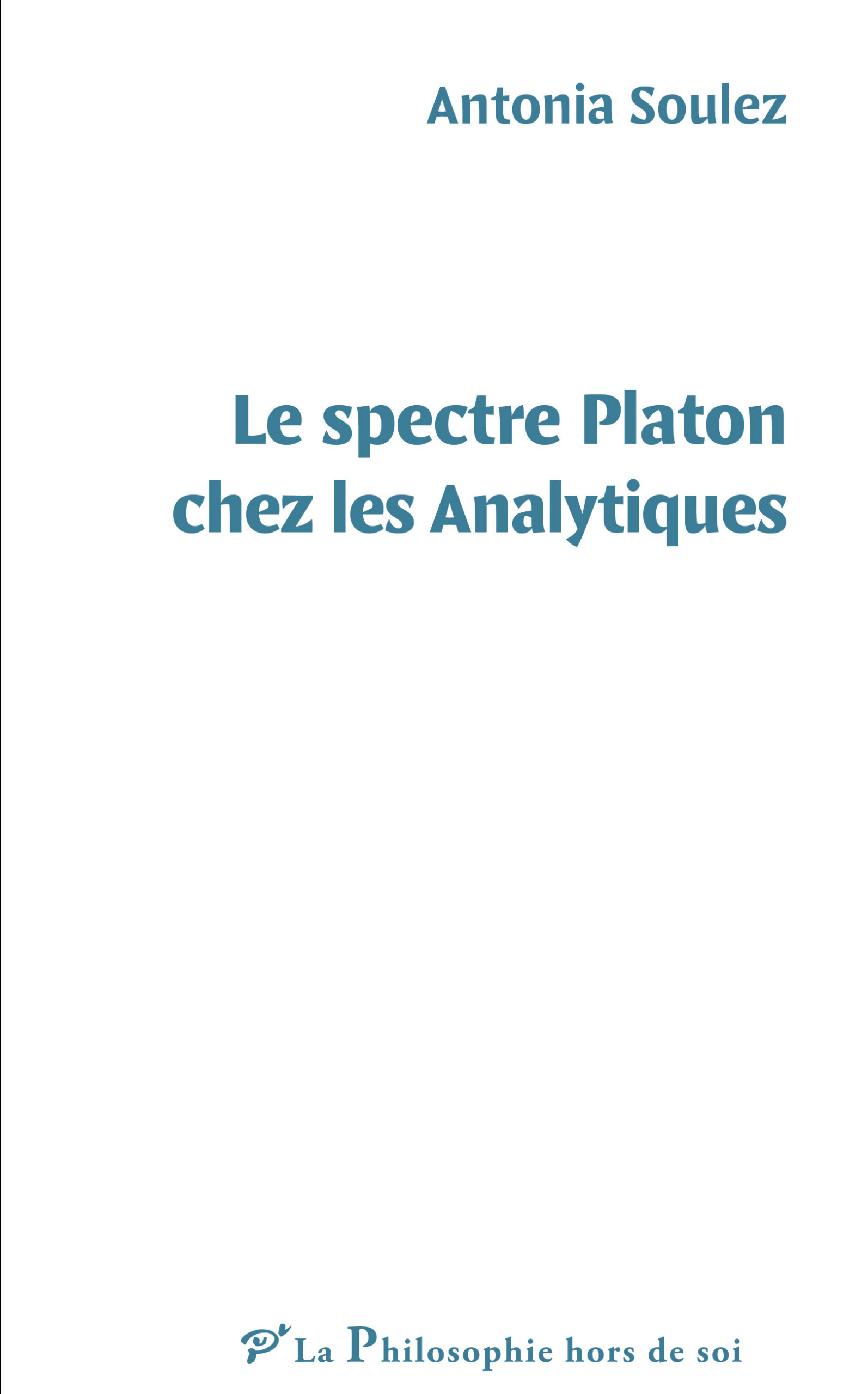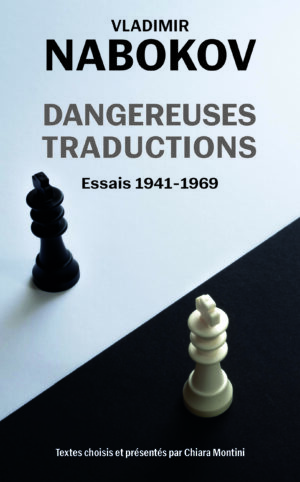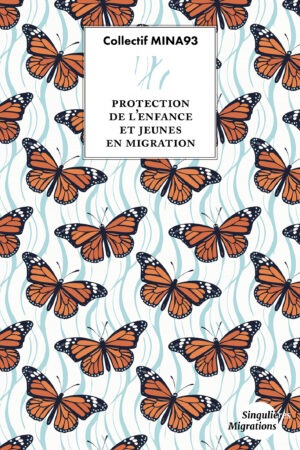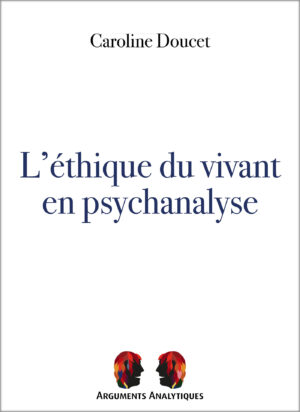Introduction
De l’Être à l’objet
J’écris ici sur les chemins et les crises qui ont occasionné, au long de ma recherche philosophique, des tournants assez marqués pour surprendre des spécialistes qui suivaient mon cursus. Je me suis toujours demandé à quoi rimait la philosophie, ce que je « faisais » en en faisant. Quelle activité se trouvait mise en jeu et dans quel but. L’histoire de la philosophie montre beaucoup de façons d’en faire à quoi correspondent beaucoup de styles. En même temps, on voudrait identifier une forme d’activité comme meilleure qu’une autre, au nom d’une méthode de pensée par laquelle les « problèmes » seraient conceptuellement clarifiés, traités sinon résolus. Ne voudrait-on pas une forme d’activité qui serait alors celle du philosophe par excellence ? Clarifier les problèmes par l’analyse des concepts m’a toujours paru la bonne voie, bien avant que je ne fasse fond sur la clarification conceptuelle dont les Viennois ont fait profession dans les années vingt du siècle dernier. Mais les concepts sont-ils seuls à travailler dans cette activité ?
Platon a dit que ce livre consacré au « philosophe » ne saurait être écrit. De fait aucun dialogue de lui n’a pour titre Le Philosophe. Suivant ce fil, je me suis intéressée aux débats engagés des philosophes à l’encontre de la métaphysique, source de problèmes réfractaires à l’analyse conceptuelle, en particulier ceux du xxe siècle. Ces débats ont pu prendre des formes extrêmes de rejet, allant jusqu’aux déclarations de guerre et de mises à mort. Platon est une des figures les plus exposées à ces vindictes. Le platonisme est devenu la hantise des philosophes, l’ennemi à abattre, ou alors un objet d’adulation, un incontournable. Bien sûr tout ne se joue pas entre de tels extrêmes. Dans le cas présent, Platon est le nom d’une philosophie sans égal, un auteur inépuisable, autant qu’un théoricien sur la doctrine duquel nul ne peut, même en désaccord avec lui, faire l’impasse. Il est sous l’appellation de « platonisme » le nom d’une conception qui représente toute doctrine de l’objectivité d’entités essentielles de caractère non sensible. Il est aussi le nom d’une manière de poser un problème. C’est cet aspect que je vais traiter, le « problème Platon ». Un style de problème plutôt qu’un problème de style.
Les entités mathématiques par exemple. Le « réalisme » en mathématiques pose l’existence d’objets autonomes que sont les nombres depuis Frege. Cette position est dite « platoniste » sans référence directe au platonisme de l’histoire. On peut y voir également une forme d’objectivisme logique.
Sous sa forme « sémantique », cette chose a intéressé Gilbert Ryle qui a justifié à partir de ce tournant son orientation vers 1929 comme il s’en explique1 dans son Itinéraire. À cette date, il s’est senti poussé vers les philosophes de langue allemande comme Bolzano, Husserl, Lotze, et Meinong parce que, en particulier Husserl, ils se préoccupaient de la question du sens et du non-sens2. Cela veut dire qu’il a cherché chez ces philosophes un intérêt pour le langage. Mal lui en a pris. Disons qu’il s’est plutôt heurté à leur façon de s’y intéresser. Cette déception apparaît dans le fameux texte sur le concept d’esprit contre la phénoménologie qui a été publié dans l’inévitable numéro des Cahiers de Royaumont où ce face-à-face est inauguré. J’y reviendrai bien sûr3.
Je distingue le platonisme de Platon du « problème Platon » dont je détache finalement le « spectre Platon ». Il hante les philosophies. Ce n’est pas tout à fait ce que Popper a appelé the Spell of Plato, une injonction sous la forme d’une résonance forte. Les philosophies que hante ce spectre peuvent bien avoir cherché à s’en libérer, après avoir critiqué le problème et la méthode que ce problème a générés, quitte à l’éradiquer une bonne fois. Le spectre revient quand même. Éternel revenant. Ce que j’appelle le « spectre Platon » resurgit de fait dans des querelles de mathématiciens. Frege par exemple est tenu pour un platonicien en ce qui concerne les « objets mathématiques ». Le nombre a une « essence » à l’objectivité de laquelle Wittgenstein s’oppose en visant les Grundgesetze der Arithmetik de Frege4, de même qu’il s’attaque dans le Tractatus Logico-Philosophicus à la théorie de la dénotation de l’objet par le concept comme son nom propre. On en oublierait Platon, celui de l’Antiquité. Même s’ils s’en défendent, ce glissement de l’Idée à l’objet suscité par les mathématiciens en quête de fondements logiques est caractéristique du début du xxe siècle. Il reste que l’objet essentialisé occupe en quelque sorte la place de l’Idée, ou plutôt la pensée du sens objectivé que Frege met au-dessus des choses sensibles et des représentations subjectives des personnes qui les expriment, dans une sorte de « troisième monde » dont se souviendra Karl Popper. Aussi plusieurs Platon se profilent-ils à l’ombre ou à la lumière. Mais il en est un avec lequel il y a encore fort à faire : un Platon antique que certains contemporains osent affronter hors du champ grec. C’est le cas de Wittgenstein qui le mentionne tantôt comme un auteur intouchable après lequel aucun philosophe n’a plus rien à dire, tantôt comme un philosophe passé maître en traitement de « problèmes » – types qu’il a lui-même forgés en leur donnant la forme de « problèmes » à la fois récidivants et insolubles. Et cela devient sous la plume de Wittgenstein une critique, parfois même une autocritique. Ces « problèmes », nés de la grammaire grecque et des façons de poser en grec la question « qu’est-ce que… », sont à la fois des questionnements sans réponse, dont on attend à tort qu’ils couvrent tous les exemples que l’on peut récolter d’une entité qu’on « applique », et une pathologie de l’obnubilation par l’essence. Là encore, il faudrait dire qu’il n’y a pas de « spectre Platon » sans philosophie pour le traquer. Ce n’est pas la même chose que de dire qu’il n’y aurait pas d’anti-platonisme sans Platon.
Wittgenstein est de ceux qui ont entamé une dé-platonisation des problèmes de philosophie au nom d’une méthode de résolution visant en fait à les dissoudre comme problèmes. La critique qu’il entreprit de la notion d’objet mathématique chez Gottlob Frege, n’est qu’une partie de l’attaque du platonisme. Le plus grave, le plus sérieux de tous est en effet celui du statut de « l’objet » de la pensée à savoir ce dont elle s’occupe de par son activité, en cherchant à le dissoudre, à le contourner ou à le transformer. La notion d’« objet » calquée sur celui des mathématiques, est généralisée à ce dont traiterait la pensée au regard du calcul qui est d’application par des règles. Il est donc cohérent que, plus tard vers le début des années 1930, Wittgenstein, s’attaquant à la pensée selon Frege, trouve la vie du sens de l’expression dans la sphère de l’usage du langage et non dans ce qui dépend de quelque chose de déjà là qu’il faudrait saisir (Erfassen) pour l’« amener à la conscience ». Est « platoniste » de ce point de vue, toute philosophie qui considère que les traits sont déjà tirés5.
L’interposition du langage entre pensée et être a révolutionné ces interrogations. Le langage s’est affirmé en grand perturbateur de ce rapport que le vieux Parménide a d’abord tenu pour intrinsèque entre dire et penser l’être. Si Platon s’est opposé à Parménide, c’est en raison de cette inséparabilité d’origine entre dire et penser l’Être. En « pliant l’Être au non-être », l’auteur du Sophiste est le premier à avoir désolidarisé le langage du penser. Faisant une place aux « états de choses » (ou pragmata6) dont le discours s’occupe, il a permis que le dire faux ne fasse pas échec au sens. Russell le reconnaît qui déclare que la signification des phrases fausses est le grand pas que Platon lui-même accomplit en direction d’une autonomisation du langage, ouvrant ainsi la porte aux discussions modernes.
Hilary Putnam demande si l’on peut travailler avec « l’objectivité », sans la justifier par des « objets ». C’est un autre grand pas qui est accompli, cette fois à l’écart des objets tenus pour autonomes. Les relations objectives peuvent tenir entre les concepts sans la garantie d’objets de statut supérieur. Cette conception anti-platonicienne conduirait à détrôner définitivement le platonisme. Pourtant, comme rien ne dit que l’ontologie platonicienne soit vaincue pour toujours, et qu’une ontologie peut renaître de ses cendres sous une autre forme méconnaissable, il est difficile de penser que le dossier est définitivement clos. N’y-a-t-il pas, écrit Hilary Putnam, jusqu’au repli de Willard Quine dans Le Mot et la Chose, sur le « il y a », qui ne laisse une place à une certaine ontologie ? Plutôt que de prononcer « l’éloge funèbre » du platonisme, comme le propose Putnam, je m’intéresse ici à cette impulsion récidivante en l’homme dont le traitement inauguré par Wittgenstein fait l’objet de la grammaire thérapeutique. Ainsi, je respecterai le retour du « spectre Platon » qui hante le dernier siècle comme encore celui-ci, sous la forme de controverses autour du réalisme et de ses figures.
C’est cette grande et tumultueuse traversée de l’être à l’objet, des Grecs aux Analytiques, qui m’amène à examiner aujourd’hui l’itinéraire qui a été le mien du double point de vue de l’activité de la philosophie, et de son écriture, depuis mes années d’études de philosophie grecque, années 1960, à aujourd’hui où ce travail me parait devoir être mené autour du platonisme (de Platon, ou non) dans la philosophie dite « analytique », et cela en effet aux deux bouts d’un périple accidenté, jalonné de crises et de tournants.
Pourquoi ces tournants m’ont-ils finalement conduite, après toutes ces années, à me plonger dans ce qu’on a appelé, souvent avec mépris, le « positivisme logique » du Cercle de Vienne, puis à approfondir la seconde philosophie de Wittgenstein comme une activité réglée sur les formes de vie, dont l’analyse applicative serait menée avec un « esprit d’ingénieur » ? Quelles pensées, mais aussi quelles aventures extra-philosophiques ayant retenti sur elles, ont croisé un travail parti des Idées platoniciennes jusqu’à « l’application » de l’ingénieur moderne au xxe siècle ? De l’application de l’Idée au réel à l’application de l’ingénieur au sein du réel physique, que s’est-il passé qui a pu réorienter ma conception de la pratique philosophique du tout au tout ? Enfin, de quelle conception du « style » de présentation conceptuelle mais aussi d’exposition argumentée la philosophie se réclame-t-elle ? Cette dernière question qui ne porte pas que sur l’écriture met en avant un « style ». Il m’a semblé que pour répondre à ces questions, je devais passer par une forme d’autobiographie intellectuelle.
Quant au choix d’écrire ici à la première personne, il rejoint en effet ce que, notamment, les Américains (publiés notamment chez Arthur Schilpp) avaient rendu à la mode dans les années où l’on cherchait à connaître les philosophies, doctrines et controverses d’auteurs nouveaux tels que Quine, Carnap, Russell et même Ryle que je vais mentionner dans ce travail. II répond précisément, à travers mes expériences, à la question du platonisme que je n’arrivais pas à faire mien par rapport auquel ils se sont situés de manière critique en rejetant le dualisme entre ce qu’on appelle schématiquement le « sensible et l’intelligible ». En renvoyant au genre autobiographique que ces auteurs ont adopté, je prends leur témoignage à la fois personnel, et généralement indifférent aux détails de la vie privée, comme me révélant les différentes manières dont ils vivaient leurs avancées théoriques de près ou de loin, à l’encontre de l’ontologie grecque qui était la leur à l’époque, compte tenu du contexte et des controverses du temps qu’ils ont alimentés mais qui les ont également nourris. C’est pourquoi le lecteur ici constatera une oscillation, que j’espère bien tempérée, entre l’essai sur quelques traversées philosophiques ayant jalonné ma vie de chercheuse, et les travaux approfondis se présentant comme des études, dont je livre les aspects les plus représentatifs de mes convictions : Étude 1 sur Gilles-Gaston Granger (chap. 2), Étude 2 sur Gilbert Ryle (chap. 3), et Étude 3 : sur Wittgenstein non grec (chap. 4), puis le langage et l’institution (chap. 5), enfin le style (chap. 6 intitulé « Nur dichten », qui sont les mots par lesquels Wittgenstein caractérise en 1931 ce qui reste à faire à la philosophie). Ce dernier chapitre invite à voir ce que Wittgenstein a lui-même considéré comme une pratique philosophique, sur le mode d’une aspiration, plutôt qu’en s’attribuant une manière réussie d’user des concepts qui constituerait à ses yeux une prose pleinement expressive.
La quête stylistique ici ne prend pas Wittgenstein comme modèle à suivre. Elle correspond plutôt à une démarche qui met le parti de l’écriture à l’épreuve de la critique du « livre dans l’âme » dont la formule a hanté nos études grecques. Ayant traversé, au cours de mes études, cette époque où la question se posait avec gravité à nos maîtres, j’ai d’une certaine façon vécu les doutes et incertitudes qui s’attachaient à leur transmission. Aujourd’hui, je ne dissocie pas ce que j’ai appris d’eux, des ébranlements que ces quêtes ont suscités en moi. J’ai d’une certaine façon « entremêlé » (le mot est de lui) deux éléments que Merleau-Ponty, dans un chapitre de Signes, considère comme inséparables : le travail des idées philosophiques et la vie dans la mesure où elle engageait ce travail7. Maurice Merleau-Ponty a tenté de démêler quelques fils concernant cette intrication difficile. De fait, entremêler la recherche avec des éléments autobiographiques m’a conduite à indiquer – au besoin par des italiques précédées par la mention « en aparté », des moments de vie, attentes et tournants, qui me reviennent en mémoire.
1. Mon objectif à la première personne
À quel degré le spectre de Platon a-t-il hanté la philosophie moderne au point, pour certains comme Wittgenstein, d’apparaître comme « non grec » ? Pour une chercheuse helléniste comme je l’ai été d’abord, tout investie dans une thèse d’État sur Platon, la rupture est allée pratiquement jusqu’à un changement de culture total où les études de philosophie analytique en sont venues parfois à ignorer l’héritage venu de la philosophie grecque. Cela a pu être un scandale. Effectivement, et de façon concomitante, j’observais avec consternation que les horaires d’enseignement du grec diminuaient dans les classes. Il n’y a pas que le grec, mais aussi les langues mortes qui devraient être enseignées à l’université après le lycée et pas seulement dans des instituts spécialisés. On disait que cela coûtait trop cher à l’État pour le nombre d’étudiants qui les auraient suivis. J’ai vécu cette désaffection progressive comme une privation en France dans les années 1960. Le GREPH8 conduit par Jacques Derrida a lutté contre ce courant de toutes ses forces. On peut regretter cette rupture progressive avec la culture grecque tout à fait dommageable dans les études des jeunes philosophes. Certes, il revient à l’élève de compléter sa propre formation. J’ai moi-même ressenti à un moment donné la nécessité d’apprendre sur le tard l’allemand. Que l’ébranlement du platonisme ait affecté indirectement l’enseignement du grec ou que celui-ci ait subi en contrecoup les options anti-ontologiques des philosophies du jour, c’est possible mais nullement certain ni facile à montrer. Même si les raisons d’une baisse d’intérêt sont d’un autre ordre, l’accent mis sur les sciences, l’économie, par exemple, rien ne justifie la disparition lente des études portant à lire les textes grecs. Bien au contraire. Autant savoir ce que l’on perd en rompant.
S’il est des « ruptures pratiques » indispensables en philosophie allant jusqu’à suspendre le fameux « retour aux Grecs », elles ne doivent pas autoriser à tout jeter. Elles appellent plutôt à réévaluer des manières de traiter des questions anciennes, ainsi à apprendre par exemple à ne pas les considérer comme « nôtres » (François Hartog). Cela ne veut pas dire les jeter au panier comme si elles n’avaient jamais compté. On remarquera que, récemment, des travaux paraissent sur le champ grec, comme dernièrement, un numéro de Critique sur « faire du neuf avec l’ancien » avec une présentation remarquable de Pierre Judet de La Combe9. Dans le cas présent, il s’impose de cerner en quoi Wittgenstein que je qualifie de « non grec » rend indispensable une certaine confrontation qu’il s’est bien gardé de mener, entre son anti-platonisme et Platon, l’auteur des dialogues.
Gilbert Ryle de son côté a une très jolie façon personnelle d’exprimer ce problème. Remarquant que le platonisme demande à être « compris » à des époques de pensée qui sont très loin de correspondre aux problèmes qu’il s’est posés, il déclare avec un certain tranchant : « Je suis un lecteur anglais de Platon vivant au xxe siècle ; ce que Platon n’était pas. Ma culture, mon éducation, ma langue, mes habitudes sont différentes des siennes et doivent donc altérer mon imitation de son état d’esprit et dès lors le succès de mes tentatives pour le comprendre. » Certes, on conviendra que la compréhension ne peut qu’être imparfaite, mais, ajoute-t-il, on peut aussi toujours prétendre à être un second Platon, une sorte de second auteur des Dialogues ! Cette hypothèse drolatique laisse imaginer une solution pour résoudre le fameux problème de « l’esprit d’autrui ».
Dans mon cas, j’ai été intéressée par ce genre de déclaration impertinente et courageuse. Bertrand Russell a fait de même. Mais, étant française, et formée dans la philosophie grecque, j’ai vécu une étrangeté différente liée à mon histoire, mon rapport à l’institution qui en découle, mais aussi au contexte français très particulier des années 1960. Si j’aborde en quelque sorte par apartés, des aspects personnels, ma formulation relève plutôt d’un genre méta-discursif à la première personne sur un certain parcours dont les traits d’époque ont été marquants. Je m’explique sur ce choix en ce que, progressivement, il m’a amenée à réviser mon platonisme, appris sur les bancs de l’université, jusqu’à me rendre compte que, si j’étais de fait platonisante, je n’étais pas pour autant vraiment platonicienne. J’ai mis du temps à mesurer un tel écart. Il faut le temps de comprendre l’écart qui sépare ce qu’on apprend à lire de ce que l’on finit par intégrer pour soi à son niveau. Je peux toutefois affirmer après coup que je n’ai jamais cru aux « Idées » ni à leur existence, et cela même si je trouvais grandiose « l’hypothèse » platonicienne des Idées exprimée par la bouche de Socrate dans le Phédon. Une apprentie philosophe ne peut-elle pas, au cours de sa formation, se pénétrer d’une philosophie sans la faire sienne ? N’est-il pas curieux qu’en devenant spécialiste d’une philosophie, on la fasse sienne ? Ainsi il me fallait tôt ou tard m’expliquer moi-même avec cela. Il résulte de ces croisements sans doute un style hybride amenant le lecteur à bivouaquer entre le propos conceptuel de l’étude et le rappel d’un épisode vécu relatif à mon travail. Il arrive même qu’ils soient si intriqués qu’il devienne impossible de les traiter à part. La philosophie n’est pas « pure », écrit Merleau-Ponty dans Signes10, et la traiter à part de l’histoire personnelle ou d’explications socio-historiques serait l’amputer de la chance d’une incomplétude constitutive de la pensée liée à l’immersion des concepts dans le vécu.
Pour être maintenant dans le ton des questions qui vont suivre, prenons dans l’autobiographie de Bertrand Russell11 ces lignes déclarant que « trois passions simples mais irrésistibles ont commandé sa vie : le besoin d’aimer, la soif de connaître, le sentiment presque intolérable des souffrances du genre humain ». Je dirais quant à moi presque la même chose avec ces variantes : « Le besoin d’aimer, c’est-à-dire les rencontres, la soif de comprendre, et le sentiment très fort qu’il faut penser des formes d’action et d’engagement efficaces pour contribuer de sa place, à l’établissement d’une justice sociale et humaine, dans les limites de ses compétences. » Le premier besoin combat l’indifférence ou le cynisme, le second fait appel à quelque chose de plus que la connaissance, en engageant la capacité d’entendre l’autre, et le troisième évoque une règle de participation à une cause dépassant ses intérêts propres.
Comme je l’ai signalé plus haut, l’on trouve chez Gilbert Ryle également une autobiographie intellectuelle relatant son « itinéraire » (Plato’s Progress12). Je la mentionnerai plus précisément le moment voulu, ainsi que son intérêt pour la théorie de l’énoncé qu’il découvre à travers sa passion pour la logique née au contact des Anciens comme avec la rencontre de Bertrand Russell puis, en 1929, de Wittgenstein dont le Tractatus l’incite à se demander non pas « qu’est-ce que la signification ? », mais comment obtenir un énoncé sensé, et pourquoi tel autre est un non-sens.
2. Le style. La philosophie ne devrait que « dichten13 »
Si Wittgenstein n’a pas écrit d’autobiographie intellectuelle, il lui est arrivé de s’exprimer à la première personne dans ses écrits. Un exemple frappant est ce qu’il écrit vers 1930 dans une Remarque mêlée qui devait être une préface au début des Remarques philosophiques. Écrire serait cet acte procédant d’un élan vers « le Tout » déjà là. Mais « J’y suis déjà » écrit Wittgenstein. Si « le sens de ce Tout » vient à manquer, alors, la grande organisation qu’est la culture où chacun travaille à sa place est en péril. Un état d’Unkultur s’ensuit. Au contraire, le recueil des multiples aspects Ansichten que chaque phrase que j’écris fait résonner est censé contribuer au « sens du Tout » déjà là, auquel, dit Wittgenstein, je ne cesse de revenir parce qu’il est « toujours à nouveau le même encore14 ». Par-là cet élan scelle notre appartenance à la Weltseele (« âme du monde », mots de Goethe), en nous amenant à renoncer à notre individualité au service du Tout15. Outre une certaine résonance musicale ici qu’on pourrait croire venue de Nietzsche, cette orientation ne doit pas être celle d’un élan vers « l’éternel retour » dont l’obsession reste focalisée sur l’identité à soi d’un Même. Or telle est la question lancinante de Frege sur l’essence du nombre. Écrire la philosophie doit au contraire répondre à une préoccupation autre que celle de « ratifier l’essence » (Mathieu Marion)16. Comme je l’ai dit plus haut Wittgenstein n’aime pas « les traits déjà tirés17 ». L’aspiration au « sens du Tout » – qui n’est pas le Tout et l’idée de son unité – doit donc différer absolument d’un retour sur l’essence comme si elle était établie en son lieu d’origine. Pour le dire en contestant la formulation d’Alain Badiou, il n’est pas juste de dire : « L’Être a déjà eu lieu »18.
Le « style » en question
Les Autrichiens après Wittgenstein ont rêvé d’une langue « sans style » car ontologiquement neutre. Ce serait le cas si la philosophie s’écrivait en raisonnements purs, par enchaînements ne laissant aucune place à des instants intuitifs. Une langue purement dénotative faite de concepts désignant les choses sans ambiguïté ne devrait laisser aucune place à ces trous où s’insinue entre chaînes de raisonnements le regard intuitif d’une fois, sur le mode de la percée d’un voir. L’idéal inférentiel d’une telle déductivité formulée au départ par Gottlob Frege a fasciné les philosophes de la logique qui lui ont emboîté le pas faisant de la relation du concept avec l’objet la pierre de touche d’une pensée analytique dont la chair, l’étoffe, c’est-à-dire le matériau expressif du contenu devraient être éliminés ou réduits par un formalisme extrême. Comme si, « sans style », la philosophie s’écrivait enfin dans une langue si transparente qu’elle se confondrait avec celle de son objet d’étude, faisant un avec elle. De cette fusion rêvée qui ne laisserait plus de place à une quelconque épaisseur empirique, Wittgenstein a caressé l’idéal à travers le projet d’une logique du langage entièrement ressaisie dans un symbolisme conceptuel déployé au ras du langage ordinaire. Cependant, pour en arriver jusque-là, il lui a paru nécessaire de repenser l’activité philosophique en la mesurant à l’idéal d’une Begriffschrift (ou écriture conceptuelle) selon Frege, tout en redonnant à la conceptualité de cette partition quasi musicale du Monde, la force et la couleur de son usage que Frege cherchait à lui enlever.
La « vie » du langage est ainsi devenue le terrain sur lequel ce travail a été mené au prix de l’objectivité sacrosainte de la pensée (Gedanke) frégéenne (pensée déposée), la pensée logique. Il lui a alors fallu au contraire introduire du mouvement dans l’activité de penser, en dessiner l’allure, les modulations, l’aspect et le tempo, toutes choses réservées à la musique, rendues absentes par Frege un peu comme Platon disait les Idées sans couleur ni qualité qui les rendraient attractives aux sens. C’est à ce point que Wittgenstein, dont on sait qu’un certain formalisme est devenu pour lui la cible, déclare, dans une des Fiches (§ 712), avoir paradoxalement cherché à épouser au plus près la pensée frégéenne au point que, écrit-il : « le style de mes propositions est extraordinairement influencé par Frege ».
Quelques lignes du Cahier bleu montrent en effet qu’à ses yeux, Frege s’est efforcé le premier de donner vie à la « proposition ». En ce sens, et en dépit de l’échec de Frege à « motiver » sa pensée Gedanke19, Wittgenstein est influencé par lui20. Il s’est donc battu avec cet idéal comme avec son « ennemi intime ».
C’est aussi reconnaître qu’il a lui-même travaillé, quoique de son propre aveu sans succès, à un « style de pensée » propre à ses phrases (Sätze) et que, même s’il a donné à ses lecteurs partisans de la clarification la tonalité d’une écriture désubjectivisée en droit sans style, il a de fait érigé un style exprimant à la verticale les moments d’une pensée en mouvement destinée à s’achever sur le Klarwerden des pensées élucidées. En ce sens, il a redonné vie non à la « Pensée » frégéenne, mais au mouvement de pensée Denkbewegung que cette Pensée tuait dans l’œuf. Du moins est-ce en ce sens expressif que Wittgenstein a hérité du style de Frege, d’une façon qui peut tout à fait échapper à ses lecteurs. Cette « communauté de style » ne consonne guère avec le refus d’avoir eu des maîtres, ni avec le simple aveu d’un philosophe qui aspire à dichten sous la forme composée d’un poème. La formulation plus esthétique qu’aléthique étonne. La composition désirée serait en adéquation expressive avec, je dirais, la pensée saisie dans sa langue. Cela veut dire, comme le suggère la conception schoenbergienne de la Forme de l’œuvre musicale, de viser le sens du Tout, plutôt que l’atteinte de l’Être déjà établi en son lieu de vérité. J’ai touché à cette convergence entre Wittgenstein qui pourtant s’en prend dans ces années à l’art moderne, et Schoenberg dans mon livre Au fil du motif, autour de Wittgenstein et la musique21.
Le style analytique de la clarification : au bout de l’analyse ?
S’agissant, en matière de style, du Klarwerden des pensées, le geste consistant à s’orienter vers l’élucidation des pensées, pose problème. En effet l’idée que nous tomberions sur des propositions « élucidées » est égarante. Peut-être vaudrait-il mieux ici, pour caractériser les « éclaircissements » (Erlaüterungen, 4.112), hasarder en commentaire de ces « propositions » le qualificatif d’« élucidantes », pour mieux marquer l’activité qu’est la philosophie, de préférence à la doctrine écrite qui nous laisserait ultimement avec, comme « résultat », des propositions « élucidées »22. Étant donné que la clarification de la pensée à travers ses phrases (Sätze) n’arrive in fine à aucun élément fondamental dans le Tractatus au bout de l’analyse, le « Résultat » des Erlaüterungen, à savoir le Klarwerden des énoncés 4.112, ne dit pas si la méthode d’analyse ici nous fait tomber ou non sur de l’élucidé, en termes de signes élémentaires. Wittgenstein laisse dans le non-dit ce qu’il en serait de capturer au bout de l’analyse quelque chose comme des objets élémentaires ultimes ou atomes de sens fondateurs. On sait qu’il se reprochera plus tard en forçant la note, dans une conversation avec Moritz Schlick dans les années 1929-1930, d’avoir recherché de tels « signes primitifs » (Urzeichen). Sans doute Wittgenstein se retient-il d’adhérer, au titre d’un « résultat » de sa démarche logique, à une coïncidence parfaite entre l’élucidant et l’élucidé.
C’est un rêve, cette coïncidence, un rêve qui a été celui de Kant23 et peut-être même l’objet de la quête de tout philosophe. Car à quoi rimerait la recherche du philosophe sans ce retard constitutif de la Raison sur elle-même empêchant que l’entité élucidante fusionnant avec l’entité élucidée la remplace adéquatement ? Devant cette hésitation quant à savoir ce qui est « clair », clarifiant ou clarifié, l’on comprend que cette quête se transforme plus tard chez Wittgenstein en une aspiration à « faire la clarté avec soi-même » plutôt qu’à halluciner une clôture, le risque étant d’avoir à renoncer à la clarification analytique. Nous revenons à cet appel à faire la clarté avec soi-même à propos du style de la Dichtung « vraie », à la fin de ce volume.
3. L’hypothèse des Idées dans le Phédon : une autobiographie intellectuelle et l’argument de la « sécurité »
La première « autobiographie intellectuelle » qu’on ne qualifie pas spontanément en ces termes est le récit par Socrate du chemin qu’il a suivi dans un passage connu du Phédon. Socrate va raconter ses expériences, dit-il à Cébès. Quand il était jeune homme, il a d’abord recherché un savoir (sophia) appelé « Enquête sur la Nature ». On dénommait ainsi toute recherche de nature physique ; Socrate jeune a d’abord été un adepte de la physique parce qu’il entendait savoir la cause de la génération et de la corruption (titre qu’Aristote retiendra comme on sait). Il finit par se découvrir inapte et oublieux de ce qu’il a appris. Jusqu’à l’aveuglement. Comment distinguer la différence entre un homme grand et un homme petit, et autres questions de comparaison, par exemple entre les nombres entiers qu’on divise ou retranche ? Ce qui lui échappe est la cause (aitia). De même la raison en vertu de quoi se produit l’unité. Et puis un jour il entend un point évoqué dans un livre d’Anaxagore. Anaxagore mentionne l’esprit (nous), à la source de l’ordre (kosmos) de toutes choses, un esprit ordonnateur. Et voilà Socrate à nouveau en quête de la compréhension de la cause de la génération et de la corruption. Du coup, Socrate se sent des ailes et repart en direction d’une autre espèce de causalité. Son espérance est au plus haut. Il s’empare du livre pour le dévorer. L’Esprit est la clef de l’ordre de toutes choses, clef aussi des causes particulières de cet ordre. Vient l’exemple de son état à lui en cette circonstance présente : il est assis. Pourquoi ? Parce que son corps est fait d’os et de muscles. C’est une cause physique. Pourquoi, demande-t-il, suis-je ici à vous parler ? Parce que, condamné à mourir, il préfère parler à ses interlocuteurs, maintenant qu’il a accepté de mourir empoisonné par les Athéniens. La raison de rester là assis est donc une cause sans laquelle les autres causes ne le seraient pas (99 b). Une chose est ce qui cause réellement, une autre ce sans quoi la cause ne causerait rien. Il a donc, afin de ne pas devenir « aveugle de l’âme » « changé de navigation » pour parvenir à la cause vraie, la Forme (99d-e.). Les Idées pour voir la vérité des choses se sont dès lors présentées à lui cependant sous forme d’images, car de trop près elles éblouissent. Dès lors, c’est cette espèce de cause (tès aitias to eidos) qui le préoccupe et devient son point de départ (archè mais aussi hypothemenos, 100 b). Socrate la « pose ». Il faut maintenant que ses interlocuteurs, ici Cébès et Simmias, l’admettent avec lui (sugchorein) pour le suivre. Si on lui accorde les Idées comme hypothèses, alors il s’ensuit que toutes les causes savantes qu’il ne comprenait pas auparavant deviennent explicables. « Le Beau est ce qui rend belles toutes les belles choses. » La réponse apporte la « sécurité » (asphales). C’est la participation qui permet d’expliquer que chaque chose arrive à l’existence telle qu’elle est. Ainsi le deux est produit par participation à la dualité (101c). Tout cela par nécessité. À l’opposé de cette « sécurité » se tient l’effroi. L’immortalité de l’âme, sa survivance après la mort, reçoit ainsi sa « sûre réponse ». L’âme porte la vie. Elle vient à l’objet en portant la vie (phérousa zôen, 105d) ; elle n’est pas apte à recevoir la mort. Elle est donc non mortelle ! Quand l’homme meurt, c’est ce qui est mortel qui meurt. Pas l’âme qui s’en ira vers l’Hadès (107a). Telle est la « vie apportée par l’âme » que nous raconte Socrate dans son « autobiographie intellectuelle ».
Cette présentation socratique à la première personne des différentes étapes qu’il a franchies en quelque sorte tout seul, à différents âges, est exemplaire. La relisant, je suis même « sous le coup ». Rien n’est plus éloigné, étranger à ces propos que les récits des Anglo-Saxons que j’ai progressivement découverts dans les années 1960 en changeant temporairement de pays. On ne peut pas trouver orientation plus contraire à celle de Socrate vieux, du côté anglophone que le genre d’« autobiographie intellectuelle » qui a fleuri à une certaine époque aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Bien sûr il y en a bien d’autres. Mais j’aimerais pouvoir dire qu’il y a un genre anglo-américain d’auto-biographie intellectuelle.
Si j’ai voulu commencer par le récit de Socrate, alors condamné à mourir, c’est parce qu’il montre que la physique recherchée dans sa jeunesse ne lui apportait pas la « sécurité », alors que la « physique » est précisément la science sur laquelle les philosophes de langue anglaise se sont fondés au xxe siècle en donnant la priorité à l’empirisme, l’empirisme de Hume réévalué à l’aune de la physique contemporaine enrichi par le recours au formalisme naissant, fondé sur la « nouvelle logique24 » (Frege-Russell). C’est cette « hypothèse des Idées » dont les philosophes d’Outre-Manche en particulier ont fait leur cible. Il est symptomatique de ce que les « Analytiques » ont voulu jeter par-dessus bord en faisant du platonisme, tel qu’ils l’ont compris ou reformulé, une forme indésirable de métaphysique.
4. La liaison de sens (symplokè)
Joëlle Proust m’a un jour demandé, au cours d’une conversation amicale, si je travaillais de préférence sur les concepts ou avec des motifs. J’ai répondu « avec des motifs ». En réalité, comme l’écrit Wittgenstein, en philosophie, la règle d’or est de travailler les deux, concepts et motifs, indémêlablement. Mais en vertu de quelles articulations dicibles ou indicibles ?
Ce travail de retour en arrière sur un parcours si hétérogène en apparence est le fait d’une véritable « aventure intérieure », un peu comme la décrit le mathématicien Alexandre Grothendieck dans son œuvre Récoltes et Semailles25. Dans mon cas, suis-je la même qui à la fin des années 1960 ai commencé de travailler sur Platon et le vocabulaire de la vision ? Qu’est-ce qui a déterminé l’helléniste que j’étais à amorcer à la fin des années 1970, alors que le travail n’était pas fini, un tournant assez brusque vers les philosophes anglo-saxons de l’époque, au point d’étonner et même d’inquiéter le milieu de travail dans lequel je me trouvais ?
Et pourtant, c’est toujours irrésistiblement guidée par la force attractive de l’idée d’un même « motif », expression musicale obscure, que j’ai poursuivi ma recherche au point que, j’ose dire encore à cette heure, cette quête me mobilise toujours maintenant.
C’est cela même, un « motif », quelque chose d’indéfinissable à quoi l’on revient comme le peintre Cézanne à sa montagne Sainte-Victoire. Obscur mais ramifié, contenu déjà là à l’état quasi pulsionnel, il est une force qui ne se connaît pas, tendant à s’auto-déployer sous diverses poussées impossibles à totaliser. Bergson le déclare obscur et indéfinissable. Il vous tient plutôt qu’on ne le maîtrise. Schoenberg parlait de composer sous la force d’une sorte de « nécessité » qui n’a rien de naturel. Pourquoi le philosophe ne serait-il pas enclin à mener une quête semblable comme l’artiste poursuit son idée, ou le scientifique sa « pensée thématique26 » ? Sans parler bien sûr de la musique, il en est comme du cinéaste Bela Tarr parlant du Cheval de Turin ou de l’homme de Londres, ou d’Edgar Poe sur la « genèse du poème » à partir du fatidique Never more du Corbeau.
Le plus piquant est quand le philosophe ramène à lui cette poussée alors même qu’il travaille dessus. Ainsi, il est toujours curieux de lire une recherche sur la manière dont on « parvient au motif », alors qu’en réalité, l’écrivain, poussé par lui, en part. Le motif confine à la cause, mais il est plus intérieur qu’elle, et la cause plus externe que son objet. Dans les deux cas, l’homme est agi par des pensées qu’il ne commande pas : « Je ne suis pas le maître dans ma propre maison », paroles que Freud a retenues d’Ernst Mach. Cette citation vient à l’esprit de Friedrich Waismann, le scribe de Wittgenstein, lorsqu’il s’interroge sur « le motif comme interprétation » (Deutung) et qu’il fait se rejoindre l’objet de son livre sur Volonté et motif et le « motif » même qui le pousse à cette interrogation27. Dans un langage qui doit au freudisme, Waismann aborde les « résistances inconscientes » à la reconstruction des motifs. Dans cette étrange lutte s’affrontent la motion motivique et ces résistances qui font écran à la connaissance objective du phénomène lui-même, tandis que nos outils d’analyse s’avèrent du même coup être des moyens trop grossiers pour le cerner dans ses fines subtilités. Il s’y est heurté dans son travail micrologique d’analyste du langage28.
Ce qui se passe alors est un retour sur soi du motif, comme si le motif tapi dans le langage devenait la tapisserie du motif sous la forme d’un fantôme revenant dans les mailles de la langue. Exemples, celui que Wittgenstein lui-même prend : le motif musical de la « jeune fille et la mort » (pattern, en anglais), mais aussi chez Freud, le motif shakespearien des trois coffrets ou de l’anneau du tyran Polycrates qui fait revenir compulsivement sur soi dans le récit, la nécessité d’un mouvement qui puise au plus profond de l’être, au cœur de la Dichtung, de même à sa façon le « motif dans le tapis » du romancier américain Henry James29. Comme le romancier le présente, le motif se caractérise par sa répétitivité ou celle d’un détail qui fait énigme mais peut aussi varier. Opacité et retour sont alors indissociablement liés. Le « motif dans le tapis » du romancier, frère du philosophe William, dont Wittgenstein était un fervent lecteur, a l’art de présenter le motif de l’écrivain en enchâssant dans un des chapitres du livre, le sujet de la maison hantée comme motif de composition. Le motif de l’action s’enroule à l’action du motif. Le motif est alors noué autour d’une figure qu’il détermine comme son centre d’apparition. Ce n’est pas le romancier qui fait de la philosophie, mais le philosophe qui, à l’inverse, romantise sa quête. Le philosophe aussi rationnel soit-il n’échappe pas à l’enchaînement des motifs, d’un pattern à l’autre où motif et pattern alternent en écho à la forme Gestalt d’une composition. Je m’intéresse à ce retour chez le philosophe comme Dichter.
Ceci étant dit, écrire en première personne ici en entrelaçant éléments de vie et philosophie ne fait pas de moi une romancière à l’affût d’une sorte rêvée de Dichtung philosophique. Le travail consiste ici plutôt à voir les incidences de la critique, en particulier celle de Wittgenstein, de la « manière platonicienne de considérer un problème », cette Platosbetrachtungsweise, sur la prose du philosophe. Dans leur commentaire des Recherches philosophiques de Wittgenstein, Gordon Baker et Peter Hacker montrent que l’expression « Platosbetrachtungsweise » est un véritable montage destiné à combattre l’image d’une conception avec laquelle Wittgenstein s’explique30. Cette critique induit une reformulation d’un style de présentation d’un problème. La question du « style » s’y glisse d’une présentation à l’autre par l’effet remarquable d’une traduction d’un langage dans un autre, ainsi du langage platonicien en celui d’une clarification d’un problème. Le passage relève d’une opération grammaticale relative au style de justification qui intéressait Wittgenstein au plus haut point, par contraste avec la philologie, comme il le dit clairement dans un passage du Big Typescript (1933, section « Philosophy », S. 413) où les deux manières de procéder suivent des règles différentes. La traduction d’un langage dans une autre suit des règles ouvrant sur l’invention, les seules qui intéressent Wittgenstein et que la philologie au contraire ignore. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette importante différence.
Antonia Soulez
- 1. Gilbert Ryle, Plato’s Progress, Cambridge, Cambridge University Press, 1966. Id., L’Itinéraire de Platon, suivi de En manière d’autobiographie, traduit par Jacques Follon, avant-propos de Monique Dixsaut, Paris, Vrin, 2004.
- 2. Ibid., p. 48. Gilbert Ryle, attiré par la phénoménologie, s’étonne seulement que ces auteurs s’arrêtent à cette question sans s’intéresser aux règles de syntaxe logique par quoi Husserl se serait rapproché de ce que rechercha Wittgenstein.
- 3. Willard Van Orman Quine, « Le mythe de la signification », Cahiers de Royaumont, no 4 (« La philosophie analytique »), 1962, p. 140 et p. 164.
- 4. Par rapport au § 66 notamment des Grundgesetze der Arithmetik de Gottlob Frege, Hildesheim, Georg Olms, 1966. Voir le commentaire de ce passage par Mathieu Marion, « Pertinence et actualité de la philosophie des mathématiques de Wittgenstein », dans Wittgenstein et les mathématiques, Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 2004, p. 110.
- 5. Ludwig Wittgenstein, Dictées à Friedrich Waismann et pour Moritz Schlick. Années 1930, chap. 5, « Logique et géométrie », Paris, Vrin, 2015, p. 240. Wittgenstein a à l’esprit la figure obsessionnelle de « l’éternel retour » de Nietzsche. Ce retour lui semble empreint du souci de Gottlob Frege de « ratifier » l’essence du nombre en la définissant, alors qu’elle est déjà donnée dans l’objet « nombre » (préexistant). L’argument ressemble à la critique platonicienne de Parménide de dire deux fois l’essence de l’Être, en le posant et en l’assertant.
- 6. La définition de pragmata comme « états de choses » est le point de vue que je défends dans La Grammaire philosophique chez Platon, thèse de doctorat soutenue en 1988 à l’université Paris Nanterre, Paris, Presses universitaires de France, « Philosophie d’aujourd’hui », 1991.
- 7. Maurice Merleau-Ponty, Signes, chapitre 5, Paris, Gallimard, 1960, p. 158.
- 8. GREPH (Groupe de recherches sur l’enseignement philosophique), Qui a peur de la philosophie ?, Paris, Flammarion, 1977.
- 9. Critique, no 910 (« Neuf comme l’antique, la Grèce ancienne au présent »), p. 180.
- 10. Maurice Merleau-Ponty, Signes, op. cit., p. 158.
- 11. Bertrand Russell, Autobiographie (1872-1967), prologue, Paris, Les Belles Lettres, 2012.
- 12. Gilbert Ryle, L’Itinéraire de Platon, suivi de En manière d’autobiographie, op. cit.
- 13. Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées, 1933, Culture and Value, traduit par Peter Winch, édité par Georg Henrik von Wright, Oxford, Basil Blackwell, 1980, p. 24.
- 14. Id., « Immer wieder nach demselben » (1930), Remarques mêlées, 1933, Culture and Value, op. cit. La formule évoque l’éternel retour selon Nietzsche exprimant le retour au même du motif musical, soit la « ritournelle » selon Gilles Deleuze.
- 15. Ibid.
- 16. Cf. Mathieu Marion, « Pertinence et actualité de la philosophie des mathématiques de Wittgenstein », op. cit., p. 87. Nous reviendrons sur l’opposition de Wittgenstein à Gottlob Frege sur la définition du nombre dans le chapitre consacré à cette question.
- 17. Voir ci-dessus la note 5.
- 18. Antonia Soulez, Détrôner l’Être. Wittgenstein antiphilosophe ? En réponse à Alain Badiou, Limoges, Lambert-Lucas, 2016 ; Ead., « Wittgenstein est-il un anti-philosophe ? L’interprétation d’Alain Badiou », dans Élise Marrou et Pascale Gillot (dir.), Wittgenstein en France, Paris, Kimé, 2022.
- 19. Ludwig Wittgenstein, Cahier bleu [1934], traduit par Guy Durand, Paris, Gallimard, 1965, p. 39-41. Wittgenstein reconnaît qu’il hérite de l’effort frégéen de motiver les signes contre les « formalistes ». Si les propositions mathématiques n’étaient que des complexes de traits juste écrits sur le papier, elles n’auraient aucun intérêt. Gottlob Frege a su chercher la « vie » à travers leur « sense », ou « pensée ». Son tort a été de croire qu’en leur ajoutant une dimension immatérielle, on rendait vivants ces signes. D’où pour Wittgenstein la nécessité de s’attaquer à l’idée d’un medium de l’esprit où nous interposons une « chose étrange » qui est cet « objet ».
- 20. Allan Janik, Assembling Reminders, chapitre 4, « The Quest for Objectivity », Stockholm, Santerus Academic Press Sweden, 2006. Gottlob Frege fait partie de ces « influences ».
- 21. Antonia Soulez, Au fil du motif. Autour de Wittgenstein et la musique, Sampzon, Éditions Delatour France, 2012.
- 22. Le point est indiqué par la légère modification introduite dans la récente traduction du Tractatus de Wittgenstein par Christiane Chauviré, Paris, GF-Flammarion, 2022, p. 134, par rapport à celle de Gilles-Gaston Granger, Paris, Gallimard, 2001.
- 23. Voir ma réflexion sur un certain « retard de la Raison sur elle-même » : Antonia Soulez, Comment écrivent les philosophes ? (de Kant à Wittgenstein) ou le style Wittgenstein, chapitre 2, Paris, Kimé, 2003, p. 51-55, où je fais référence à l’introduction de la Critique de la raison pure.
- 24. Rudolf Carnap, Construction logique du monde, Paris, Vrin, « Mathesis », 2002. L’expression est de Rudolf Carnap, en référence à la théorie des relations venue de Bertrand Russell sur le modèle de laquelle ce dernier a conçu le schéma de sa Construction logique du Monde en 1914, en contraste avec la logique aristotélicienne.
- 25. Alexandre Grothendieck, Récoltes et Semailles, Paris, Gallimard, 2022.
- 26. Gerald Holton, Thematic Origins of Scientific Thought : Kepler to Einstein, Harvard, Harvard University Press, 1988. On a parfois l’impression que l’auteur oscille entre motif et thème. C’est en tous cas, s’agissant des atomes, au « style de pensée – style of thinking » – et à son interdépendance vis-à-vis de la thématique qu’il pense, par exemple, l’aspect discret qui s’est exprimé en physique, biologie, chimie au xxe siècle. La motivation joue aussi son rôle parfois tissé d’irrationnel dans la croissance de la science. Holton montre ainsi chez Niels Bohr, au chapitre 4, à quelles questions et expériences non étroitement scientifiques a puisé son principe de la complémentarité. Ainsi la science avance nourrie par une thématique motivante qui rétroagit sur des modèles de représentation en intégrant y compris des préconceptions échappant à la vérification. Le propos rejoint celui de Ludwig Fleck, mais c’est surtout Thomas Kuhn qui dit devoir au microbiologiste Ludwik Fleck sa notion de « paradigme » (mentionné dans le livre de Gerald Holton).
- 27. Écrit au milieu des années 1940 et publié sous le titre « Willensfreiheit » (libre arbitre), ce livre consiste en une approche conceptuelle. Le manuscrit est édité par Joachim Schulte, Francfort, Reclam, 1983. Friedrich Waismann tente un rapprochement avec l’incertitude en mécanique quantique.
- 28. Antonia Soulez, « L’intériorité au miroir de la grammaire », dans Jean-Philippe Narboux et Antonia Soulez (dir.), « F. Waismann. Textures logiques », Cahiers de philosophie du langage, vol. 6, 2009, p. 220.
- 29. Henry James, Le Motif dans le tapis, traduit par Marie Canavaggia, Paris, Pierre Horay, 1957. Ce trait du retour du motif dans la langue de l’écrivain est bien décrit par Jean-Pierre Naugrette dans « Présences fantomatiques chez Henry James », Critique, no 884-885 (« Le grand retour des fantômes »), 2021, p. 72-82.
- 30. Cf. Understanding and Meaning, Oxford, Basil Blackwell, 1984, p. 668. On trouve à cet endroit une section « Plato » très éclairante sur la façon dont Wittgenstein effectue un véritable « montage » d’une conception qu’il critique.