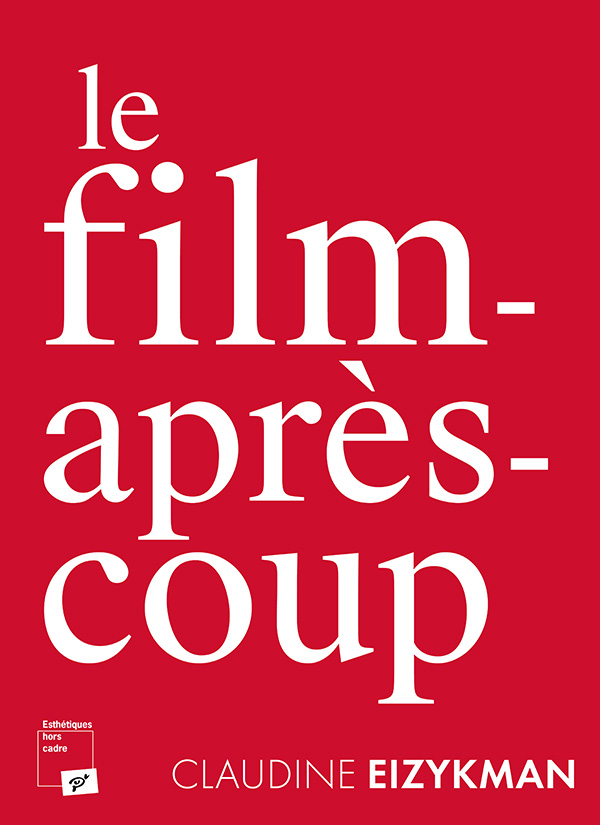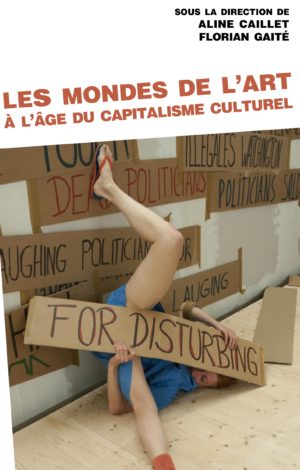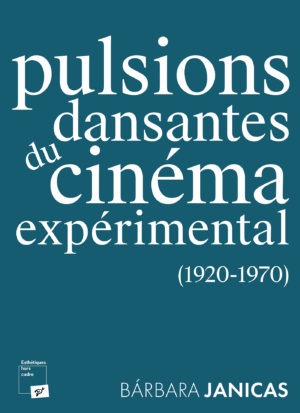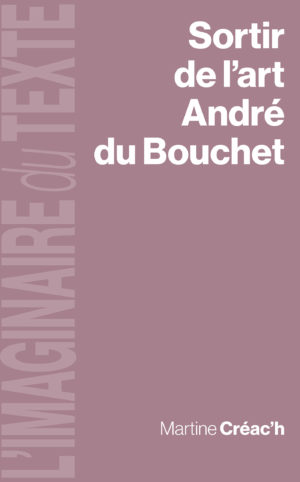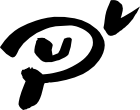Introduction
Situation
Texte inédit, 2018
Mon intérêt pour le cinéma, qui s’est développé lors de mes études de philosophie, m’a conduite à entreprendre des recherches qui comportent des réalisations artistiques et technologiques dans le cinéma monoculaire et binoculaire, des élaborations réflexives et la conception et la réalisation de programmations et d’expositions cinématographiques.
Au milieu des années 1960, la découverte des films des années 1920 et précédentes, Rythme 21 et Symphonie diagonale, produit une expérience originaire et déclenche une sidération suivie d’un processus de transformation et de concrétisation d’une situation qui, en 1965, présentait vraiment un vide aussi bien spéculatif qu’artistique : seuls quelques films suivant la théorie sémiologique et marxiste qui ne pouvaient être considérés comme des films expérimentaux, et de rares offices de diffusion inadaptés.
Si mon premier désir fut d’abord de travailler en vidéo, dont je considérais la souplesse d’utilisation, les coûts et les matériels expérimentés au service de la recherche en cinéma, ce qui aboutit à la réalisation de L’Autre Scène et montre l’impossibilité de cette option trop onéreuse, c’est donc l’argentique qui fut retenu.
En dix ans, par une logique épuisante mais irrépressible, une situation est métamorphosée/modifiée, des films – ceux de cinéastes, les miens, des textes sur des films et des technologies vidéos, argentiques, électroniques et, pour notre part, le cinéma holographique – sont développés et mis en circulation grâce à des organismes de diffusion dont la Paris Films Coop pour les films expérimentaux, ainsi qu’une revue, Melba, un catalogue et une association, Cinédoc, pour la diffusion d’informations sur le cinéma expérimental à court et à long terme.
Cet écheveau de textes, films, journaux, programmes, forme un ensemble d’actions, d’actes que l’on retrouve dans d’autres situations. Cette pluralité, cette hétérogénéité servent la multiplicité et confirment néanmoins une logique qui se répète inlassablement, elles décrivent un parcours minutieux et souvent extravagant. Telles caractéristiques soulèvent et engendrent une situation sur des dizaines d’années faites d’informations, de textes, sur et avec des cinéastes, de films personnels et de films extérieurs, expérimentaux, d’avant-garde ou indéterminés, qui ensemble forment le cinéma indépendant. C’est dans cet ordre et dans ce continuum que l’on traversera et pensera.
C’est la traversée d’une situation mise en abyme qui est proposée dans ce recueil de textes (dont plusieurs sont inédits – totalement ou en français) qui s’échelonnent sur près de quatre décennies selon les phases successives suivantes : c’est d’abord avec la référence du cinéma expérimental que j’ai mené une réflexion sur le cinéma narratif et proposé une esquisse du cinéma expérimental ; puis c’est avec la problématique de la vision volumétrique et stéréoscopique que j’ai repris la question du principe cinématographique, le mouvement paradoxal ; et c’est avec le cinéma holographique que j’ai reconsidéré le cinéma monoculaire. Il s’en est dégagé une méthode que j’ai appelée holistique, qui procède du tout au particulier, du complexe au simple et qui est particulièrement présente dans Le Film-après-coup qui donne son titre à ce recueil.
L’exploration du visuel cinématographique s’est poursuivie dans certains de mes films tandis que l’analyse a porté sur les films certains de quelques cinéastes. Accompagnés d’un retour sur la démarche adoptée dont les éléments ressortissent à la multiplicité, l’interférence, le pluralisme, l’hétérogénéité, les croisements forment une démarche holistique : il y a plusieurs expériences originaires.
Claudine Eizykman