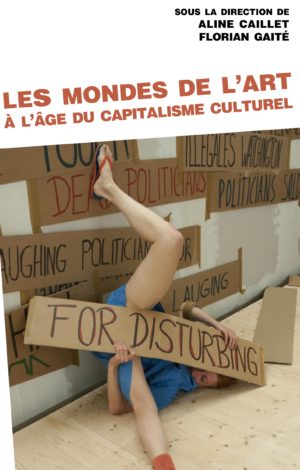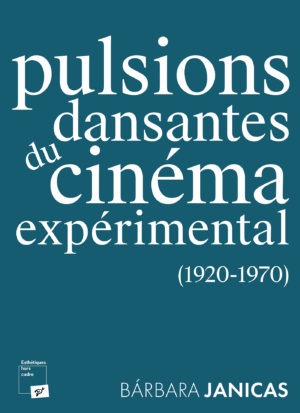Préface
une poïétique dialoguée
Université Paris 8, département Cinéma, 2010-2012. Des hommes et des femmes de métier sont venus parler de ce qu’ils font à des étudiants désireux de s’instruire pour, à leur tour, savoir faire. Et voilà que ceux-ci s’entendent dire qu’un cinéaste « devrait faire des films et surtout ne pas en parler » et que « le cinéma ne s’enseigne pas » (Straub). Situation paradoxale ? En apparence seulement. Car tout dépend de ce que parler veut dire et de ce qu’on entend par enseigner.
Les paroles ici recueillies tranchent, en effet, non seulement avec celles de ces interviews formatées qu’il arrive à des cinéastes d’accorder de gré ou de force (promotion oblige), mais aussi avec celles de ces entretiens où l’on contraint à la glose un auteur qui devrait pourtant n’être (pour paraphraser Valéry) que son premier spectateur.
Au reste, ce n’est pas auprès des seuls auteurs de films que Dominique Villain et ses étudiants ont mené leur enquête. Une œuvre cinématographique résultant toujours d’une coopération, c’est parmi ceux qui exercent différents métiers du cinéma qu’ont été choisis les intervenants. Sont ainsi abordés, sous des angles différents : les genres qu’il est convenu de distinguer (fiction, documentaire, essai), les phases successives de la réalisation d’un film (production, écriture d’un scénario, traitement d’une œuvre littéraire, échange avec les acteurs, filmage, prise de son, montage, mixage) et les modalités actuelles de l’accès au public.
La scène est bien, en un sens, celle de l’enseignement. Mais il ne s’agit ni de ce qu’on nomme aujourd’hui, non sans abus, master class (quoi de commun entre le témoignage d’un cinéaste et l’écoute, suivie de conseils, d’un instrumentiste virtuose ?) ou « leçon de cinéma » (alors que manquent l’atelier et, la plupart du temps, un maître). Dominique Villain interroge. Elle le fait en suivant le précepte d’Antonio Machado : « Pour dialoguer, questionne d’abord ; ensuite… écoute », et, comme on dit chez Renoir, « ça devient rare ! ». S’instaure alors, entre ses invités, ses étudiants et elle, un vrai dialogue qui, comme tel, vise moins à transmettre des connaissances utilisables (les cours reprendront et viendra, si ce n’est déjà fait, le temps de la pratique) qu’à susciter le récit d’expériences chaque fois singulières et, sur celles-ci, l’instructif retour réflexif qui sera effectué en commun.
Du fait des âges différents des intervenants, les expériences dont il s’agit couvrent tantôt plusieurs décennies (un demi-siècle dans quelques cas), tantôt une durée plus courte et parfois même très brève. Ce qui conduit, opportunément, à prendre en compte la profonde évolution des moyens techniques advenue au cours de ces dernières années et à évaluer (les critères variant avec les âges) les pertes et les profits qui en ont résulté.
On pourrait donc s’attendre à ce que ces dix-huit témoignages demeurent, aussi riches soient-ils, très disparates. Or ce qui frappe à les lire, c’est, malgré la diversité des activités, des parcours et des personnalités, une réelle affinité entre les propos tenus par ceux et celles auxquels Dominique Villain a fait appel. L’un d’entre eux (Iosseliani) en évoquant, par opposition au tout venant de la production cinématographique, « le cinéma que nous aimons », emploie d’ailleurs le pronom correspondant à la sunousia du dialogue, à cet être-ensemble qui suppose l’estime mutuelle et le partage. Celui, en l’occurrence, d’une certaine idée du cinéma.
Qu’en vertu de celle-ci la fabrique du film soit conçue comme l’affaire d’une équipe, cela, l’entreprise de Dominique Villain le présupposait. Mais menée à terme, elle fait plus que le confirmer. Lorsque sont évoqués : « le collectif qui désinhibe » (Denis), « l’énergie collective » par laquelle on se sent porté (Hansen-Løve), « la joie de faire des films avec les amis » (Teguia), le tournage – cette sorte de « vie de colonie de vacances » (Auvray) – comme « moment le plus heureux de la fabrication d’un film » (Fitoussi), c’est toujours cet aspect singulier de la création cinématographique qui est retenu comme une donnée essentielle.
Il y a bien assurément un maître d’œuvre, un « chef de chantier » (Cavalier) ou « une sorte de capitaine » (Fitoussi). Mais comment le/la nommer ? Jean-Claude Biette, qui s’était posé la question, admettait les trois termes concurrents (réalisateur, metteur en scène, cinéaste) à condition de désigner par chacun d’eux des entreprises sensiblement différentes. Réfractaire, elle, à deux de ces termes (cinéaste, réalisateur/trice) et se refusant à féminiser le troisième (« metteuse en scène » !), Claire Denis a judicieusement recours à la langue italienne pour lui emprunter regista, un substantif qui a le mérite d’admettre les deux genres et qui, au masculin (un regista), sonne encore féminin, comme pour marquer une dualité qui est aussi en chacun et chacune.
Mais si une tâche, diversement effectuée, incombe en propre à celui ou celle que l’on nomme ainsi (ou de quelque autre nom), quelle est-elle au juste ? C’est André S. Labarthe qui, coutumier du fait, établit les analogies éclairantes quand il conçoit l’activité du cinéaste selon les modèles contrastés du chasseur et du piégeur. L’un, dans la lignée de Marey, armé de son fusil photographique, suit son gibier (tel Rouch) tandis que l’autre, dans la lignée de Lumière, attend le sien (tel Hitchcock). Deux lignées bien distinctes, donc. Mais néanmoins un objectif commun : celui de la prise, qui s’entend ici (limite de l’analogie) comme saisie du vif, c’est-à-dire de ce qui, selon une définition célèbre, résiste à la mort – toujours au travail.
Or cette prise-là étant prise de vue et de son, s’y exercer c’est « apprendre à voir et à entendre » (Fitoussi) pour parvenir à tirer parti, tant au montage qu’au tournage, de ce qui, quel qu’ait été le degré, variable, de préméditation, est advenu sans crier gare, comme le font « les plus beaux cadeaux » (Straub). Aussi, qui pratique le cinéma en vigie ou « veilleur » (Denis), attentif, dans le film de fiction comme dans le documentaire – inséparables sous cet angle (Labarthe, Nolot) –, « à la réalité qu’on a sous les yeux et non dans sa tête » (Fitoussi), qui le pratique ainsi se doit de « travailler avec le hasard » (Mélot). L’un (Fitoussi) évoque, citant Le Gai Savoir de Nietzsche, « le cher hasard » (der liebe Zufall), un autre (Labarthe) l’imprévisible de la rencontre telle que Breton la concevait dans Nadja, et c’est Straub, le patron, qui enfonce le clou : « Le grand art vient du hasard, il ne vient pas des intentions. » Mais il en vient, précise-t-il, « par surcroît », sur la base d’« un travail impitoyable avec soi-même et avec la matière ».
Car si la pratique du cinéma comporte une dimension ludique sur laquelle certains (Serra, Cavalier) insistent plus que d’autres, c’est néanmoins essentiellement un travail puisqu’il s’agit d’informer une matière par une activité qui, loin d’effacer ses résultats comme le jeu, les inscrit dans ladite matière ; une activité non déductible d’un savoir théorique, un art ou métier (téchnè) qui ne s’acquiert qu’ « en faisant » (Auvray, Hansen-Løve) à l’instar de celui du « simple artisan » (Straub). D’où il résulte que, comme le dit un jour Agnès Varda : « C’est en tournant qu’on devient tourneron. »
Le titre retenu, Faire des films, nomme donc très exactement ce dont il s’agit : un poïein, un « faire ». Un travail qu’il faut concevoir, si l’on se réfère à une distinction de Locke reprise par Arendt, non pas comme « travail de notre corps » (labor) mais comme « œuvre de nos mains » (work), selon une comparaison que faisait explicitement Robert Bresson dans ses Notes sur le cinématographe : « Ton film, qu’on y sente l’âme et le cœur, mais qu’il soit fait comme un travail des mains. »
Il est même arrivé à Straub d’aller plus loin en comparant (c’est Dominique Auvray qui s’en souvient) « la matière cinématographique au bloc de marbre » choisi par le sculpteur, qui « va devoir faire avec les nœuds du marbre. » Dans le bloc de marbre rapporté de Carrare, Michel-Ange trouvait en effet l’appui bien réel sans lequel l’imagination serait demeurée errante, privée d’un objet sur lequel se fixer. Il y trouvait, en ce sens, son premier modèle : celui qui naît de la matière elle-même. Tout comme le cinéaste, qui n’imagine fructueusement qu’en faisant, en pensant et faisant le film « en même temps » (Costa). Raison pour laquelle « c’est le film qui commande » (Cavalier), et pour laquelle aussi celui qui le fait se sent « inférieur » à lui (Serra). Pedro Costa rappelle à ce propos l’avertissement que donne Danièle Huillet dans Où gît votre sourire enfoui ? : « Les plans sont comme des pierres. Si on fait un mur, il faut chercher et trouver la place juste des pierres pour que ça ne tombe pas. Il y a une façon et une seule pour faire tenir ce mur. »
Qu’un cinéaste puisse néanmoins faire son travail « comme un jeu » (Teguia) tiendrait alors à ceci qu’« œuvre de nos mains » et jeu supposent tous deux liberté et règle. Mais une règle qui, dans le travail du cinéma, est toujours à découvrir puisqu’elle réside d’une part dans la vocation formelle des matières et, d’autre part, dans « un sentiment ou une émotion » (Hansen-Løve), dans « les profondeurs » du « cœur », comme le disait Rilke à Kappus, le jeune poète auquel il ne consentait à donner que ce seul conseil : « plongez en vous-même ». On peut en rapprocher celui que Straub (reprenant Cocteau ou, déjà, Malraux) donna à Alexandra Mélot (qui le rappelle) : « Cultivez ce qu’on vous reproche. »
Ce sont là deux aspects différents de « la nécessité » d’où, comme on le lit également dans les Lettres à un jeune poète, « surgit » une œuvre d’art quand elle est « bonne ». Mais cette nécessité, pas plus qu’elle n’exclut la liberté n’abolit le hasard, en lequel Breton voyait d’ailleurs, dans L’Amour fou, « la forme de manifestation de la nécessité qui se fraie un chemin dans l’inconscient humain. »
On connaît la coutume universitaire consistant, lorsqu’un professeur devient « émérite », à lui offrir des « Mélanges » où sont rassemblés des écrits dont, en la circonstance, lui font hommage collègues et anciens élèves. C’est aussi dans cette perspective-là que j’ai, pour ma part, lu ces dialogues : en y voyant l’hommage que cinéastes, monteuses, technicien du son et, parmi eux, d’anciens étudiants, ont rendu à Dominique ViIlain en répondant à son invitation avant qu’elle ne quitte l’Université de Saint-Denis, ex-Vincennes.
Mais si les « Mélanges » s’écartent souvent du domaine de recherche de leur dédicataire ce n’est nullement le cas de ces entretiens sur le cinéma. Ils s’inscrivent, eux, constamment dans le champ qu’explorait déjà, dans Le Montage au cinéma et L’Œil à la caméra, celle qui les a conçus et conduits. Sans doute est-ce aussi cela qui explique l’impression d’unité donnée par cette somme de témoignages pourtant très différents les uns des autres. Du coup, me sont revenus à l’esprit, au terme de ma lecture, les mots de Mallarmé que Jean-Marie Straub et Danièle Huillet firent jadis prononcer à Dominique, assise en robe rose sur une pelouse du Père-Lachaise dans Toute révolution est un coup de dés (1977) : « évidence de la somme pour peu qu’une ».
Jacques Bontemps