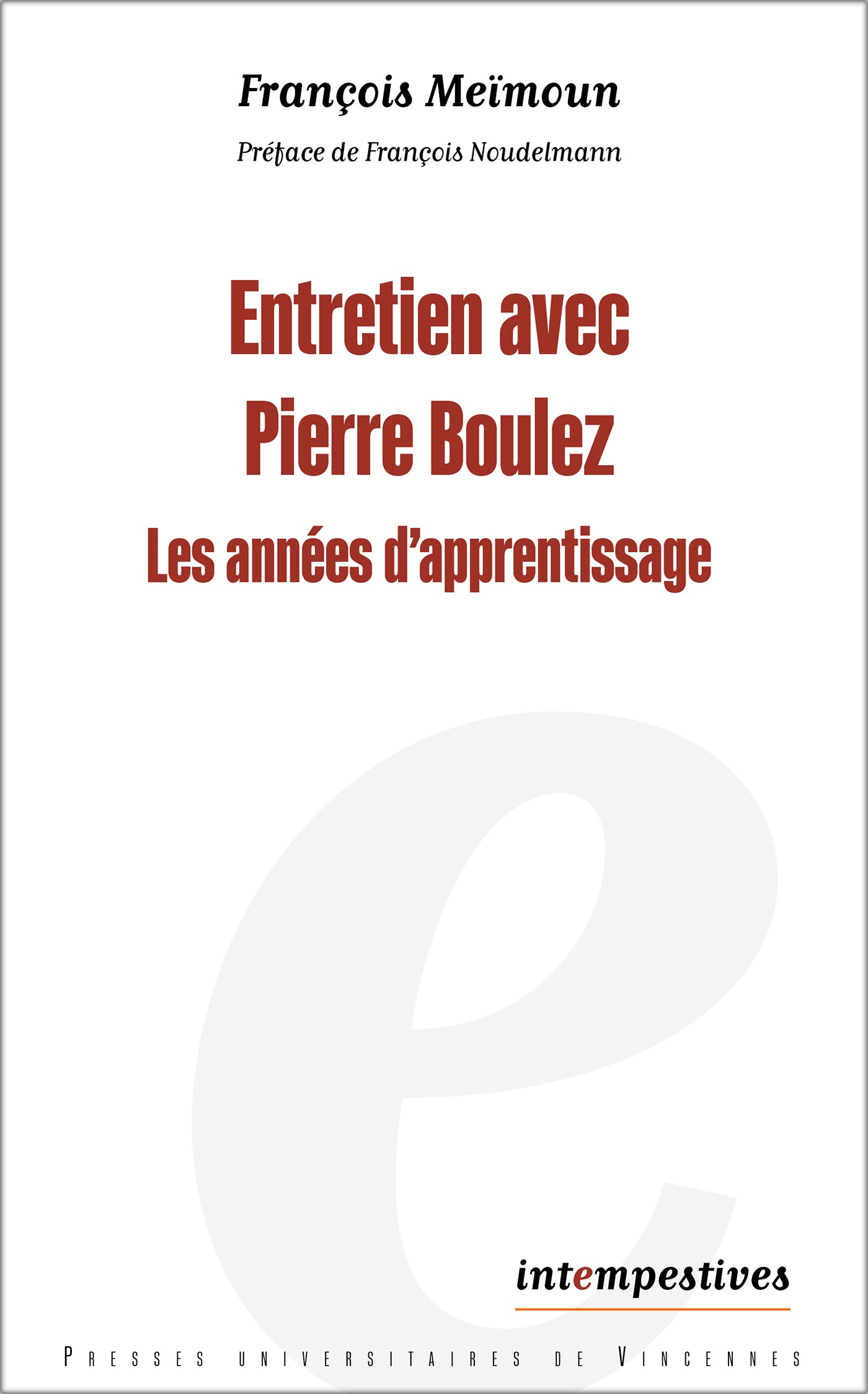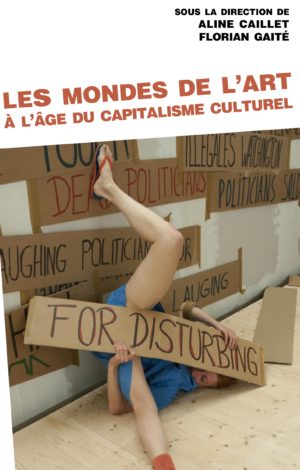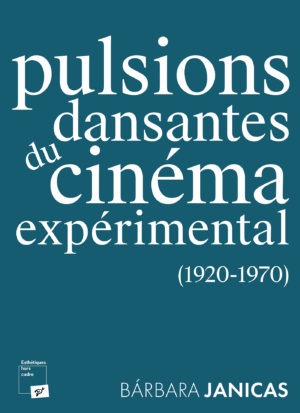Préface
Le centième anniversaire de la naissance de Pierre Boulez a rappelé combien il incarna la modernité musicale de la deuxième moitié du xxe siècle. Cependant François Meïmoun apporte ici un éclairage original sur sa formation : il offre une réflexion esthétique et critique sur la définition du mot « moderne », puis un entretien inédit qu’il réalisa avec Pierre Boulez sur ses années d’apprentissage, et enfin une analyse musicologique de sa Première Sonate pour piano. L’intérêt pour les spécialistes est de découvrir comment le futur compositeur, né en 1925, est venu à la musique. Mais beaucoup plus qu’une documentation biographique sur les débuts, François Meïmoun interroge la situation musicale d’une époque et les choix déterminants opérés par un créateur qui forgea l’ambition de révolutionner la grammaire de son temps.
La préface, l’entretien et l’étude proposés par ce grand connaisseur de Boulez, lui-même compositeur, offrent une réflexion passionnante sur le tissu artistique et politique dans lequel s’est tramé un itinéraire d’exception. La plupart du temps, les monographies des hommes et femmes célèbres, retracent la vie d’un créateur en montrant que tout était programmé dès le départ, ce qui donne à leur personnage la cohérence univoque d’un destin. Cependant l’existence ne marche ainsi que dans le regard rétrospectif des biographes, et même les artistes qui ont inventé un style unique sont passés par des chemins hasardeux, ont connu des hésitations et des contradictions à la fois subjectives et objectives. Pour formuler la question au plus simple, en évitant le mythe romantique du génie dans l’œuf, nous nous demandons alors : comment Boulez est-il devenu Boulez, dans une situation musicale marquée par la Seconde Guerre mondiale ?
Cette question sur les circonstances historiques tord le cou à un autre mythe, bien ancré dans la critique esthétique, celui de la modernité comme table rase. D’après ce récit épique, les grands créateurs font fi du passé et inventent la nouveauté ex nihilo. François Meïmoun, en historien et musicologue, ne tombe pas dans cette illusion et souligne qu’elle sert plutôt à dissimuler les héritages. En revendiquant sa modernité, le créateur s’affranchit de ces prédécesseurs et prend la place majeure, libérée de toute dette. Ce coup de force est particulièrement repérable au moment de la Libération. L’intention polémique, la violence du ton, la volonté de conquête d’un champ culturel marquèrent ces stratégies qui redistribuèrent les cartes. Sartre créa ainsi Les Temps modernes et devint l’intellectuel phare de l’après-guerre. Le jeune Boulez emploie une rhétorique semblable et renvoie les autres compositeurs au passé.
À l’écart d’une telle présomption, François Meïmoun rend justice aux compositeurs qui ont nourri la formation musicale de Boulez, Messiaen au premier chef, mais aussi Stravinsky, Honegger et pas seulement Schönberg. Il rappelle le rôle décisif de Leibowitz dans la transmission de la musique sérielle. Cette reconnaissance ne relève toutefois pas seulement de la justice artistique, mais aussi d’une analyse historique et politique. Le contexte de l’Occupation, pour peu qu’on veuille le rappeler dans les itinéraires de ceux qui devinrent ensuite des idoles de la modernité, conduit à porter un autre regard sur ces ascensions. Pendant les années 1940, la culture française fut florissante, tant dans la création cinématographique, théâtrale que musicale, alors que la société était vidée de ses Juifs stigmatisés et déportés. Aucun professeur, créateur ou interprète ne pouvait l’ignorer dans l’exercice même de ses fonctions. Nombre de musiciens ou d’acteurs ont profité de l’aubaine pour occuper des postes de pouvoir. François Meïmoun le rappelle avec une froide lucidité.
Sans que Boulez ne soit impliqué dans la collaboration, alors qu’il est encore élève au Conservatoire, il évolue dans un milieu où les allégeances sont lourdes de conséquences. François Meïmoun éclaire ainsi le contexte historique et esthétique de la création et ses lecteurs en deviennent mieux instruits sur l’histoire artistique et plus avisés pour comprendre comment se construit une œuvre singulière à partir d’une relation complexe aux héritages. Son entretien avec Boulez est d’une grande précision tant il connaît parfaitement son œuvre, l’arrière-plan musical de ses goûts et composition, et la littérature qui l’inspire. La relation à l’école de Vienne, à Messiaen, ou encore l’importance de Mallarmé, Artaud et Char apparaissent lumineusement. Par ses questions à la fois perspicaces et subtiles, François Meïmoun montre les efforts de distanciation qui ont permis à Boulez, en sus de son génie propre, de devenir le compositeur de son époque. Il en fait la démonstration par son étude de la Première Sonate pour piano. En trois séquences – réflexion, entretien et analyse – nous redécouvrons Boulez et nous comprenons que l’invention est une relation aux héritages.
François Noudelmann