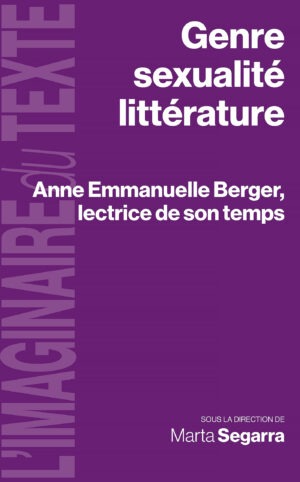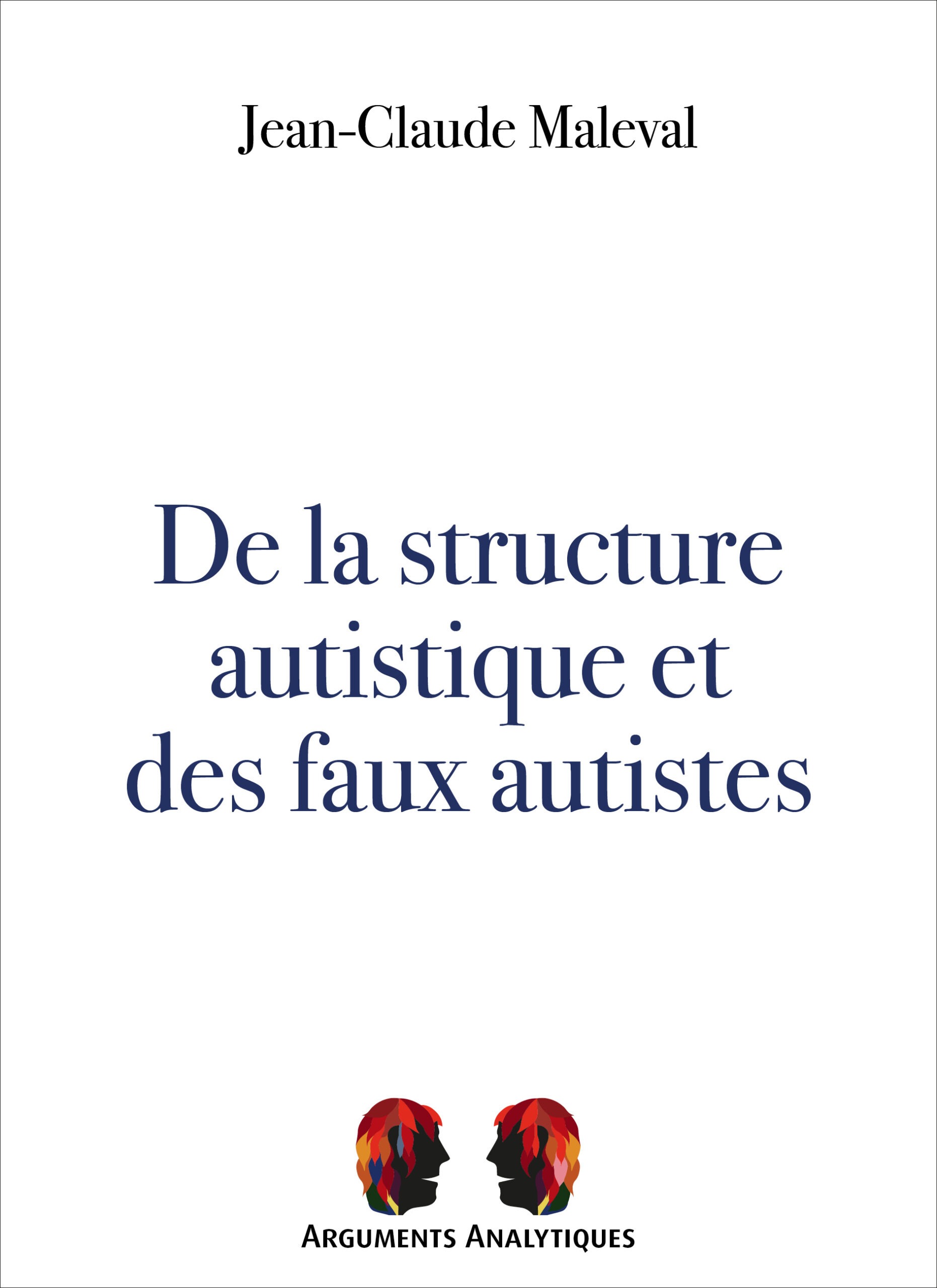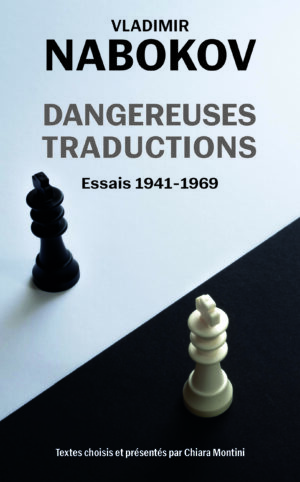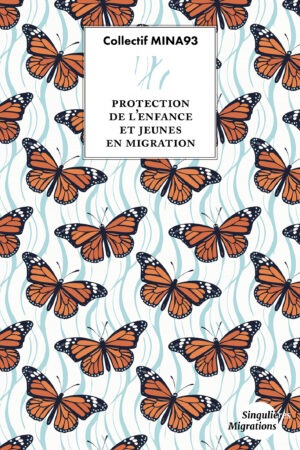Introduction
Une ahurissante progression du diagnostic et de l’auto-diagnostic d’autisme devient un fait de société depuis le début du xxie siècle. La rencontre par les cliniciens de sujets qui se disent autistes, à tort ou à raison, est un phénomène en croissance constante. Josef Schovanec constate un dérapage des diagnostics abusifs, en particulier selon lui chez les adultes 1. Ces conjonctures nouvelles s’enracinent dans la rencontre de la soudaine attractivité sociale de l’autisme avec le flou de sa détermination inhérent à l’impasse faite par la psychiatrie contemporaine sur la fonction et le sens des symptômes.
Dans l’appréhension descriptive de la clinique des Manuels diagnostiques et statistiques des troubles mentaux (DSM) de l’Association américaine de psychiatrie (APA), les items qui permettent d’identifier l’autisme s’expriment pour la plupart à des degrés variables, de sorte qu’ils sont soumis à l’estimation d’un degré « cliniquement significatif », sur lequel l’avis des cotateurs diffère grandement en fonction de leur expérience, et conduit à des décisions diagnostiques qui manquent de fidélité. Quant aux tests tels que l’ADI et l’ADOS (Autism Diagnostic Interview et Autism Diagnostic Observation Schedule), ils sont étalonnés sur des conceptions évolutives de l’autisme dont ils peinent à suivre les variabilités. Ils le distinguent mal de la psychose infantile et de la psychose ordinaire chez l’adulte. La combinaison des sur-diagnostics, principalement chez les enfants, et des sous-diagnostics, surtout chez les adultes, conduit à un important décalage par excès et par défaut entre la clinique de l’autisme et sa désignation. D’autant plus que la psychose infantile, devenue pour beaucoup synonyme de folie, de psychanalyse et de psychopathologie, est un terme honni par certaines associations de parents et leur message a été entendu par les promoteurs du DSM qui ont étendu le champ de l’autisme jusqu’à englober dans son spectre tout un ensemble de pathologies autrefois différenciées : psychoses, schizophrénies infantiles, dysharmonies d’évolution, etc. En faisant l’impasse sur la relation, en réduisant l’identification du trouble à la cotation d’une série d’items, les DSM ont mis le diagnostic à la portée de tous. Depuis le DSM-III, en 1980, des conditions propices à l’auto-diagnostic ont été instaurées grâce à la réduction des troubles à des comportements objectivables semblant pouvoir être identifiés par chacun, sans qu’une expérience clinique y soit nécessaire. Dès lors, il est devenu fréquent que les sujets souffrant de tel ou tel trouble s’affirment comme experts de leur pathologie.
L’attractivité récente du diagnostic d’autisme conduit certains sujets à exercer une pression pour l’obtenir à laquelle les professionnels résistent plus ou moins aisément, étant eux-mêmes souvent incertains quant à son identification. Cette attractivité de l’autisme provient parfois des avantages pécuniaires qu’il permet d’obtenir, mais il tient surtout à ce qu’il s’associe dans l’imaginaire contemporain à des notions positives telles que la surdouance, le haut potentiel intellectuel, l’hypersensibilité, voire le génie. En quelques décennies, l’appréhension sociale de l’autisme est passée d’une pathologie gravissime à une identité d’exception. Albert Einstein et Glenn Gould sont les nouveaux « autistes » les plus souvent cités en exemple sur Internet : ils mettent en évidence qu’un certain retrait social et des capacités exceptionnelles dans un domaine sont en passe de constituer des éléments suffisants pour caractériser l’autisme. Il est ainsi devenu plus valorisant de se considérer autiste que de faire valoir ce que certains patients du siècle dernier nommaient leur « schize exquise ». Certes, autisme et psychose relèvent l’un et l’autre d’un fonctionnement subjectif en dépendance de la forclusion du Nom-du-Père, et leurs cliniques peuvent partiellement se chevaucher. Cependant, les stratégies pour compenser la forclusion s’avèrent très différentes. L’autisme n’est pas une psychose, car l’autisme évolue vers l’autisme 2, tandis que la psychose qui se développe tend plutôt vers des délires de plus en plus structurés 3.
Le flou de l’appréhension de l’autisme tient pour une part majeure à la difficulté de cerner les déterminants essentiels de ce fonctionnement subjectif. Parvenir à donner consistance à l’intuition de Robert et Rosine Lefort, conçue dès les années 1990, selon laquelle il convient de distinguer la structure autistique de la structure psychotique, permettrait d’avancer sur ce point. Selon ces auteurs, bien que le sujet autiste soit hors-discours, il n’est pas hors langage, de sorte qu’ils soulignent une absence d’Autre dans l’autisme, ne discernant que la présence d’une « litanie de signifiants purs 4 ». Sur ce point, ils anticipent des développements plus récents, mais leur approche de la structure autistique est restée en attente d’une saisie rigoureuse. Soulignons qu’identifier l’autisme n’est pas poser un diagnostic, ce dernier impliquant une étiologie, un pronostic et un traitement ; or l’étiologie de l’autisme n’est pas connue, son évolution s’avère diverse et imprévisible, et il n’en existe pas de traitement. L’autisme est un mode de fonctionnement subjectif qui persiste, sous des formes diverses, toute une existence. L’autisme n’est pas une maladie 5, affirme Jim Sinclair :
L’autisme n’est pas quelque chose qu’une personne a, ou une « coquille » dans laquelle une personne est enfermée. Il n’y a pas d’enfant normal caché derrière l’autisme. L’autisme est une manière d’être. Il est envahissant ; il teinte toute expérience, toute sensation, perception, pensée, émotion, tout aspect de la vie. Il n’est pas possible de séparer l’autisme de la personne… et si cela était possible, la personne qui vous resterait ne serait pas la même personne que celle du départ 6.
Temple Grandin confirme cette conception de l’autisme : « Si je pouvais, d’un claquement de doigts, cesser d’être autiste, je ne le ferais pas. Parce que je ne serais plus moi-même. Mon autisme fait partie intégrante de ce que je suis 7. » Identifier une structure subjective n’est pas poser un diagnostic, cependant, même si chaque sujet reste sans pareil, son discernement donne au clinicien une indication majeure pour orienter ses interventions.
Le présent travail, qui s’appuie sur des recherches précédentes – développées dans L’Autiste et sa voix (2009) et dans La Différence autistique (2021) –, repose sur le projet de cerner plus précisément la structure subjective autistique, en s’efforçant de la porter au mathème. En dérivation d’une proposition de Jacques-Alain Miller, et en s’appuyant sur une indication de Jacques Lacan, il semble possible de dégager un mathème centré sur le gel du S1, à savoir un gel par le sujet autiste de la mobilisation du signifiant unaire, coupant celui-ci du S2, assez proche de ce que Jacques-Alain Miller ou Éric Laurent préfèrent nommer un gel de « l’effet-sujet ». Ce gel se manifeste cliniquement par le gel des affects de contact, par celui de l’énonciation et de la décision, ainsi que par une tentative de réifier une langue peu subjectivée en cherchant à la fonder dans les choses (attachement à des termes-étiquettes, prédominance initiale d’une langue factuelle, traduction des mots en représentations de choses dite « penser en images », assimilation de connaissances ready-made). En raison du chaos initial de son monde, l’autiste est en quête de règles absolues. Il les cherche non pas en construisant une nouvelle réalité avec des signifiants, comme s’y emploie le psychotique, mais en s’efforçant de trouver une garantie dans un supposé ordre des choses. Jacques-Alain Miller constate : « L’autiste, dépourvu de l’assise délirante que procure au sujet la certitude psychotique, s’adonne, lui, à la création de certitudes 8. » Dans ses classements d’objets, dans sa quête d’immuabilité, dans son investissement d’intérêts spécifiques comme dans ses efforts pour fonder la langue dans les choses, l’autiste cherche simplement « un monde de cohérences bien pourvu en références fixes », indique Donna Williams ; il s’agit de stratégies pour « mettre de l’ordre à partir du chaos » 9. Le gel des affects s’accompagne d’un vidage de la jouissance du corps qui tend à rejeter celle-ci dans les objets, en particulier dans certains d’entre eux, particulièrement investis, nommés « bords », qui deviennent alors parfois des supports d’énonciations ou de décisions gelées, en tant qu’ils permettent au sujet de se décharger de sa responsabilité en ces actes. « Je ne m’engageais, et ne me compromettais qu’à l’égard des choses, jamais des personnes 10 », affirme Donna Williams.
Les chercheurs partagent tous aujourd’hui un même constat : la dissolution de la notion d’autisme entrave son étude. Dès lors s’impose la nécessité de dégager ce qui constituerait le plus caractéristique de l’autisme. Quel en serait le noyau ? Dans le cadre de l’approche cognitive, Laurent Mottron s’efforce ainsi d’appréhender un autisme qu’il nomme « prototypique », ancré par un trait majeur dans la description de Leo Kanner : un apprentissage non social du langage 11. Cette proposition apparaît d’une grande pertinence. Cependant, faute de prendre en compte la vie affective de l’autiste, Mottron ne dispose pas des outils pour interroger les sources de cet apprentissage si caractéristique. L’approche psychanalytique structurale permet de faire un pas supplémentaire dans la compréhension et la saisie de l’autisme. Le gel du S1 suscite initialement l’appropriation d’une langue réifiée, perçue comme un objet intellectuel, non subjectivé, ce qui résulte de son apprentissage original, opéré non pas dans l’interlocution, mais préférentiellement par l’entremise des écrans et des livres. Or, le gel du S1 ne porte pas seulement sur le mode d’énonciation. Il s’ancre plus profondément dans la vie affective, en étant cliniquement associé à un gel des affects et un gel de la décision, l’un et l’autre passés sous silence par Mottron. Pourquoi l’autiste gèle-t-il le S1 par une appropriation non sociale du langage ? La rétention initiale des objets pulsionnels en donne la réponse : l’autiste refuse très précocement d’entrer dans l’échange avec l’Autre. Mottron conteste cet évitement premier en faisant remarquer à juste titre que beaucoup d’enfants autistes ne fuient pas la présence de l’Autre : il n’est pas rare qu’ils se prêtent volontiers à des chatouilles ou à des corps à corps avec des proches. Il convient donc de préciser que l’évitement de l’Autre n’est pas évitement de sa présence, mais de son désir, qui se manifeste par des demandes mettant en jeu des échanges d’objets. Donna Williams le souligne, la concernant, mais cela vaut pour l’ensemble des autistes : dans son enfance, tout ce qui tournait « autour de l’acte de donner et de recevoir [lui] restait totalement étranger 12 ». C’est pourquoi la plupart des autistes ressentent les marques d’affection à leur encontre comme inquiétantes et dangereuses – sauf, parfois, quand elles ne s’accompagnent pas d’une demande d’échanges. Le gel du S1 est une caractéristique structurale de l’autisme qui converge avec la saisie du prototype esquissée par Mottron en prenant appui sur l’apprentissage non social du langage, mais qui possède une portée heuristique plus étendue, en permettant de déceler ses déterminants dans la vie affective, et dans l’évitement précoce du désir de l’Autre.
Si l’on se borne à appréhender le gel du S1 à partir d’une théorie du traitement de l’information, il apparaît certes corrélé à une construction non sociale de la langue et de l’intelligence de l’autiste. Cependant, dans ce cadre conceptuel, ce qui le motive reste nécessairement obscur. En revanche, situer le gel du S1 dans le champ d’une théorie psychanalytique structurale permet de l’appréhender dans un ensemble plus large de phénomènes : le gel du S1 prend sa source dans une logique subjective précoce d’évitement du désir de l’Autre – dont témoigne la rétention initiale d’objets de la pulsion – qui génère un gel des affects, de l’énonciation et de la décision, ainsi qu’un retour de la jouissance sur un bord. Mottron conteste le refus initial de l’autiste d’entrer dans l’échange, car celui-ci peut difficilement trouver place dans une théorie du traitement de l’information, laquelle doit faire l’impasse sur les déterminants issus de la vie affective. Il fait pourtant aujourd’hui quasiment consensus que des signes précoces de l’autisme sont décelables avant l’âge – fixé par Mottron – de 18-20 mois pour commencer à être identifié 13 : la fuite du regard, le manque d’attention conjointe, le défaut de réponse au nom, la rareté du babillage adressé, la carence du pointage proto-déclaratif, l’absence de recherche pour susciter un échange jubilatoire avec la mère 14. La prévalence de ces phénomènes, souvent associée à une rétention d’objets pulsionnels, est maintenant bien attestée. Mikhail Kissine souligne à juste titre : « La faible sensibilité aux informations sociales dans les premiers stades de la vie d’un enfant autiste a certainement un effet en cascade sur l’acquisition du langage 15. »
De surcroît, la prise en compte de l’hypothèse du gel du S1 apporte un éclairage nouveau sur la clinique des autistes de haut niveau, en permettant de les caractériser comme des sujets chez lesquels s’est produit un moment d’affermissement du dégel du S1. Le constat de dégels cliniques précoces du S1, par exemple à l’occasion des étonnantes phrases spontanées énoncées par des autistes muets, attestent de la possibilité d’une émergence progressive de son introjection qui s’affirme chez les autistes de haut niveau, en rendant leur langue habitée. Quand l’autiste progresse sur le spectre, sa langue cesse peu à peu d’être une suite d’unaires générant, comme le constate Jacques-Alain Miller, « une activité mentale nettoyée de toute empathie, intuition, compréhension, un calcul sans surprise, un processus de pensée contraint par un programme 16 ». D’où la proposition d’un mathème qui s’efforce d’écrire d’un seul tenant la forclusion du Nom-du-Père, le gel de S1 éparpillés qui en sont la conséquence, mais lestés par des sortes d’algorithmes trouvés dans les choses, et l’émergence progressive d’un dégel du S1, de plus en plus discernable quand la position subjective évolue sur le spectre clinique.
La psychanalyse structurale induit des préconisations pratiques qui incitent à faire une place majeure aux objets pour la construction du sujet autiste. Il est remarquable qu’elles convergent pour une grande part avec celles induites par des méthodes développementales telles que l’approche cognitive de Mottron et le SCERTS Model – pour Social Communication, Emotional Regulation, Transactional Support – de Barry M. Prizant. À mesure que les résultats décevants des pratiques cognitivo-comportementales sont de mieux en mieux établis, les méthodes développementales de prise en charge des autistes connaissent une diffusion croissante. La psychanalyse structurale peut trouver place parmi elles si l’on considère que leur caractéristique principale consiste à s’enseigner de la parole des autistes. Bien que ni Mottron, ni le SCERTS Model ne prennent en compte une dimension inconsciente dans le fonctionnement de l’autiste, bien qu’ils privilégient la considération du traitement de l’information, des convergences pratiques majeures avec celles dégagées par la psychanalyse structurale se discernent dans leurs préconisations. Ces points de rencontre, nombreux, méritent toute notre attention. Ils permettent de dégager un corps minimal d’indications précieuses que nous tentons de préciser. Celui-ci devrait trouver une large approbation auprès des cliniciens pour lesquels la parole des autistes constitue le médium majeur de leurs pratiques.
Jean-Claude Maleval
- 1. Josef Schovanec, « Autisme adulte, trop de diagnostics abusifs », handicap.fr, 28 février 2020 [en ligne : https://informations.handicap.fr/a-schovanec-autisme-adulte-diagnostics-abusifs-12649.php].
- 2. Dans le chapitre « Pourquoi l’autisme n’est-il pas une psychose ? » inséré dans La Différence autistique, il est souligné, non seulement que l’autisme évolue vers l’autisme, mais aussi que sa clinique ne présente ni délire structuré, ni hallucinations verbales, que les conduites d’immuabilité sont spécifiques, que l’autisme ne se déclenche pas, et que les écrits produits par des autistes sont distinguables de ceux des psychotiques. Cf. Jean-Claude Maleval, La Différence autistique, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2021.
- 3. Jean-Claude Maleval, La Logique du délire [1997], Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
- 4. Robert et Rosine Lefort, « Signifiant et objet dans l’autisme », Confluents, 1994, p. 42.
- 5. Jim Sinclair, « Medical research funding », Our Voice. Autism Network International newsletter, no 3.1, 1995.
- 6. Id., « Don’t mourn for us », Our Voice. Autism Network International newsletter, no 1.3, 1993.
- 7. Temple Grandin, Penser en images [1995], Paris, Odile Jacob, 1997, p. 17.
- 8. Jacques-Alain Miller, « Préface », dans Jean-Claude Maleval, La Différence autistique, op. cit., p. 13.
- 9. Donna Williams, Si on me touche, je n’existe plus. Le témoignage exceptionnel d’une jeune autiste [1992], Paris, Robert Laffont, 1992, p. 76-77.
- 10. Ibid., p. 89.
- 11. Laurent Mottron, Si l’autisme n’est pas une maladie, qu’est-ce ? Une refondation de la définition de l’autisme, de son étiologie et de sa place dans l’espèce humaine, Bruxelles, Mardaga, 2024, p. 285.
- 12. Donna Williams, Si on me touche, je n’existe plus, op. cit., p. 66.
- 13. Laurent Mottron, Si l’autisme n’est pas une maladie, qu’est-ce ?, op. cit., p. 13.
- 14. Bertrand Olliac et al., « Infant and dyadic assessment in early community-based screening for autism spectrum disorders with the PREAUT grid », Plos One, no 12.12, 2017, 2017 [https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188831].
- 15. Mikhail Kissine, « Autism, constructionism, and nativism », Language, no 97.3, 2021, p. e139-e160.
- 16. Jacques-Alain Miller, « Préface », dans Jean-Claude Maleval, La Différence autistique, op. cit., p. 14.