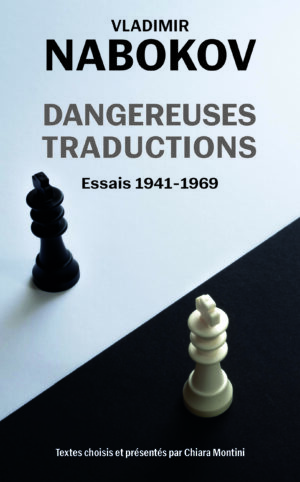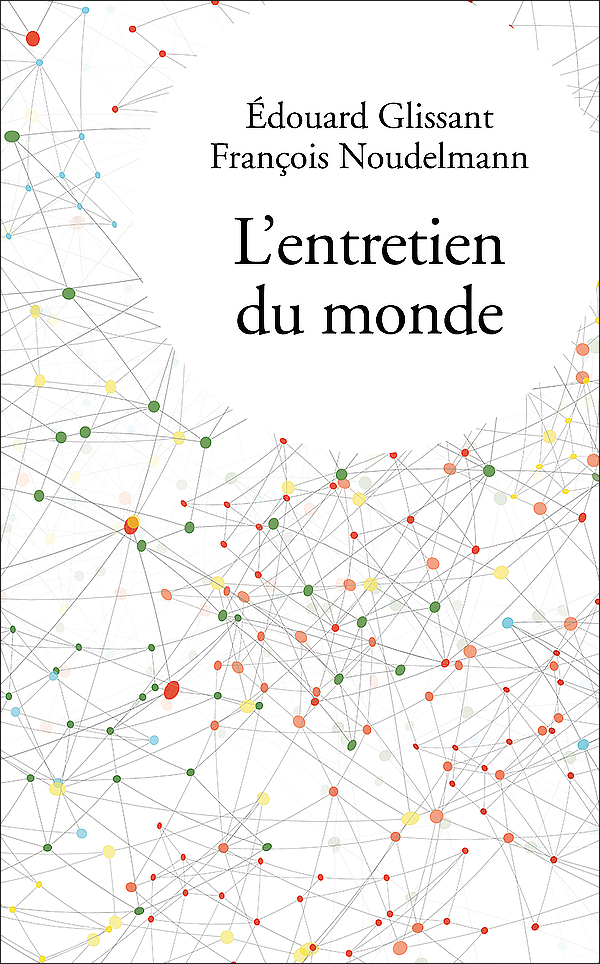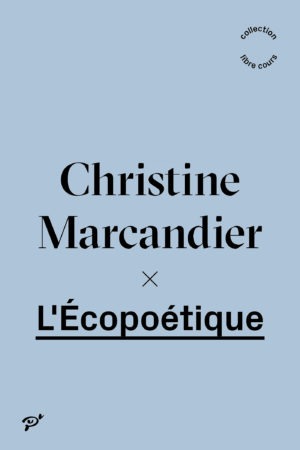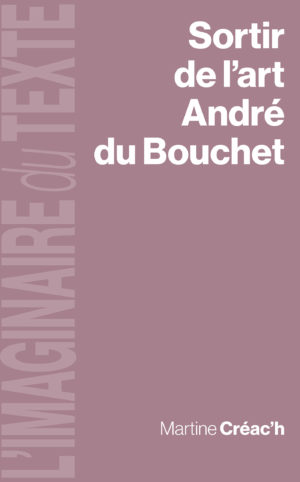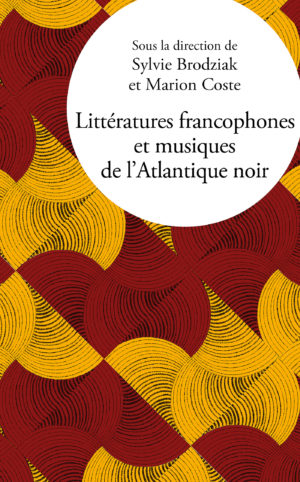Philosopher en relation
François Noudelmann
Le succès des idées d’Édouard Glissant, au début du xxie siècle, fait parfois oublier les exils et les solitudes vécus par cet écrivain.
Le prix Renaudot lui apporta une célébrité à l’âge de 30 ans, pour son premier roman, La Lézarde, paru en 1958, mais il se définissait avant tout comme un poète et poursuivit une écriture exigeante. Sa pensée philosophique, formée auprès de Bachelard, Wahl et Merleau-Ponty, ne lui ouvrit pas les portes des universités françaises et c’est aux États-Unis qu’il passa la plus grande partie de sa vie professionnelle. Le déferlement d’hommages lors de sa mort, en 2011, venu de tous les bords politiques et culturels, laisserait croire que Glissant fut soutenu par les institutions. Il n’en est rien, et le récent classement de son œuvre comme trésor national par le ministère de la Culture lui offre une reconnaissance tardive.
Lorsque je le rencontrai en 2002 pour réaliser un premier entretien, Édouard Glissant vivait à l’écart. Il habitait à Long Island City, en bordure de Manhattan qu’il appréciait peu, et il passait ses nuits à écrire, dédaignant la vie sociale. L’université de Louisiane qui l’avait fait venir aux États-Unis, une quinzaine d’années avant, l’avait déçu, l’Institut qu’il avait créé à Fort-de-France ne voulait plus de lui, et il avait trouvé refuge à CUNY, l’université publique de New York. Il y enseignait la poésie à quelques étudiants avertis et attendait les périodes de vacances pour retourner en Martinique et à Paris dès que possible.
Latéral plus que marginal, Glissant assumait ses pas de côté, déjouant les antithèses convenues des idéologies en cours.
Il proposait toujours des tangentes : la relation plutôt que l’identité ou l’altérité, la créolisation plutôt que la négritude ou l’universalisme, l’archipel plutôt que le continent ou l’île… Une pensée qui valorise la complexité et l’opacité prend le risque du malentendu et, de fait, le contexte français prédisposait peu à une compréhension de ces idées singulières. Associé aux luttes indépendantistes des années 1960, Glissant resta considéré comme « un écrivain antillais », un auteur communautaire. « On ne prend pas au sérieux un nègre qui pense », remarquait-il avec une lucidité amère, et il déplorait le confinement exotique de ses essais dans les rayonnages dits francophones ou ultramarins.
La mécompréhension de Glissant fut encore plus manifeste aux États-Unis, pour des raisons inverses. Sa critique de l’afrocentrisme, de la mythologie des racines et des identités originelles allait à rebours des études afro-américaines qui s’affirmaient alors dans les universités. Glissant consacrait certes une part de ses œuvres à construire une histoire des peuples issus de la Traite et de l’esclavage, mais il ne croyait pas aux recherches généalogiques ni à l’identification des descendants d’esclaves aux ancêtres et à la terre première. De surcroît, en dévouant son enseignement à des poètes français ou, pire, à un écrivain tel que Faulkner, héritier des esclavagistes du sud des États-Unis, il fut suspecté de ne pas assumer son propre héritage.
Les études postcoloniales se développant dans les années 1980, Glissant aurait pu y trouver un terrain d’élection, tant sa pensée de la créolisation permet de refonder le langage des multiplicités culturelles. Cependant les théoriciens américains prirent leurs références chez Foucault, Deleuze, Irigaray et Kristeva plus que chez Césaire, Fanon et Glissant. Et lorsque le courant postcolonial arriva en France, il se nourrit de Spivak, Bhabha, Gilroy et Hall, non de Glissant, laissé sur la plage de cet aller-retour transatlantique. Il fallut attendre une série de colloques à New York University en 2009, pour que sa pensée, grâce aux traductions, soit largement reconnue aux États-Unis, de même qu’en France un colloque de la Sorbonne, en 1998, avait enfin imposé l’écrivain, âgé de soixante-dix ans, dans le paysage universitaire français.
La réception d’une œuvre et d’une pensée ne se mesure sans doute pas à l’aune de ses reconnaissances institutionnelles. Le relatif isolement de l’écrivain fut compensé par des éclaireurs de longue date qui accompagnèrent son parcours – poètes, dramaturges, romanciers, artistes, philosophes et spécialistes venus de tous les pays. Son poème épique, Les Indes, paru en 1956, fut aussitôt considéré comme un chef-d’œuvre par les jeunes écrivains que fréquentait Glissant à Paris. En 1981, Le Discours antillais devint le grand texte de référence, après le courant de la négritude, pour les intellectuels du monde caraïbe. Dans les années 1990, lors de la parution de Poétique de la relation, les philosophes Deleuze, Guattari et Derrida furent les interlocuteurs réguliers du théoricien des identités nomades.
Aujourd’hui, cette pensée a traversé les frontières disciplinaires et elle inspire des juristes, des pédagogues, des anthropologues, des peintres et des musiciens. Le penseur des archipels avait dessiné lui-même ce type de transmission qui passe par des greffes et des métamorphoses, quitte à s’effacer derrière ses concepts fugueurs. De fait, ces derniers ont développé leurs rhizomes aussi bien en Europe qu’au Japon, en Tunisie ou en Amérique du Sud, la notion de créolisation ne se réduisant pas aux territoires créoles. Les continents eux-mêmes s’archipélisent selon cette « relation », pour peu qu’on y révèle la multiplicité qui les a toujours composés. La pensée de Glissant, formidablement actuelle, permet d’en comprendre, sans naïveté ni surplomb, la dynamique et l’imprévisibilité.
S’il refusait le rôle d’un maître-penseur, Glissant n’en aimait pas moins la discussion, voire la dispute. Dès son plus jeune âge il avait constitué un groupe de réflexion poétique et politique, Franc-Jeu, et il prononçait des discours en place publique. La fondation de l’Institut martiniquais d’études, en 1967, puis de l’Institut du Tout-Monde, en 2006, témoignent du désir de porter une parole parmi le plus grand nombre et de la mettre à l’épreuve des contradictions. Pour avoir mené pendant plusieurs années un séminaire avec lui,
je peux confirmer qu’Édouard Glissant préférait discuter une pensée différente plutôt que d’entendre louer la sienne. L’entretien était une forme de la relation qui, dans les meilleures situations, permettait de « changer en échangeant », comme il se plaisait à le répéter. Il rejetait les arguments d’autorité et souhaitait que la discussion fût une véritable expérience. À cette fin, il cherchait à briser les discours trop préparés, par exemple en m’imposant de partager quelques ti-punchs avant le début des enregistrements. Il appréciait les discours spéculatifs, mais restait toujours en prise avec le monde qui va, proche et lointain. Glissant assumait joyeusement le libre cours de sa pensée, faite d’éclairs d’intelligence et de plongées dans les profondeurs du vécu.
Les six entretiens retranscrits dans ce volume portent principalement sur la réflexion philosophique de Glissant. Ils sont suivis par des articles qui prolongent nos discussions sur des enjeux théoriques (la transmission sans universel), poétiques (les figures motrices de l’écriture) et politiques (l’Europe depuis l’Afrique, les concurrences mémorielles, la comparaison entre la Traite et la Shoah). Dans les traces et les échos de Glissant se dessine, selon son expression, « une nouvelle région du monde », à la fois un espace et une direction, une écoute et un appel.