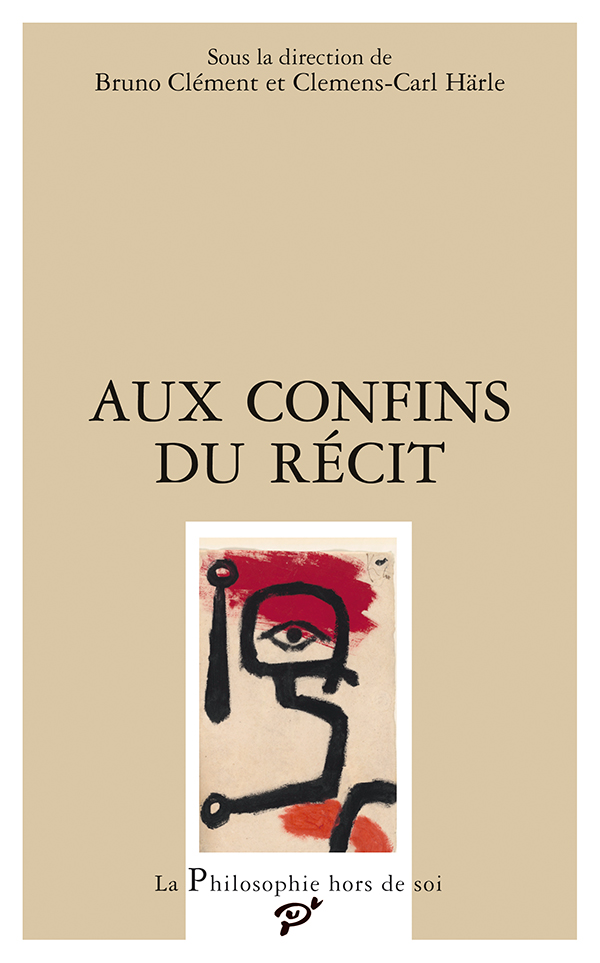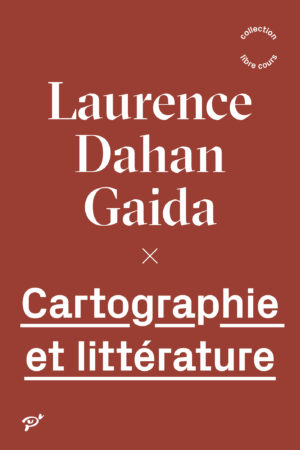Avant-propos
Clemens-Carl Härle
On peut, sur le récit, formuler deux hypothèses. La première suggère que le récit constitue, plus que toute autre forme linguistique, un mode d’accomplissement du désir. Le fait de pouvoir dire un événement, le soustraire à l’oubli et le doter d’un sens possible procure non moins de plaisir que l’écoute ou la lecture. Il y a dans tout récit comme un pli qui joint un sens, tant présent que caché, et une adresse à l’intention d’un destinataire. C’est à ce pli, presque imperceptible, que semble due la satisfaction suscitée par la fabulation ou le fait d’entendre des récits. Cela ne veut pas dire que le désir est intrinsèquement lié à la forme-récit ; il est bien trop malléable, bien trop retors pour s’attacher, pour ainsi dire a priori, à une forme d’expression déterminée ou à un support aussi singulier que la voix. Mais en suggérant que c’est bien le désir qui s’accomplit dans les rêves comme dans les cauchemars, Freud insiste puissamment sur les forces qui lient le désir au récit, même si la nature de ce lien et du sens qui s’y livre ou s’y soustrait risque d’échapper au rêveur ; même si, du fait de la complexité linguistique inhérente au récit, l’infans une fois réveillé peine à nommer le secret dont les choses qui lui arrivent semblent imprégnées.
La seconde hypothèse, qui ne s’oppose pas à la première, mais en déplace la perspective, insiste sur la nature polymorphe du récit, sur la diversité de ses supports. Inventer et transmettre des récits, cela ne relève ou ne relevait pas seulement de la vie quotidienne, à en croire Benjamin lorsqu’il constate, dans son célèbre essai sur le narrateur, que « l’art de conter est en train de se perdre ». La littérature ne cesse de renouveler les formes de la narration et de les pousser jusqu’à leur extrême limite, parfois jusqu’à leur épuisement. Et au-delà même du langage, en peinture, au cinéma et en musique, des formes d’agencement empruntées à la narration prolifèrent, comme si le récit pouvait « coloniser » les couleurs, les images, les sons, les blocs d’espace/temps. Les formes narratives vont jusqu’à investir des discours qui, comme l’historiographie ou la philosophie, ne peuvent que difficilement s’affranchir de la vérité (son autorité, sa valeur) envers laquelle le récit semble plutôt faire preuve d’indifférence voire de désinvolture.
Si l’opposition du mythos et du logos est au fondement de la conscience que l’Occident a ou a eue de lui-même et qu’il a sans grands scrupules imposée au reste du monde, c’est bien parce que le logos a écarté les fables au profit d’un savoir fondé sur l’argumentation et sur la démonstration. Fixer les axiomes qui doivent régler la formation et la connexion des propositions, géométriser les rapports spatiaux, affirmer la convertibilité mathématique de l’être : on pourrait difficilement imaginer de pires ennemis pour l’affabulation, voire pour la dialectique. Euclide et Pythagore – et plus tard Spinoza, qui pensait pouvoir épuiser more geometrico la sphère de l’imagination en la circonscrivant au premier genre de connaissance – sont les champions d’une volonté de savoir pour laquelle la « narration véritable et rigoureuse » que constituait le mythe aux yeux de Vico n’est qu’une fable pour enfants. Mais, comme le montre l’exemple de la métempsycose chère aux pythagoriciens, le récit – sans parler du désir lui-même – n’a pas longtemps attendu pour préparer sa revanche. Pauvre logos qui a dû se plier à la formalisation du pensable pour se libérer de la narration et s’armer contre ses sortilèges ; qui a risqué de s’amputer de ce qui constitue plus que toute autre chose la force véritable de la pensée : le rapport intime et inaliénable entre intuition et concept ; et qui, au moment où il s’efforçait d’affronter l’énigme des origines, des commencements et des disparitions, de la fin et des fins, a dû admettre qu’il avait en lui des résidus de narration.
Le logos ne représente cependant que l’une des frontières du récit, bien que ce soit sans doute la plus visible. La narration est loin d’être un fait compact ou univoque, et pas seulement en raison de la variété de ses formes.
À l’extérieur du récit, tout au long de sa frontière avec les autres genres du discours, mais aussi à l’intérieur de lui-même – et c’est là, en un certain sens, une troisième hypothèse – une ligne de fracture sépare la forme narrative de sa réalisation « pragmatique ». Le récit lui-même, surtout si l’on en parle comme Benjamin, tend à dissimuler cette fracture. En voyant dans le récit une « faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes : la faculté d’échanger des expériences », Benjamin tient pour acquis le lien ou la quasi-coïncidence entre deux des dimensions ou aspects du récit : sa forme, c’est-à-dire la manière dont il exprime la signification d’un événement ou d’une suite d’événements, et l’acte de raconter au sens strict du terme, à savoir le mode spécifique de sa transmission de bouche en bouche ou de bouche à oreille. C’est ce mode spécifique de transmission où le destinataire, en re-racontant le récit, peut et doit devenir à son tour destinateur – pour Benjamin, la figure du conteur naît justement dans et en vertu de cette inversion – qui fait défaut aux autres formes narratives, non seulement dans le champ strictement littéraire, mais surtout en peinture, au cinéma ou encore dans les formes para-narratives que l’on peut rencontrer en philosophie, dans l’historiographie ou dans les religions. Toutes ces formes se sont affranchies de la tradition orale comme mode de réalisation du récit si tant est qu’elles aient jamais entretenu de rapport avec elle, puisqu’elles ne dépendent pas d’une voix qui parle ou qui récite, mais d’un support matériel qui fonctionne comme surface d’inscription ou d’écriture au sens propre du terme. Dans chacun de ces cas – et c’est la grande majorité – le qualificatif « narratif » ne renvoie qu’à un mode spécifique d’attribution d’un sens possible à un événement ou à un ensemble de figures. Ni la conservation ni la transmission du récit ne reposent plus sur la communication entre un destinateur et un destinataire « réels », mais sur la persistance du support matériel et de ses équivalents institutionnels. Le narrateur, qui est à l’« origine » de ces récits, est structurellement absent, et la rencontre avec un destinataire, lecteur ou auditeur, tout à fait contingente.
En se détachant de la tradition orale, les formes narratives se sont sans doute trouvées encouragées à proliférer et à se diversifier, accentuant ainsi une polymorphie qui condamne toute tentative de les classer ou de les concevoir comme rejetons d’un modèle unique, d’une Urerzählung ou d’un proto-récit. Il est vrai que, malgré la distance prise à l’égard de la tradition orale, une voix narrante continue d’opérer, surtout en littérature et parfois au cinéma, sous forme de voix off. « La voix du conteur anonyme, antérieur à toute écriture », pour citer une nouvelle fois Benjamin, continue de nous parvenir comme un écho lointain. Sous les formes les plus diverses, la littérature évoque, simule ou répète le scénario et les gestes du discours oral. Mais il est également vrai qu’une infinité d’autres modes de narration – dont le modèle le plus emblématique est le monologue intérieur, où le locuteur est en même temps l’« unique » destinataire de son propre discours – sont rendus possibles par la fixation même, dans l’écriture, du soliloque, du murmure ou du délire. Conséquence : l’altérité à laquelle s’adresse toute allocution, voire toute apostrophe, ne se fait désormais entendre qu’à partir d’une voix disjointe d’elle-même, au sein d’un « je » dédoublé.
Pourtant, c’est surtout une autre facette de la forme-récit qui s’éclaire lorsque nous sommes confrontés à sa reproductibilité matérielle et à l’effacement de l’oralité. Deleuze a insisté sur le fait qu’il ne faut considérer les formes narratives au cinéma – presque évidentes de prime abord – que comme une sorte d’épiphénomène, et que le cinéma tire surtout sa force des dynamismes internes aux images cinématographiques elles-mêmes, des rapports variables entre le temps et le mouvement qui s’instaurent en elles. Un automate spirituel prend la place du narrateur, en produisant à partir d’une « matière signalétique » et des « traits d’expression non-langagiers » des percepts et des affects indépendants des structures narratives. L’hypothèse mérite d’être élargie. Avec ses plis et ses secrets, son jeu entre dit et non-dit, sans doute le récit repose-t-il essentiellement sur le langage articulé. Mais il est aussi une forme susceptible, sous certaines conditions, d’être produite ou simulée à travers d’autres supports matériels. Couleurs, lignes, sons, volumes, blocs de mouvements/durée peuvent s’agencer de telle sorte qu’au fil de leurs configurations, une histoire petite ou grande semble se raconter comme d’elle-même, et en l’absence de tout narrateur. Les matières non linguistiquement formées peuvent certes accueillir le récit, mais elles peuvent en même temps – si même elles ne le requièrent pas – être organisées d’une façon tout à fait différente, autonome, éloignée de toute narrativité, sans pour autant perdre leur pouvoir expressif, bien au contraire. Nous ne saurons jamais si le peintre anonyme de la préhistoire entendait raconter quelque chose quand il juxtaposait des formes d’animaux sur les parois de la grotte, ou s’il voulait attirer ailleurs notre attention. Bref, une autre frontière du récit, parfois imperceptible, traverse la région où les couleurs et les lignes, les sons et les volumes, bien qu’ajointés de façon presque narrative, n’en échappent pas moins à la narration au sens strict du terme, au profit d’autres formes ou d’une dissolution des formes dont Manet, en peinture, est peut-être le premier grand exemple. Au sein même du langage articulé, un phénomène analogue subsiste lorsque le récit se trouve interrompu au beau milieu de l’intrigue par un cri, un bredouillement ou un simple silence.
J’ajoute une dernière considération. Le récit est, de toutes les formes de discours, celle qui est le plus sensible à ce qui arrive, à l’événement. Il peut le présenter tel quel dans sa nudité, ou pris dans un enchevêtrement d’autres occurrences, mais toujours à une seule condition : comme quelque chose qui arrive à quelqu’un. Il n’y a pas d’événement dans le récit sans que soient mentionnés celui, celle ou ceux à qui arrive ou est arrivé quelque chose. Quelqu’un (A) subit une modification suite à un événement et ne peut que montrer ou faire entendre – raconter – cette modification et l’événement qui l’a suscitée à quelqu’un d’autre (B), qui subit alors à son tour une altération de son état dont il doit rendre compte à quelqu’un d’autre encore (C) ou à celui qui lui a fait subir cette modification (A). Dans la majorité des cas, à ce « quelqu’un » correspondent des êtres humains, quelquefois des animaux ou des figures divines. Mais il se peut que la narrativité franchisse les frontières de la figuration littéraire et s’introduise dans des discours où la prosopopée occupe une position marginale, comme en philosophie ou en historiographie. Tout se passe comme si un événement pouvait arriver non seulement à des êtres animés, mais aussi aux concepts, aux formes de pensée – aux formes discursives en général –, et peut-être même aux formations non-discursives, aux formations sociales ou de pouvoir, et pourquoi pas, aux formations matérielles, biologiques, telluriques, nucléaires… C’est ce que laisse entendre le terme d’« histoire naturelle », synonyme de science naturelle au xviiie siècle. Faut-il dire que le savant se change alors en une sorte de narrateur virtuel qui doit pourtant, à la différence du conteur, se limiter au critère de vérité, du moins jusqu’à un certain point ? Ou faut-il dire que ces formes, dans la mesure où elles sont susceptibles d’être affectées par l’événement, risquent de se transformer en pseudo-sujets ? Il semble que la pensée puisse difficilement se passer des formes para-narratives quand elle ne se contente pas d’établir de simples relations causales entre ses objets, mais elle paraît aussi quelque peu embarrassée lorsqu’il s’agit d’en mesurer ou d’en justifier les conséquences.
Le récit est un schème temporel, ou plus précisément un schème de relations infra-temporelles ; le plus puissant, peut-être, dont nous disposions. Mais qu’arrive-t-il au récit lorsque, cessant d’être seulement la forme de ce qui apparaît, le temps lui-même advient ou s’évanouit ? Ou lorsqu’on se trouve confronté à une autre limite séparant le temps du non-temps, de l’« éternité » ? Le temps est une instance et pas seulement un instant ou une suite d’instants. Une instance qui peut s’annoncer, insister ou se retirer en tant que telle, comme dans la peinture non-figurative – Lyotard l’a montré à propos de l’œuvre de Barnett Newman –, en musique ou au cinéma : Deleuze parle d’une image-temps directe. Le cas de la musique est peut-être emblématique de l’ambiguïté du rapport entre temps et récit. Bien que perceptible comme une individualité distincte, un motif musical n’est pas un personnage au sens strict du terme. Si une séquence musicale peut cependant évoquer quelque chose qui ressemble à une histoire, c’est grâce à des rapports quasi interlocutoires qui peuvent éventuellement s’instaurer et se cumuler dans la suite des figures. En même temps que les sons, fait irruption une figure ou une suite de figures reconnaissables qui tendent – comme chez Mahler –, à transformer le temps musical en une sorte d’équivalent du récit. Mais rien n’impose que l’irruption des sons se dédouble de cette façon. Il y a des musiques informelles où ce qui se donne à entendre dans l’irruption des sons ou plus encore dans le silence qui isole les sons les uns des autres, c’est plutôt le temps lui-même, dans son insistance ou dans son retrait – comme chez Webern. Les limites entre la narration musicale infra-temporelle, la présentation d’une image du temps ou d’un temps musical au sens strict du terme et le temps en tant que tel se trouvent donc singulièrement brouillées et souvent à peine audibles, d’une façon qui ne vaut peut-être pas que pour la musique.
Les articles réunis dans ce volume examinent ces hypothèses et – fort heureusement – bien d’autres encore. Ils ont été présentés en mai 2008 lors d’un colloque intitulé Limiti del racconto, organisé à l’Université de Sienne en partenariat avec le Collège international de philosophie de Paris, et dont les actes ont été publiés en italien sous le titre Confini del racconto (Macerata, Quodlibet, 2009).
Je remercie Bruno Clément d’avoir rendu possible l’édition française de ce volume dans la collection « La Philosophie hors de soi » aux Presses Universitaires de Vincennes, ainsi que les traducteurs des textes italiens et allemands. Et je remercie Antonella Moscati pour l’aide précieuse qu’elle a apportée à la relecture et à la composition de l’ouvrage, dès sa version italienne.
(Traduction de Céline Frigau)